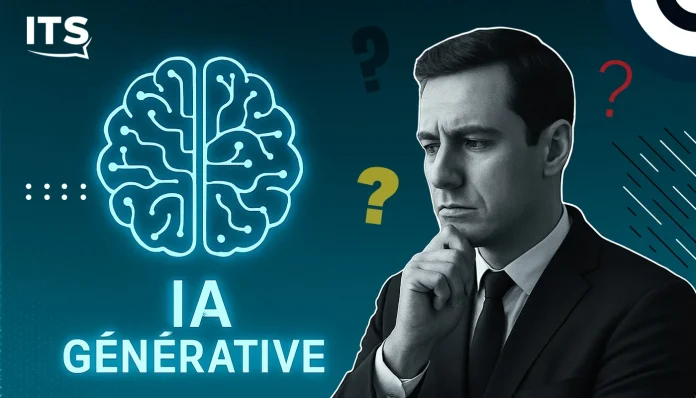Depuis deux ans, les grands modèles de langage comme ChatGPT ou Copilot se sont imposés dans les organisations. Plus de 80 % d’entre elles les ont explorés ou testés, et près de 40 % déclarent avoir entamé un déploiement. Pourtant, selon l’étude State of AI in Business 2025 du MIT, 95 % des projets ne produisent aucun impact mesurable sur le compte de résultat. Les investissements, estimés entre 30 et 40 milliards de dollars, n’ont profité qu’à une minorité : seuls 5 % des pilotes ont réellement généré des gains tangibles, chiffrés en millions. Cette situation illustre ce que les chercheurs nomment le “GenAI Divide” : un gouffre entre l’adoption visible et la transformation profonde, perceptible seulement dans deux secteurs, la technologie et les médias, sur les neuf étudiés.
Les raisons de ce décalage sont multiples, mais elles convergent vers une même limite : l’absence d’intégration aux processus critiques. Trop souvent, les outils génératifs sont déployés comme des vitrines technologiques ou des démonstrateurs ponctuels, sans ancrage dans la chaîne de valeur. L’effet de nouveauté masque la difficulté à transformer l’essai, d’autant que les indicateurs de succès sont mal définis : il est plus facile de compter le nombre d’utilisateurs que de mesurer l’impact sur la productivité ou sur les coûts. L’écart entre expérimentation et transformation s’accroît ainsi au fur et à mesure que les déploiements se multiplient sans cadre clair ni objectifs mesurables.
Les obstacles structurels et le déficit d’apprentissage
Le principal frein identifié par l’étude du MIT ne réside ni dans la puissance des modèles ni dans la réglementation. Le facteur bloquant est le manque de capacités d’apprentissage des outils déployés. La plupart des systèmes ne retiennent pas les retours des utilisateurs, n’apprennent pas de leurs erreurs, et ne s’adaptent pas aux contextes métiers spécifiques. Cette rigidité explique le taux d’échec élevé des projets : seuls 5 % des outils sur mesure atteignent la production. L’écart est particulièrement marqué entre les usages grand public, où des outils comme ChatGPT rencontrent un vrai succès individuel, et les solutions d’entreprise, souvent perçues comme rigides, surdimensionnées ou déconnectées du terrain.Ce déficit d’apprentissage engendre un autre phénomène : la prolifération du “shadow AI”. L’étude indique que plus de 90 % des collaborateurs utilisent déjà à titre personnel des outils d’IA générative pour automatiser des tâches, tandis que seulement 40 % des entreprises fournissent des solutions institutionnelles. Cette dynamique illustre la distance entre les attentes des utilisateurs et les solutions proposées par les directions informatiques ou métiers. Là où les outils personnels sont flexibles, adaptables et immédiats, les outils d’entreprise manquent de mémoire, de personnalisation et d’évolutivité. L’IA grand public gagne ainsi la bataille de l’usage quotidien, mais reste inapte aux tâches critiques faute d’intégration et de continuité contextuelle.
La répartition des budgets et les investissements mal orientés
L’un des enseignements majeurs du rapport concerne la ventilation des budgets alloués à l’IA générative. En moyenne, plus de 50 % des investissements sont dirigés vers les fonctions marketing et commerciales, car les indicateurs y sont plus visibles et directement alignés sur les objectifs du comité de direction. Ces choix sont rarement contestés, tant ils permettent de justifier des gains de type leads, taux d’ouverture ou réduction des délais de réponse. Pourtant, ce biais masque le potentiel réel de la technologie. Les fonctions administratives, financières ou de back-office sont moins valorisées mais offrent des retours sur investissement bien plus significatifs. Plusieurs entreprises étudiées par le MIT ont ainsi supprimé entre 2 et 10 millions de dollars de dépenses d’externalisation (BPO), réduit de 30 % leurs frais d’agences externes, ou encore amélioré la gestion documentaire et les cycles de validation contractuelle.Ce décalage entre perception et réalité économique prolonge le “GenAI Divide” : les projets visibles sont privilégiés au détriment des chantiers structurels. Ce sont pourtant ces derniers qui permettent de dégager des gains durables, sans nécessairement passer par des suppressions de postes. Les entreprises les plus avancées rapportent une amélioration de l'efficacité sans bouleversement organisationnel. L’IA générative devient ici un outil d’optimisation, plus qu’un vecteur de rupture. La visibilité médiatique et la simplicité des indicateurs ne doivent donc pas orienter à elles seules les arbitrages budgétaires.
Le rôle des partenariats externes et la limite des projets internes
L’étude établit une corrélation nette entre le succès des projets et la nature de leur mise en œuvre. Les solutions co-développées avec des partenaires spécialisés aboutissent deux fois plus souvent à des déploiements opérationnels que celles conçues uniquement en interne. L’écart s’explique par plusieurs facteurs : meilleure compréhension des cas d’usage, capacité à intégrer les outils existants, et surtout possibilité de faire évoluer les solutions dans le temps. Les organisations les plus matures exigent de leurs prestataires des capacités d’apprentissage, une interopérabilité avec leur système d’information, et une personnalisation fine. À l’inverse, les outils “génériques” ou les développements maison échouent fréquemment à dépasser le stade du prototype, faute de ressources, de gouvernance ou de culture produit.Un autre levier déterminant est la confiance. Selon les décideurs interrogés, les démonstrations séduisantes ne suffisent plus : les relations existantes, les recommandations de pairs et les garanties sur la sécurité des données deviennent prioritaires. Ce phénomène renforce les acteurs déjà en place et pénalise les éditeurs émergents qui peinent à franchir les barrières de l’approbation juridique, de la conformité ou de la cybersécurité. Le marché se structure donc autour d’un double impératif : construire des systèmes réellement apprenants et gagner la confiance dans un contexte d’encombrement technologique.
Un triptyque incontournable pour la réussite
Selon l’étude, la réussite de l’IA générative repose sur un triptyque incontournable : l’intégration, l’apprentissage et la mémoire. Elle confirme que l’IA générative n’est pas bloquée par la technologie, mais par les choix d’architecture, de gouvernance et d’intégration. Pour franchir le fossé du “GenAI Divide”, les entreprises doivent se détourner des outils statiques et des effets d’annonce, et privilégier des systèmes capables d’apprendre, de mémoriser et de s’intégrer dans les flux réels. La valeur ne se situe ni dans les interfaces spectaculaires ni dans les gains symboliques, mais dans l’automatisation silencieuse, la fluidité opérationnelle et la réduction des coûts externes.Ce basculement exige une approche résolument stratégique : rediriger les budgets vers les fonctions à fort levier, choisir des partenaires fiables, et instaurer une culture de l’expérimentation durable. La réussite de l’IA générative ne repose pas sur les promesses des modèles, mais sur la capacité des organisations à créer les conditions de leur apprentissage et de leur évolution dans le temps.