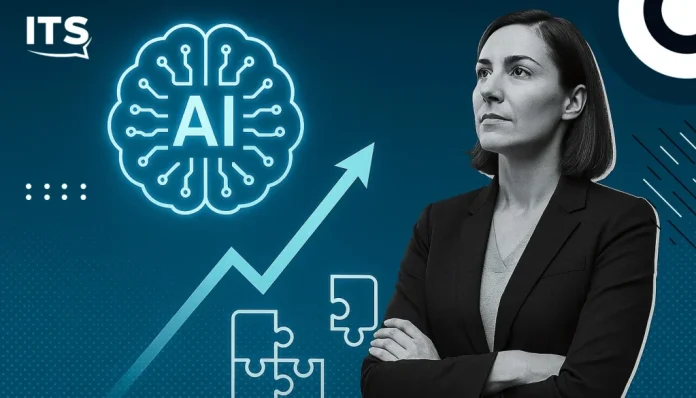Pas moins de 83 % des professionnels RH affirment utiliser l’IA à titre individuel, mais seuls 37 % des services RH disposent d’outils intégrés à leurs processus. Le baromètre 2025 publié par Parlons RH révèle une appropriation massive mais encore inégalement structurée, où les usages personnels précèdent l’acculturation organisationnelle. Derrière cette adoption en catimini, se profile une redéfinition progressive du rôle de la fonction RH à l’ère de l’agentique.
L'irruption de l’intelligence artificielle dans les pratiques professionnelles déstabilise bien des métiers, y compris, et surtout, les services de ressources humaines. D’après le baromètre 2025 publié par Parlons RH, 83 % des professionnels interrogés déclarent utiliser au moins un outil intégrant de l’IA dans leur quotidien, une proportion largement supérieure à celle mesurée dans la population active générale. Mais ce niveau d’usage dissimule un paradoxe structurel : seules 37 % des entreprises ont déployé de tels outils dans leur service RH. Autrement dit, l’acculturation se fait d’abord par la pratique individuelle, souvent via des outils grand public, sans toujours être suivie d’une intégration dans les processus métiers.
Selon l'étude, cette dissociation entre expérimentation personnelle et stratégie d’entreprise s’explique par plusieurs freins bien identifiés : manque de gouvernance des données, préoccupations autour de la confidentialité, faible maturité des éditeurs de SIRH ou absence de cas d’usage clairement formalisés. Dans les PME et les ETI, ces obstacles sont accentués par une transformation des RH encore incomplète, rendant difficile le passage à des usages plus sophistiqués de l’IA. La prudence prévaut donc dans les déploiements collectifs, malgré une appétence individuelle manifeste pour les nouveaux outils.
Entre adhésion, attente et déni, trois profile RH
L’étude propose une typologie éclairante des professionnels RH selon leur rapport à l’IA. Les « EnthousIAstes », qui représentent environ un tiers de l’échantillon, ont déjà intégré l’IA dans leurs pratiques quotidiennes et en perçoivent clairement le potentiel transformateur. À l’autre extrémité du spectre, les « DénIAlistes » — 12 % des répondants — doutent de son intérêt et redoutent ses effets. Entre les deux, une majorité qualifiée d’« HésItAnts » adopte une posture d’observation, voire d’expérimentation ponctuelle, sans réelle transformation en profondeur.
Ce clivage ne recoupe pas nécessairement les tailles des organisations ou les secteurs d’activité. Il reflète plutôt une fracture culturelle dans la manière d’appréhender la transformation numérique : d’un côté, ceux qui explorent l’IA comme une main-d’œuvre intellectuelle à apprivoiser, de l’autre, ceux qui redoutent une substitution ou une dilution des compétences humaines. Cette polarisation pose une question stratégique aux directions RH : comment construire une trajectoire commune de montée en compétence et de structuration des usages dans un contexte aussi fragmenté ?
La création de contenu, cheval de Troie de l’IA dans les RH
Dans les usages recensés, la génération de contenu occupe une place prédominante : 8 des 12 usages les plus répandus concernent la rédaction automatisée de textes (offres d’emploi, courriels RH, supports pédagogiques, questionnaires d’évaluation…). Ces cas d’usage présentent un triple avantage : ils sont facilement accessibles, ne nécessitent pas de restructuration des processus RH et permettent un gain de productivité immédiat. À ce titre, la création de contenu fonctionne comme un cheval de Troie de l’IA dans les RH, ouvrant la voie à une appropriation plus large.
En revanche, les usages d’analyse prédictive, d’interactions automatisées ou de pilotage analytique restent marginaux. Moins de 15 % des entreprises interrogées ont recours à des fonctions avancées, souvent faute d’infrastructure adéquate ou de structuration suffisante de la donnée. Ce déséquilibre entre facilité d’usage et impact stratégique traduit une maturité encore incomplète de la fonction RH face aux potentiel de l’IA. Le risque est de cantonner l’intelligence artificielle à une fonction d’assistance périphérique, sans engagement profond dans les chaînes de valeur RH.
Le recrutement en tête, la formation encore timide
Le domaine du recrutement demeure, sans surprise, le plus transformé par l’IA. Plus de 60 % des organisations l’utilisent pour rédiger des annonces, trier des candidatures ou générer des messages de suivi. Cette antériorité tient à la nature même des tâches (volumineuses, répétitives, semi-structurées) mais aussi à l’émergence précoce de solutions spécialisées dans ce champ. En matière de productivité perçue, le recrutement arrive également en tête, devant la gestion administrative et la formation.
Cette dernière, pourtant identifiée comme un levier clé de transformation, n’est encore exploitée qu’à travers des cas d’usage limités (supports pédagogiques, questionnaires d’évaluation). L’adaptive learning, la personnalisation des parcours ou l’analyse des besoins de montée en compétence restent en retrait. Pourtant, l’intelligence artificielle pourrait y jouer un rôle central, notamment pour relier les référentiels de compétences, les profils des salariés et les dynamiques de marché. Une opportunité encore insuffisamment saisie.
Vers une stratégie IA RH, au-delà des tactiques
Plusieurs répondants insistent sur la nécessité de dépasser une logique d’expérimentations isolées. Pour transformer durablement la fonction RH, il ne suffit pas d’ajouter des fonctions IA à la marge. Il faut repenser l’architecture du SIRH, clarifier les cas d’usage cibles, structurer la donnée et former les équipes à l’interaction agentique. L’agent conversationnel devient, dans ce contexte, non seulement une interface, mais un point d’accès unique aux services RH, accessible à tous les collaborateurs, sans prérequis technique.
La bascule vers cette logique suppose aussi une vigilance éthique renforcée : gouvernance des algorithmes, audit des biais, transparence des décisions automatisées, implication du dialogue social. Le DRH ne peut accompagner la transformation IA sans s’y confronter lui-même. À défaut, la fonction risque d’être dépossédée d’un levier stratégique majeur par d’autres directions plus promptes à en exploiter le potentiel. En somme, l’IA ne remplacera pas la fonction RH, mais elle redéfinit ses contours. Il appartient aux DRH de décider si cette redéfinition se fera avec ou sans eux.