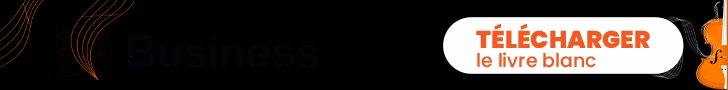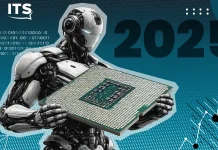A peine trois ans après le raz-de-marée initial, l’intelligence artificielle n’est plus un sujet d’innovation dans les directions marketing. Elle est devenue un socle opérationnel. Une étude SAS – Coleman Parkes dresse un tableau contrasté où l’IA générative se généralise, tandis que l’IA agentique creuse un fossé entre les marques qui investissent, et celles qui hésitent encore.
L’enthousiasme initial pour l’IA a rarement été aussi rapide et structurant que dans les fonctions marketing, et plus généralement digitales. Très tôt identifiée comme terrain d’expérimentation idéal, la discipline a vu fleurir des cas d’usage dès 2023, bien avant d’autres fonctions comme la finance ou les ressources humaines. Deux ans plus tard, les promesses de l’IA générative ne se limitent plus à la réduction des coûts ou à l’automatisation de tâches. Elles s’imposent grâce à des résultats tangibles sur la performance commerciale, la personnalisation, et la fidélisation. En 2025, selon l’étude menée par SAS et Coleman Parkes, l’IA n’est plus une expérimentation : elle est un élément de l’infrastructure marketing moderne.
Avec 85 % d’équipes marketing ayant intégré l’IA générative dans leurs flux de travail quotidiens, la technologie s’impose désormais comme une norme. En un an, l’usage de ces outils a gagné dix points, traduisant une adoption rapide et systématique. Surtout, 93 % des directeurs marketing déclarent en tirer un retour sur investissement mesurable. Ce chiffre dépasse largement les attentes initiales, car, au-delà des gains de productivité, ce sont les effets commerciaux qui marquent les esprits. Près de 9 décideurs sur 10 observent une amélioration directe de la fidélisation client et de la conversion. À cela s’ajoutent des gains structurels : 94 % constatent une meilleure personnalisation, 91 % une efficacité accrue dans le traitement des données, 90 % une réduction des coûts opérationnels.
Un tournant vers l’autonomie assistée : l’IA agentique entre en scène
Le périmètre fonctionnel s’est lui aussi élargi. Si les cas d’usage les plus répandus restent les agents conversationnels (62 %), la génération de contenus (45 %) et l’analyse de tendances (36 %), des applications plus avancées émergent : production de données synthétiques, usage de modèles linguistiques spécialisés ou mise en place de jumeaux numériques pour simuler des parcours clients. Cette diversification indique que l’IA n’est plus perçue comme un levier d’appoint, mais comme un multiplicateur d’impact dans une stratégie marketing globale.
Mais un nouveau seuil est en passe d’être franchi, celui de l’agentivité. Derrière ce terme, se cache une réalité structurante. Les modèles ne se contentent plus de générer des contenus ou de suggérer des optimisations, ils apprennent de manière continue, ajustent les décisions en temps réel et orchestrent des actions complexes. Ces capacités d’autonomie encadrée nécessitent des fondations solides, flux de données unifiés, gouvernance, infrastructure technique, et ne se déploient pas spontanément. C’est pourquoi seuls 21 % des marketeurs interrogés déclarent tester des systèmes d’IA agentique en conditions réelles. Pourtant, parmi ces pionniers, 75 % affirment utiliser l’IA à son plein potentiel.
Cette bascule vers l’agentivité entraîne une reconfiguration des approches : 63 % des « adopteurs »d’IA agentique ont mis en œuvre une stratégie IA à l’échelle de l’entreprise, contre seulement 25 % chez les « observateurs ». La différence est encore plus marqué sur l’orchestration des campagnes : 42 % des adopteurs mobilisent l’IA pour prendre des décisions en temps réel, contre 1 % des observateurs. Le passage à l’agentivité agit ainsi comme un révélateur de maturité organisationnelle, et comme un accélérateur de performance concurrentielle.
Des écarts de maturité qui dessinent une nouvelle fracture
L’étude établit une typologie désormais structurante. Entre les adopteurs, qui ont franchi le cap de l’IA agentique ; les planificateurs, qui comptent l’adopter dans l’année ; et les observateurs, qui se projettent à deux ans. Cette classification ne reflète pas uniquement des choix technologiques, mais une posture stratégique. Chez les adopteurs, la culture technologique irrigue les prises de décision, 61 % d’entre eux disent comprendre clairement les enjeux de l’IA agentique, contre seulement 3 % chez les observateurs. L’écart de compétence se double ainsi d’un écart de projection.
La conséquence est directe sur le terrain pour les adopteurs, qui déploient des cas d’usage avancés comme des agents d’apprentissage continu (47 %) ou des systèmes de reporting autonomes (45 %), quand les observateurs en restent à des expérimentations ponctuelles, souvent cantonnées à la génération de contenu. Cette polarisation du paysage marketing pourrait entraîner, à moyen terme, un décrochage concurrentiel durable. Pour les marques qui tardent à structurer leur trajectoire IA, le risque n’est plus de rater une opportunité, il est de perdre un avantage stratégique devenu central.
La confiance reste conditionnelle, la gouvernance décisive
Malgré l’emballement autour des bénéfices, une prudence persiste quant à la confiance accordée aux systèmes autonomes. Si 90 % des marketeurs déclarent faire confiance à l’IA agentique à un certain niveau, moins de 5 % expriment une confiance totale. Ce paradoxe illustre une tension croissante entre la puissance des outils et les impératifs de gouvernance. La mise en œuvre de mécanismes de supervision humaine, de validation des recommandations et de traçabilité des décisions devient une priorité.
79 % des répondants se disent globalement confiants dans leur gouvernance de l’IA, mais peu expriment une certitude forte – ce qui ouvre un espace critique pour les fonctions conformité, risques et DSI. À mesure que les systèmes deviennent plus autonomes, la question n’est plus seulement de savoir ce que fait l’IA, mais dans quelles conditions elle le fait, selon quelles règles, avec quels garde-fous. Le marketing, longtemps perçu comme domaine créatif, devient ainsi un terrain d’enjeux de contrôle algorithmique et de régulation éthique.
Un marketing quantique ? Les pionniers préparent déjà l’après
Fait notable de l’étude, 50 % des adopteurs d’IA agentique déclarent avoir déjà intégré le calcul quantique dans leur feuille de route. Ce chiffre, surprenant au premier abord, traduit une logique d’anticipation : dans un futur proche, le fonctionnement de centaines d’agents IA en parallèle, capables de produire des audiences, d’orchestrer des recommandations, d’optimiser des parcours en temps réel, nécessitera une capacité de calcul que seuls les environnements quantiques pourront soutenir.
Les cas d’usage envisagés varient selon les secteurs : la banque mise sur l’analyse prédictive, l’assurance sur la simulation de parcours, les sciences de la vie sur la personnalisation à grande échelle. Même les petites entreprises commencent à identifier des bénéfices concrets, notamment dans la génération de données synthétiques. Pour ces organisations, la maturité IA devient un tremplin vers des technologies autrefois jugées lointaines. Ce mouvement révèle une dynamique structurante : l’IA agentique n’est pas un aboutissement, mais une étape vers un marketing computationnel étendu.