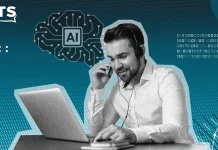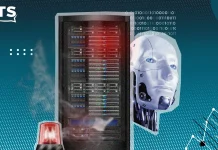Selon le baromètre RSE 2025 de Wavestone et l’ORSE, les entreprises européennes franchissent un cap en matière de transformation durable, en structurant mieux leurs démarches, en intégrant la donnée ESG dans les processus de décision, et en explorant les apports de l’intelligence artificielle. Mais l’étude révèle aussi des freins persistants, notamment dans la gouvernance des données, l’outillage et les compétences internes.
L’intégration de la responsabilité sociétale dans la gouvernance et les métiers ne relève plus du simple affichage. La directive CSRD, devenue réalité en 2025, agit comme un catalyseur pour outiller, structurer et rendre mesurables les engagements des entreprises. Wavestone et l’Observatoire de la RSE (ORSE) publient une étude inédite menée auprès de 359 responsables RSE et ESG en France, Allemagne et Royaume-Uni. Elle met en lumière une dynamique européenne contrastée, mais de plus en plus pilotée par la donnée, et de plus en plus sensible aux risques associés à l’usage de l’IA.
77 % des répondants considèrent que la RSE est davantage intégrée dans la gouvernance que les années précédentes. En France, cette évolution reste plus nuancée (68 %) qu’au Royaume-Uni (89 %) ou en Allemagne (76 %), un écart qui s’explique en partie par le niveau d’exigence imposé par la CSRD. Ce cadre réglementaire pousse les organisations françaises à structurer leur démarche, mais révèle aussi les écarts entre ambitions déclarées et moyens disponibles.
La donnée ESG devient une composante centrale du pilotage
Du côté des métiers, la fonction Achats fait figure de chef de file, suivie par les ressources humaines et les directions stratégiques. Mais la transformation demeure partielle : 34 % des fonctions juridiques et 20 % des fonctions marketing ne montrent aucun progrès selon leurs propres répondants. Le manque de ressources humaines, de temps et d’expertise apparaît comme le premier frein, en particulier dans les secteurs des transports et des services financiers. L’étude révèle également que les directions RSE françaises sont davantage confrontées aux limites organisationnelles que leurs homologues européennes, signe d’un degré d’opérationnalisation plus avancé… et donc plus confronté aux obstacles structurels.
Près des trois quarts des entreprises interrogées prévoient d’investir dans des outils ESG d’ici fin 2026. L’objectif dépasse désormais la seule conformité réglementaire, car la moitié des entreprises françaises placent la performance ESG comme motif principal de collecte des données, avant la CSRD. Cette bascule vers une logique de pilotage transforme le rôle des directions RSE, de plus en plus intégrées aux réflexions stratégiques, souvent en collaboration avec les directions financières ou numériques.
Mais les outils demeurent fragmentés. Moins d’un quart des répondants jugent leurs solutions mal adaptées, pourtant plus de la moitié pointent des difficultés d’intégration entre systèmes, une faible homogénéité des données, et un manque de compétences internes pour les exploiter. L’usage d’outils développés en interne reste courant dans l’industrie, tandis que la distribution privilégie les solutions du marché. En France, le recours aux tableurs reste plus répandu qu’en Allemagne ou au Royaume-Uni, traduisant une transition encore inachevée vers des systèmes ESG pleinement intégrés.
Les entreprises françaises anticipent la règlementation
Pas moins de 52 % des entreprises françaises déclarent avoir mis en place une gouvernance dédiée à la gestion des données ESG, contre 36 % au Royaume-Uni et 12 % en Allemagne. Ce positionnement plus avancé résulte directement de l’anticipation réglementaire. Il se traduit par une meilleure articulation entre la RSE et la finance, comme l’illustre le Groupe La Poste avec son budget climat intégré, ou AXA France, où la direction financière pilote le reporting extra-financier en lien étroit avec la direction RSE.
Pour autant, cette gouvernance reste en chantier. La complexité des chaînes de collecte, la dépendance aux données externes, notamment clients, ou encore la difficulté à mesurer l’impact réel des actions menées, freinent l’émergence d’un pilotage pleinement extra-financier. Certaines entreprises, comme Sanofi ou La Poste, entament une transition vers des systèmes intégrés avec data lake, dictionnaires de données et tableaux de bord ESG, mais ces pratiques demeurent encore minoritaires.
L’intelligence artificielle, nouvel allié… sous conditions
Là encore, 74 % des entreprises déclarent que leur direction RSE est impliquée dans les réflexions sur l’usage éthique de l’IA générative. Cette implication croissante marque un tournant stratégique. L’IA devient un levier pour améliorer la robustesse des indicateurs, accélérer la détection des signaux faibles, fiabiliser les trajectoires climat et renforcer la traçabilité. Elle permet aussi de fluidifier le reporting, notamment via des agents capables d’extraire, de consolider et de modéliser les données ESG.
Mais l’étude insiste sur les risques psychosociaux encore peu documentés : surcharge cognitive, perception d’une IA opaque ou mal contrôlée, tensions dans les processus de décision. Ces effets collatéraux soulignent la nécessité d’un cadrage rigoureux, tant technique qu’éthique. Les directions RSE sont appelées à jouer un rôle de vigie dans la mise en œuvre de l’IA, en veillant à ce qu’elle ne vienne pas affaiblir la légitimité de la démarche RSE, au contraire, en renforcer la pertinence et la portée.
Le baromètre 2025 dessine une ligne de crête. D’un côté, l’ambition déclarée progresse, la structuration des outils s’accélère, et la gouvernance de la donnée gagne en maturité. De l’autre, les freins opérationnels, humains et techniques persistent. Ce décalage appelle un alignement stratégique fort : la RSE ne peut plus être cantonnée à une fonction support, ni à un impératif réglementaire. Elle devient un langage commun entre directions, un facteur de compétitivité à part entière, et un catalyseur de résilience face aux crises systémiques. Pour y parvenir, les entreprises devront faire émerger une comptabilité extra-financière aussi robuste que la finance traditionnelle, pilotée par des indicateurs intégrés, et soutenue par une infrastructure outillée, éthique et interopérable.