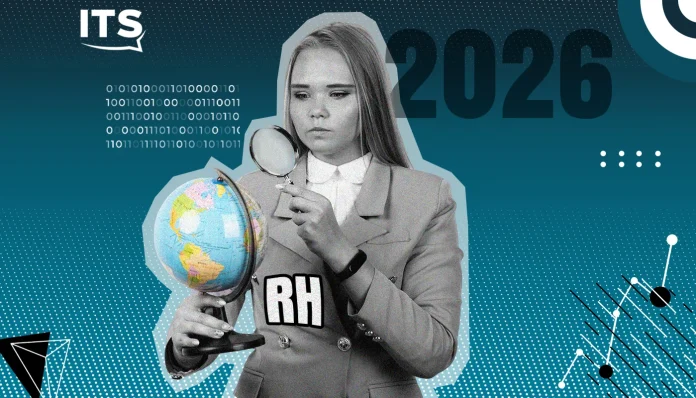Le télétravail international change d’échelle. Selon l’étude Global Workforce Report 2025 de Remote, deux tiers des futures embauches en France seront réalisées hors des frontières nationales. Cette recomposition accélérée du marché du travail oblige les entreprises à repenser leurs outils de gestion, leur stratégie de conformité et leur ancrage économique.
La pénurie de talents n’est plus une contrainte locale, elle redessine les contours du recrutement à l’échelle mondiale. Dans un contexte marqué par la tension sur les profils qualifiés, les entreprises françaises reconfigurent leurs pratiques pour accéder à un vivier de compétences désormais mondialisé. L’étude menée par Remote auprès de 3 650 responsables RH dans dix pays documente cette inflexion majeure, où le recrutement international cesse d’être une exception marginale pour devenir un levier stratégique de croissance.
Les entreprises françaises anticipent une bascule rapide de leur politique RH. D’après l’enquête, 65 % des nouvelles embauches prévues en 2026 concerneront des talents localisés hors de France. En d’autres termes, le recrutement international pourrait dès l’an prochain dépasser en volume les embauches locales. Cette évolution traduit une adaptation aux tensions persistantes sur le marché du travail : 81 % des répondants déclarent rencontrer davantage de difficultés qu’un an plus tôt pour trouver des profils qualifiés dans l’Hexagone.
Un avantage compétitif freiné par la complexité réglementaire
La dynamique ne se limite pas à la France. Les Pays-Bas (65 % des entreprises ayant recruté à l’étranger au cours des six derniers mois), la Suède (57 %) et l’Allemagne (53 %) figurent parmi les pays les plus engagés dans cette transition. D’autres régions, comme Singapour ou la Corée du Sud, affichent également une appétence élevée, avec près d’une entreprise sur deux adoptant une approche transfrontalière. L’Australie, en revanche, se montre plus prudente avec seulement 34 % de recrutements internationaux récents.
Si le travail sans frontières séduit, sa mise en œuvre reste semée d’embûches. En France, 85 % des responsables RH pointent les contraintes juridiques locales comme un frein à l’embauche. Les règles de conformité, souvent contradictoires d’un pays à l’autre, complexifient la gestion des contrats, de la paie et des obligations fiscales. L’enjeu devient rapidement financier : 84 % des entreprises ayant déjà recruté à l’international ont rencontré des problèmes de conformité, et 40 % estiment que ces difficultés leur ont coûté plus de 50 000 dollars.
Pour faire face à ces obstacles, les plateformes de gestion RH unifiée comme Remote, Deel ou Oyster se positionnent comme des solutions d’infrastructure. En centralisant la gestion de la paie, des contrats et des droits sociaux dans une interface unique, elles promettent de réduire le coût d’entrée dans le recrutement globalisé. Mais elles posent aussi des questions de gouvernance, notamment sur la localisation des données, la résilience juridique et l’interopérabilité avec les outils métiers existants.
Vers une nouvelle géopolitique des talents et des revenus
Au-delà des outils, la tendance structurelle redéfinit les flux économiques mondiaux. Comme le souligne Barbara Matthews, directrice des ressources humaines de Remote, « les talents qui, autrefois, devaient s’expatrier pour accéder à de meilleures opportunités peuvent désormais travailler pour des entreprises internationales sans quitter leur pays ». Cette logique permet aux économies émergentes de capter une part croissante des revenus issus de l’économie numérique, sans perte de capital humain.
À terme, cette rétention des compétences dans les pays d’origine pourrait atténuer les effets du brain drain et redistribuer les moteurs de la croissance. En permettant à des développeurs colombiens, à des analystes kenyans ou à des chefs de projet vietnamiens de collaborer à distance avec des entreprises européennes ou américaines, le télétravail structuré devient un vecteur d’inclusion économique, mais aussi un levier de compétitivité pour les employeurs en quête d’agilité opérationnelle et budgétaire.
Une gouvernance RH à repenser en profondeur
Cette reconfiguration appelle une modernisation accélérée de la gouvernance RH. Les directions des ressources humaines, de la conformité et des systèmes d’information doivent désormais composer avec une diversité de cadres réglementaires, de devises, de régimes sociaux et de fuseaux horaires. La montée en compétence sur les enjeux transnationaux devient incontournable, tout comme l’intégration d’outils capables de croiser gestion des talents, planification stratégique et conformité automatisée.
Pour les DSI et les architectes SI, le défi réside dans la capacité à interconnecter les plateformes de gestion internationale avec les systèmes existants, sans multiplier les redondances ni compromettre la sécurité des données. Ce basculement met aussi en lumière un besoin de transparence accrue dans les politiques de rémunération, la gestion des écarts salariaux et la protection sociale des équipes distribuées. L’enjeu n’est plus seulement technique ou réglementaire, mais organisationnel et culturel.
Des opportunités majeures pour les fournisseurs de solutions RH
Cette accélération du recrutement transfrontalier ouvre un espace stratégique pour les éditeurs de logiciels, les plateformes de services RH, les cabinets de conseil et les opérateurs de paie. En articulant automatisation, conformité multinationale et modularité, les solutions les plus adaptées permettront aux entreprises de sécuriser leurs recrutements sans freiner leur expansion. Elles doivent toutefois prouver leur capacité à gérer la complexité croissante de l’environnement réglementaire global, tout en restant interopérables et évolutives.
Cette reconfiguration ne s’opère toutefois pas dans un vide politique. Plusieurs gouvernements, en Europe comme ailleurs, renforcent leurs exigences en matière d’emploi local, y compris pour les contrats à distance. Des dispositifs de préférence nationale, ou des restrictions fiscales sur les contrats transfrontaliers, émergent dans certains pays. Dans ce climat, la promesse d’un travail véritablement déterritorialisé entre en tension avec la résurgence de politiques protectionnistes, souvent justifiées par la pression sur l’emploi local. Ces frictions pourraient ralentir, voire contraindre, l’élargissement des viviers internationaux, en particulier pour les profils surqualifiés, exclus des marchés domestiques malgré leur compétence.
L’étude de Remote illustre ainsi une transition d’ampleur qui redéfinit à la fois les pratiques, les outils et les finalités de la fonction RH. Elle révèle aussi, en creux, la dépendance croissante des entreprises à des tiers technologiques spécialisés dans la gestion du travail globalisé. Ce nouveau paradigme implique une vigilance accrue sur la souveraineté opérationnelle, la maîtrise des données et la capacité à faire évoluer les politiques internes en phase avec la réalité d’un marché du travail désormais planétaire.