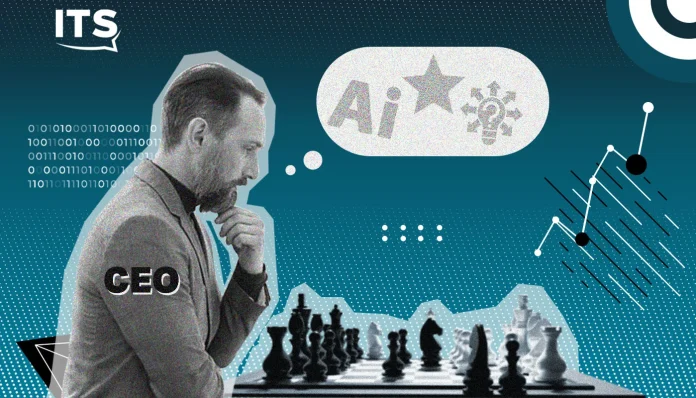Le baromètre mondial « CEO Outlook 2025 » de KPMG révèle une inflexion nette dans les priorités des dirigeants d’entreprise. Dans un contexte de défiance économique et de fragmentation géopolitique, l’intelligence artificielle, la montée en compétences des collaborateurs et l’agilité organisationnelle s’imposent comme leviers convergents d’adaptabilité et de performance.
La 11ᵉ édition du CEO Outlook de KPMG, menée auprès de 1 350 dirigeants dans onze pays du G7 et au-delà, interroge le nouveau rapport des chefs d’entreprise à l’incertitude. En 2025, l’environnement macroéconomique combine instabilité géopolitique, tension sur les chaînes d’approvisionnement, exigences climatiques accrues et transformation numérique accélérée. Le niveau de confiance des CEO dans l’économie mondiale chute à 68 %, son plus bas niveau depuis cinq ans. Mais paradoxalement, cette défiance n’entame pas la dynamique d’investissement ni l’optimisme quant à la résilience interne des entreprises. C’est sur les capacités d’adaptation stratégique, technique et humaine que se joue la différenciation concurrentielle.
Cette tension entre résilience attendue et incertitude chronique se reflète dans les arbitrages des dirigeants. L’étude met en lumière trois axes structurants : l’investissement dans l’IA, la transformation du rôle managérial, et l’attention renforcée portée aux talents. Ces trois dimensions ne s’opposent plus, mais convergent. L’IA est perçue comme un levier d’agilité autant que de performance ; les talents comme facteur décisif d’adoption technologique. Le dirigeant, quant à lui, devient à la fois stratège, pédagogue et garant d’une trajectoire crédible dans un environnement mouvant.
Une IA perçue comme vecteur de croissance, pas de substitution
Pour 71 % des CEO interrogés, l’intelligence artificielle reste une priorité d’investissement en 2026. 69 % prévoient d’y consacrer entre 10 et 20 % de leur budget dans les douze mois à venir. Ce choix massif, confirmé pour la deuxième année consécutive, témoigne d’une conviction désormais partagée : l’IA ne se résume plus à une série de cas d’usage ponctuels, elle redéfinit les conditions structurelles de la compétitivité. L’étude révèle par ailleurs une inflexion notable du discours sur les effets organisationnels de l’IA. Alors que le débat public continue d’associer automatisation à disparition d’emplois, les dirigeants interrogés valident un scénario inverse : 92 % d’entre eux, en moyenne, prévoient d’augmenter leurs effectifs dans l’année, et considèrent l’IA comme un levier d’expansion, pas de substitution.
Cette tendance s’accompagne d’un repositionnement stratégique des politiques RH. 79 % des dirigeants affirment que l’IA les a conduits à repenser la formation et le développement des compétences. Ce chiffre souligne une évolution culturelle : l’intégration de l’IA n’est plus confiée aux seuls experts techniques, elle irrigue les fonctions transverses, les métiers opérationnels et la gouvernance. La capacité à articuler outil, stratégie et transformation humaine devient un facteur clé de passage à l’échelle. L’IA s’impose ainsi comme un moteur de transformation organique, plutôt qu’un simple catalyseur technologique.
Talents et adaptabilité : la nouvelle équation RH des dirigeants
La formation continue et la rétention des talents à fort potentiel constituent désormais une priorité pour 77 % des dirigeants à l’échelle mondiale, et pour 68 % en France. Cette focalisation s’explique par une double pression : d’une part, la complexité croissante des technologies mobilisées impose un upskilling permanent ; d’autre part, la volatilité du marché du travail, combinée à une exigence accrue de sens et d’impact, rend les stratégies d’attractivité plus difficiles à stabiliser. Dans ce contexte, l’alignement entre stratégie IA et stratégie RH devient une exigence opérationnelle : la réussite des projets d’IA repose tout autant sur les compétences que sur l’adhésion des équipes.
76 % des dirigeants affirment disposer d’une organisation déjà structurée pour former efficacement leurs collaborateurs à l’usage de l’IA. Ce chiffre masque cependant des écarts notables selon les secteurs, la taille des entreprises et les territoires. La convergence des dynamiques IA, RH et ESG place le dirigeant au cœur d’un triangle stratégique inédit, dans lequel chaque décision technologique appelle un arbitrage managérial. Ce mouvement s’accélère dans les entreprises fortement exposées à la transformation numérique ou à la régulation extrafinancière.
Un rôle dirigeant en extension face à la défiance institutionnelle
L’étude de KPMG souligne une évolution structurelle du rôle du dirigeant dans la sphère publique. 72 % des dirigeants français estiment que la perte de confiance des citoyens dans l’action publique renforce les attentes sociétales envers les entreprises. Ce chiffre est supérieur à la moyenne mondiale (63 %), ce qui témoigne d’un glissement plus net en France du rôle de l’entreprise comme repère, voire substitut, dans la prise en charge de certaines problématiques collectives. Cette attente nouvelle modifie en profondeur le rapport des dirigeants à la communication, à la responsabilité et à la régulation.
Les trois qualités désormais les plus attendues d’un dirigeant sont : une meilleure agilité décisionnelle (29 %), une compréhension fine des cadres réglementaires (25 %), et une communication plus transparente (24 %). Ces critères ne relèvent plus seulement du leadership, mais d’une capacité à intégrer dans la stratégie d’entreprise des dimensions externes traditionnellement attribuées aux institutions publiques. Ce changement de focale renforce l’importance de la posture dirigeante dans les arbitrages IA, ESG ou RH. Le dirigeant devient un acteur de stabilité dans un monde fluide, ce qui implique une capacité d’anticipation et une cohérence de trajectoire rarement atteintes auparavant.
Spécificités françaises : ROI, exigence et repositionnement sociétal
Trois particularités émergent pour la France dans cette édition 2025. Premièrement, une exigence de retour rapide sur investissement en IA. Pas moins de 84 % des dirigeants français attendent des résultats en moins de trois ans, contre moins d’un quart un an plus tôt. Deuxièmement, une lucidité accrue sur le repositionnement de l’entreprise comme acteur sociétal, dans un contexte de perte de confiance envers l’État. Troisièmement, un attachement plus marqué à la formation humaine comme levier de compétitivité durable. Ces signaux dessinent une ligne stratégique française centrée sur l’alignement entre rentabilité, responsabilité et engagement collectif.
Marie Guillemot, présidente du Directoire de KPMG France, résume ainsi cette transformation : « Dans un environnement darwinien où l’incertitude et la disruption sont devenues la règle, les dirigeants des grandes économies restent confiants pour leurs entreprises parce qu’ils font de l’adaptabilité leur nouveau paradigme ».