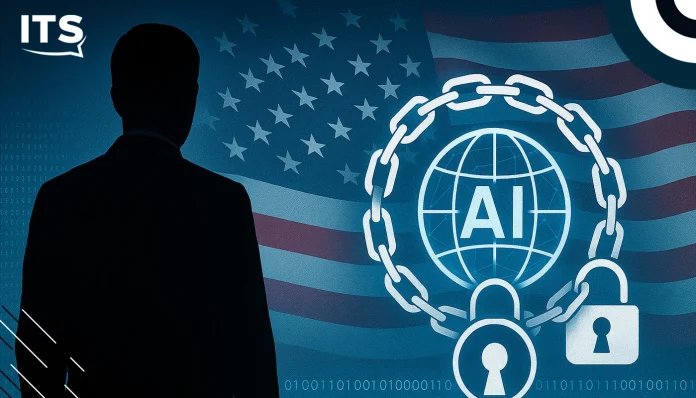Dès les premières lignes, le ton est donné et la stratégie de domination technologique pleinement assumée : l’objectif est de « maintenir une domination technologique mondiale incontestée ». Dans la bouche du président Trump, l’IA est présentée comme la clé d’une nouvelle ère de prospérité, mais aussi comme un levier stratégique pour reconfigurer les rapports de force globaux. Le document dresse un parallèle explicite avec la course à l’espace du XXe siècle : celui qui contrôle les écosystèmes de l’IA en fixera les standards, captera les bénéfices économiques et garantira sa sécurité nationale.
Cette vision techno-souverainiste repose sur une conviction simple : la puissance technologique est désormais la condition première de l’indépendance politique, de la prospérité industrielle et de la sécurité militaire. Ce plan procède d’une vision profondément égocentrée du monde, où les relations internationales sont perçues non comme des espaces de coopération ou de codéfinition des normes, mais comme des arènes de confrontation où seul compte le rapport de force.
La matrice idéologique sous-jacente relève d’un unilatéralisme affirmé : les États-Unis y sont présentés comme le centre naturel de l’innovation, le garant des « vraies » valeurs et le seul acteur légitime pour fixer les règles de l’ère numérique. Le multilatéralisme, les codes de conduite internationaux ou les principes éthiques globaux sont soit ignorés, soit disqualifiés comme étant les vecteurs d’agendas idéologiques étrangers, notamment chinois ou européens.
Déréguler à tout va pour « accélérer l’innovation »
Le premier pilier du plan consiste à « accélérer l’innovation en IA » en supprimant les obstacles réglementaires. L’administration Trump abroge les directives prises sous l’administration Biden, accusées d’entraver les initiatives privées. La doctrine est claire : l’État fédéral ne doit pas interférer avec le marché, mais lui fournir les conditions d’une croissance accélérée. Les financements publics sont conditionnés à la souplesse réglementaire des États bénéficiaires, incitant à une déréglementation coordonnée.Dans le même esprit, le plan soutient les modèles ouverts alignés sur les « valeurs américaines » et promeut un environnement favorable aux startups via l’ouverture de capacités de calcul, la création de marchés financiers pour la location de ressources, et le déploiement de centres de test sectoriels. La notion de « regulatory sandbox » devient ici un outil d’incitation à l’expérimentation rapide, notamment dans la santé,
l’agriculture et l’énergie.
Infrastructures souveraines et réindustrialisation stratégique
Le deuxième pilier repose sur la construction d’une infrastructure complète pour l’IA, des semiconducteurs jusqu’à l’énergie. L’administration relance un programme massif de simplification administrative pour accélérer les permis de construire de centres de données, d’usines de puces, et de centrales énergétiques. Le nucléaire, la géothermie et les sources pilotables sont à nouveau mis en avant, au nom de la sécurité énergétique de l’IA.La stratégie prévoit également la réintégration complète de la chaîne de valeur des semiconducteurs sur le territoire américain, avec un recentrage du programme CHIPS vers le rendement sur investissement et l’élimination des exigences sociales ou climatiques. Ce recentrage illustre la volonté de sanctuariser une base industrielle totalement alignée avec la conception « trumpienne » des impératifs de sécurité nationale.
Vers une IA alignée sur les « valeurs américaines »
Le plan revendique une ligne idéologique claire : les systèmes d’IA doivent promouvoir la liberté d’expression et « refléter objectivement la vérité plutôt que des agendas de réingénierie sociale ». Cela se traduit par la suppression explicite des références à la diversité, à l’inclusion ou au changement climatique dans les cadres de référence officiels comme le NIST AI RMF.Le gouvernement fédéral n’achètera plus de modèles jugés biaisés idéologiquement et mènera des audits pour détecter les « alignements avec les éléments de langage du Parti communiste chinois ». Cette approche illustre une volonté d’imposer un référentiel culturel américain dans les systèmes d’intelligence artificielle, y compris exportés.
Diplomatie technologique et endiguement géopolitique
Le troisième pilier — diplomatie et sécurité — expose une doctrine d’exportation stratégique : les États-Unis doivent diffuser leur pile technologique IA complète (puces, modèles, logiciels, standards) auprès de leurs alliés, et empêcher leur dépendance à des technologies venues de Chine. Pour cela, l’administration mise sur des mécanismes de financement, d’exportation contrôlée, et sur l’influence dans les instances normatives internationales.La logique est celle d’une structuration des blocs : bloc américain adossé aux Five Eyes (l'alliance internationale de renseignement) et au G7 d’un côté, bloc chinois de l’autre, et un bloc européen en position marginale s’il persiste à privilégier les approches réglementaires et éthiques. Le plan vise à court-circuiter les normes européennes en créant un effet d’entraînement mondial autour des standards américains.
Une militarisation assumée de l’IA
Le département de la Défense et les agences de renseignement jouent un rôle central dans la stratégie IA du gouvernement. Les recommandations incluent la construction de centres de données classifiés, la création de champs de test virtuels pour systèmes autonomes, la priorisation de l’IA dans les formations militaires et l’intégration de mécanismes d’IA dans les systèmes critiques.Les menaces identifiées incluent les risques liés à la biosécurité, aux cyberattaques et à l’adoption de systèmes étrangers. Le plan prévoit des mesures spécifiques de détection de portes dérobées, des évaluations nationales de sécurité sur les modèles de pointe, et la création de standards d’évaluation partagés entre agences de défense et laboratoires civils.
Vers une polarisation technologique mondiale ?
Ce plan procède d’une vision profondément unilatéraliste du monde, où les relations internationales sont perçues non comme des espaces de coopération ou de codéfinition des normes, mais comme des arènes de confrontation où seul compte le rapport de force. La matrice idéologique sous-jacente relève d’un unilatéralisme affirmé : les États-Unis y sont présentés comme le centre naturel de l’innovation, le garant des « vraies » valeurs et le seul acteur légitime pour fixer les règles de l’ère numérique.Il transforme l’IA en champ de confrontation entre puissances et promeut une doctrine de techno-domination américaine fondée l’exportation normative vers des alliés consentants. Le multilatéralisme, les codes de conduite internationaux ou les principes éthiques globaux sont soit ignorés, soit disqualifiés comme étant les vecteurs d’agendas idéologiques étrangers, notamment chinois ou européens.
Pour l’Europe, ce virage ne laisse plus aucun doute sur la voie à suivre, sous peine de vassalisation technologique : articuler ambition éthique, industrialisation et compétitivité dans un monde où l’IA devient une arme d’influence. L’exportation de « packages IA » américains conditionnés à l’adoption de standards, de modèles et d’infrastructures made in USA est une tentative de vassalisation technologique forcée.
Une stratégie fondée sur l’unilatéralisme technologique et qui devrait susciter un réflexe de désalignement croissant chez les alliés, en particulier en Europe et dans les pays émergents. À terme, cela pourrait accélérer la formation de coalitions alternatives ou de blocs techno-industriels cherchant à s’émanciper de l’hégémonie américaine, comme le suggèrent déjà les dynamiques autour de l’IA open source souveraine en Europe ou les initiatives sino-russes dans les instances de normalisation.
Et la France dans tout cela ?
La France se distingue des autres pays européens par sa capacité à théoriser et défendre son autonomie stratégique. Elle dispose d’une industrie de défense souveraine, d’une tradition d’ingénierie d’État, d’un appareil diplomatique actif, et d’une sensibilité forte aux enjeux de souveraineté numérique. Sans la France, l’Europe serait totalement absente de certains domaines vitaux comme l’aéronautique et l’espace. Cette posture lui donne une capacité de résistance effective que d’autres pays européens, plus dépendants technologiquement ou moins portés sur ces questions, n’ont pas.Alors que les géants américains structurent un écosystème fermé autour de leurs modèles, normes et infrastructures, la fragmentation du cyberespace se double désormais d’une polarisation technologique. Dans le monde que dessine le plan américain, l’indépendance technologique européenne ne peut être que collective. Elle se construit activement face à une logique d’hégémonie qui ne laisse que deux options aux pays tiers : s’aligner ou résister. Il y a une troisième voie : s’allier.
L’IA est devenue un facteur structurant de l’ordre mondial. Le plan américain en donne aujourd’hui la démonstration la plus explicite. Toutefois, une hégémonie technologique qui néglige la diversité culturelle et politique finit toujours par susciter des dynamiques de contournement. La France, historiquement attachée à sa singularité stratégique, a un rôle primordial à jouer : servir d’exemple et entraîner d’autres partenaires européens vers une stratégie concertée.