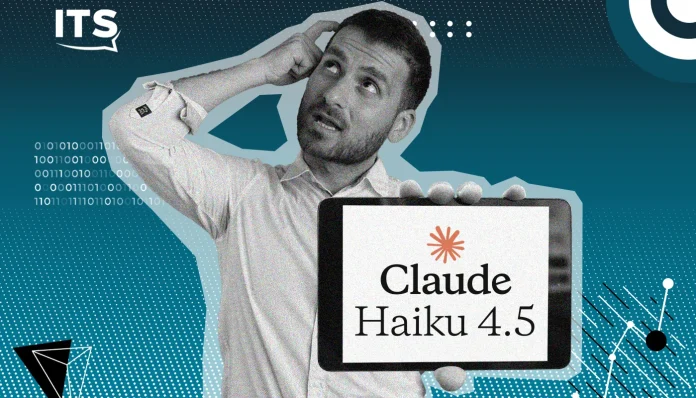Tandis que le Model Context Protocol s’impose comme un standard implicite pour structurer l’environnement des agents IA, une autre logique gagne du terrain : celle des « habiletés » encapsulées, ou « skills », conçues pour transmettre un savoir-faire opérationnel aux modèles de langage. Cette divergence structure le débat sur les futurs modèles agissants, entre gouvernance déclarative et coordination autonome.
L’efficacité d’un agent IA ne dépend plus seulement de son modèle linguistique, mais de sa capacité à interagir avec son environnement, à accéder aux ressources, à exécuter des tâches ciblées. Le Model Context Protocol (MCP), proposé par Anthropic, formalise cette interopérabilité. Il décrit la manière dont un agent peut accéder à une ressource externe, qu’il s’agisse d’une API, d’un jeu de données, ou d’un outil distant, en précisant les entrées attendues, les formats de réponse, les conditions d’usage et les dépendances. Ce protocole ne détermine pas ce que l’agent doit faire avec cette ressource : il structure uniquement le cadre dans lequel l’outil devient mobilisable.
Plusieurs fournisseurs majeurs se sont alignés sur cette logique, sans toujours nommer le MCP. Salesforce l’a traduite à travers AgentForce Vibes et MuleSoft Agent Fabric, qui exposent des services métiers activables par des agents spécialisés. Google intègre une couche contextuelle analogue dans Gemini Enterprise, avec des profils attribuant rôles, outils et droits à chaque agent. Slack, en exploitant ses flux conversationnels comme moteur contextuel, rend possible l’appel conditionnel à des fonctions IA. OutSystems, enfin, se repositionne comme middleware programmable, avec une gestion explicite des dépendances, des schémas d’entrée-sortie et de la mémoire d’exécution. Tous convergent vers une organisation où l’accès aux fonctions passe par un protocole structuré et interprétable par l’IA.
Les « habiletés », vecteurs d’un comportement agentique programmable
Cette standardisation ascendante repose sur une hypothèse généralement admise : en modélisant l’environnement, on permet à un agent d’agir de façon contrôlée. Mais elle ne dit rien de l’intention de l’agent ni de sa stratégie d’exécution. C’est ici que la notion d’habileté (« skills ») prend le relais, selon une logique radicalement différente.
Avec Claude Skills, Anthropic introduit une rupture. Il ne s’agit pas de référencer un outil, mais de transmettre un savoir-faire à un agent, sous forme d’un fichier autonome — généralement en markdown — que le modèle peut interpréter et appliquer. En pratique, une habileté encapsule une logique métier, une séquence d’actions, une manière de résoudre un problème. Contrairement au MCP, elle ne décrit pas un environnement, mais un comportement à adopter. Elle agit comme une extension cognitive du modèle, non comme une interface technique.
Cette distinction est majeure. Le MCP permet de dire à un agent « ce qui est disponible » ; une habileté lui dit « comment s’y prendre ». En combinant les deux, on obtient une IA capable d’identifier les outils pertinents et de les utiliser à bon escient. Mais ce couplage n’est pas systématique. Un agent peut aussi exécuter une habileté sans faire appel à une ressource externe, simplement en suivant un protocole comportemental intégré.
Entre coordination outillée et intelligence distribuée
L’apparition des habiletés redessine le paysage de l’agentification. D’un côté, on observe un mouvement vers la gouvernance des interactions : MCP, sandboxing, permissions, auditabilité. De l’autre, un déplacement vers des IA capables de raisonner en autonomie, de coordonner plusieurs habiletés, voire de collaborer avec d’autres modèles spécialisés. Cette seconde voie n’exige pas toujours une interopérabilité formelle. Elle mise sur la compatibilité cognitive entre agents, parfois sans protocole d’échange explicite.
Des expérimentations comme les agents collectifs d’OpenAI, les grappes spécialisées de Google ou les chaînes d’exécution multimodèles testées dans des environnements de simulation montrent que la coopération inter-agent peut émerger par simple coordination sémantique. Cela contourne en partie la logique du MCP, en transférant la charge de l’orchestration du protocole vers le modèle lui-même. Si cette approche s’impose, elle pourrait marginaliser le standard de contextualisation, ou le réduire à un rôle technique en arrière-plan.
La fin programmée des applications métier déterministes
Ce basculement ouvre une perspective plus large. Celle d’une substitution progressive des applications métier classiques par des agents outillés, reconfigurables à la demande. Là où un ERP applique des règles codées, un agent peut recomposer les étapes d’un processus à partir de ses habiletés, en fonction du contexte, de l’intention et des résultats intermédiaires. Cela permet une personnalisation extrême, mais impose de nouveaux cadres de vérification, de validation et de responsabilité.
L’entreprise n’interagit plus avec un logiciel, mais avec un comportement. Elle ne configure plus une suite applicative, mais un système d’actions potentielles. Dans ce cadre, la valeur ne réside plus dans le code, mais dans la capacité à décrire, encapsuler et orchestrer les habiletés pertinentes. MCP et Claude Skills deviennent deux composantes complémentaires : l’un structure l’environnement, l’autre enrichit la palette des comportements disponibles.
Une grammaire à maîtriser pour éviter la désintégration fonctionnelle
Cette double évolution — standardisation implicite par le MCP, explosion des habiletés injectables — transforme en profondeur la manière dont l’IA s’intègre dans les systèmes d’information. À court terme, les entreprises devront composer avec les deux. MCP offre la lisibilité et le contrôle. Les habiletés apportent la flexibilité et l’évolutivité. Mais à mesure que les agents se dotent d’une mémoire, d’un planificateur et d’une capacité de raisonnement multi-étapes, l’articulation entre structure et action devient plus fragile.
Le futur ne sera ni celui d’un agent unique surpuissant, ni celui d’une constellation anarchique de micro-outils. Il dépendra de la capacité à maintenir une cohérence entre les intentions, les contextes et les moyens d’action. MCP propose une syntaxe ; les habiletés définissent le vocabulaire. Encore faut-il que la grammaire globale soit intelligible, auditable et maîtrisée. C’est à cette condition que les agents IA pourront réellement prendre le relais des logiciels déterministes, sans rompre le fil de la logique métier.