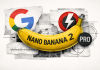Trop d’outils, trop peu de complémentarité : la complexité des environnements de sécurité fragilise encore trop souvent les PME. En misant sur la centralisation et la supervision continue, le MDR redonne du sens à la protection numérique, et transforme une contrainte budgétaire en véritable investissement rentable et cohérent.
Les entreprises ne cherchent plus à se protéger davantage, mais à mieux se protéger. Après des années de surenchère technologique, leurs environnements de sécurité ressemblent souvent à un empilement d’outils, d’interfaces et de protocoles. À chaque nouvelle menace, une nouvelle solution : un pare-feu ici, un anti-phishing là, un agent pour le cloud ou le mobile... Résultat : des systèmes hétérogènes, parfois incohérents, où les équipes peinent à distinguer l’alerte critique du simple bruit de fond. Un constat d’autant plus paradoxal que, malgré la profusion de solutions, 63% des TPE-PME évoquent un manque de connaissances et d’expertise en interne (Baromètre 2025 cybermalveillance.gouv.fr). En d’autres termes, les outils s’accumulent mais la perception d’efficacité reste floue.
Le modèle du Managed Detection and Response (MDR) vient bousculer cette logique, et rassemble dans un même cadre la détection, la supervision et la réaction, assurées en continu par des spécialistes. L’entreprise n’a plus à jongler entre plusieurs consoles : la visibilité devient globale, la gestion plus fluide et les décisions plus rapides.
Car « empiler des outils, c’est souvent additionner les angles morts », rappelle Benoît Grunemwald, expert en cybersécurité de l’éditeur ESET. Autrement dit, le MDR apporte une logique d’ensemble qui manquait à la sécurité des entreprises.
Dans les PME comme dans les grandes structures, cette simplification change la nature même de la sécurité. Elle ne repose plus sur la prolifération de solutions, mais sur la lisibilité et la continuité. Et dans un contexte où les exigences réglementaires se multiplient, cette cohérence devient autant un gage d’efficacité qu’un signe de maturité.
Mieux (se) protéger, c’est aussi mieux investir
Derrière cette logique de centralisation, on retrouve une véritable volonté de rationalisation : savoir ce qu’on achète, à quoi on a droit et combien cela coûte. Après avoir longtemps été perçue comme une dépense contrainte, la cybersécurité devient aujourd’hui une question de rentabilité. L’approche MDR prend en compte cette équation économique. Rationaliser, c’est aussi reprendre le contrôle de son budget et de sa stratégie, là où un empilement de solutions disparates reste synonyme de coûts non maîtrisés et de logiciels sous-exploités. Le TCO (Total Cost of Ownership) s’envole alors, sans pour autant renforcer la sécurité.
Les chiffres confirment cette tension budgétaire : 78% des TPE-PME disposent d’un budget informatique annuel inférieur à 5000€, et 77% investissent moins de 2000€ dans la cybersécurité (Baromètre cybermalveillance). Autrement dit, 8 entreprises sur 10 se protègent avec des moyens limités. Dans ce contexte, chaque euro compte et la maîtrise des coûts devient un enjeu vital.
C’est précisément ce besoin de rationalisation qui explique l’essor des modèles managés d’un éditeur comme ESET. En reposant sur une architecture unifiée : un seul service, un seul point de gestion, une visibilité complète sur les coûts comme sur les incidents et surtout, une seule facture maîtrisée. Les outils sont utilisés à leur plein potentiel, sans redondance ni complexité inutile. « Former une équipe à un environnement unifié vaut mieux que gérer cinq consoles différentes », glisse Benoît Grunemwald, rappelant que « On utilise rarement un logiciel à 100% de ses capacités ! ».
En pratique, la centralisation réduit les doublons et fait disparaître les coûts cachés en évitant les licences multiples à renouveler ou les surcoûts liés au support ou à la maintenance. L’entreprise sait ce qu’elle paie, pourquoi et jusqu’où va la protection. Et surtout, elle ne dépasse pas ses plafonds : un service MDR peut démarrer à quelques euros par poste et par mois, rendant la supervision avancée accessible même aux structures les plus modestes.
À l’inverse, certaines approches de type micro-SOC entendent rassembler les meilleures solutions du marché, mais finissent souvent par reproduire les erreurs du passé : un empilement de technologies sans véritable vue d’ensemble, des choix techniques arbitraires et des périmètres de service flous. Difficile, dans ces conditions, de savoir ce qui est réellement inclus ou facturé en option. Et bien souvent, le résultat n'est autre qu'une maîtrise financière limitée et des factures qui gonflent bien au-delà du budget initial.
En remettant de la clarté, le modèle MDR centralisé redonne ainsi à la cybersécurité son statut d’investissement durable et mesurable.
De la rationalisation à la confiance : protéger avant de se conformer
« La conformité vient rarement d’une checklist. Elle découle d’une protection claire et continue », explique Benoît Grunemwald. Et cette clarté, c’est précisément ce que permet une sécurité rationalisée.
Car centraliser ses outils, c’est aussi simplifier le quotidien : les alertes sont regroupées, les journaux d’événements uniformisés et la documentation plus facile à produire. Les entreprises gagnent en visibilité, en traçabilité et en réactivité ; autant de qualités devenues essentielles face aux exigences de la directive NIS2 notamment.
Mais au-delà de la conformité, c’est la compréhension même de leur protection qui fait encore défaut à nombre de structures. 42% des TPE et PME estiment avoir un faible niveau de protection ou ne savent pas l’évaluer, lit-on encore dans le baromètre 2025 de Cybermalveillance.gouv.fr. Preuve que, malgré la multiplication des outils, la lisibilité reste un enjeu majeur. Rationaliser, c’est justement redonner à la sécurité son sens premier : savoir où l’on en est, et pourquoi.