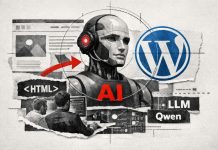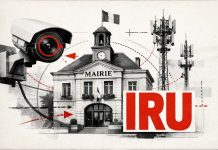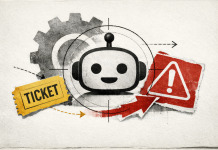Lors du sommet de l’APEC, le président chinois Xi Jinping a proposé la création d’un organisme international pour encadrer l’usage de l’intelligence artificielle. Cette initiative vise à favoriser une gouvernance mondiale plus inclusive de l’IA, dans un contexte marqué par la prééminence américaine sur les normes technologiques. L’Europe, quant à elle, peine à affirmer une position lisible dans cette recomposition géostratégique.
En proposant la mise en place d’une « Organisation de coopération mondiale pour l’intelligence artificielle », la Chine appelle à structurer un cadre multilatéral permettant de partager les bénéfices de l’IA et d’en encadrer collectivement les usages. Présentée par Xi Jinping lors du sommet de l’APEC le 1er novembre 2025, cette proposition reflète une volonté d’instaurer un espace de dialogue et de règles communes, à l’heure où l’IA façonne profondément les équilibres économiques et politiques mondiaux.
La déclaration de Pékin s’appuie sur une conception coopérative de la gouvernance technologique. Elle repose sur l’idée que l’intelligence artificielle, en tant que technologie d’impact global, devrait être considérée comme un bien public mondial, nécessitant une concertation internationale. L’organisme proposé pourrait s’atteler à définir des principes de développement responsable, à favoriser l’accès aux technologies, et à accompagner les pays dans la structuration de leur propre stratégie numérique.
Un rééquilibrage des règles du jeu technologique
Face à cette initiative, les États-Unis privilégient une approche fondée sur la régulation sectorielle, les partenariats technologiques ciblés et le pilotage par les entreprises elles-mêmes. Cette divergence de méthode reflète des visions différentes de la souveraineté numérique, mais ne constitue pas en soi une opposition de principe. La proposition chinoise peut ainsi être lue comme une tentative d’ouvrir un espace de coopération plus équilibré, dans un contexte de concentration croissante des leviers technologiques entre les mains de quelques entreprises, qui disposent des moyens et de la présence de grandes puissances.
L’initiative chinoise introduit la possibilité d’un cadre de gouvernance moins polarisé, notamment pour les pays qui ne souhaitent pas s’aligner automatiquement sur les normes imposées par les plateformes dominantes. Dans le prolongement de cette démarche, la Chine met en avant ses propres modèles d’intelligence artificielle, développés localement et diffusés à large échelle. Ce positionnement promet de renforcer la diversité des approches et de garantir une certaine autonomie des États dans leurs choix technologiques.
Pour les acteurs industriels, cette proposition ouvre la voie à une structuration multipolaire des standards. Les entreprises devront anticiper l’émergence de régimes de conformité différenciés selon les zones géographiques, tout en assurant l’interopérabilité de leurs systèmes. À terme, la coexistence de plusieurs cadres pourrait encourager l’innovation réglementaire, à condition qu’un socle minimal de règles communes soit établi pour éviter les fragmentations excessives.
L’Europe en recherche de positionnement
Dans cette recomposition, l’Europe a beau afficher une ambition de souveraineté numérique, elle ne dispose pas de leviers pour peser sur les décisions. C’est peu dire qu’elle peine à faire entendre sa voix au niveau international, elle n’a pas de voix sur ce sujet. Si l’AI Act constitue un jalon structurant, son influence reste pour l’instant limitée à l’espace européen. L’absence d’un consensus empêche la défintion d’une stratégie externe claire, appuyée par une capacité technologique équivalente à celle des États-Unis ou de la Chine, ce qui freine sa capacité à peser dans les discussions sur la gouvernance mondiale de l’IA.
Pour les entreprises européennes, cette situation crée une incertitude stratégique. Elles doivent à la fois se conformer aux exigences du marché intérieur et adapter leurs offres à des régimes extérieurs aux logiques divergentes. Le développement de solutions compatibles avec plusieurs cadres réglementaires devient un impératif, tout comme l’anticipation des standards émergents qui pourraient devenir prédominants à moyen terme.
Une gouvernance mondiale ouverte reste à inventer
La proposition chinoise n’a pas encore reçu d’adhésion formelle, mais elle invite à penser autrement la régulation de l’intelligence artificielle. Elle soulève des questions légitimes sur la manière dont les bénéfices de cette technologie sont répartis, sur les risques associés à sa concentration entre les mains de quelques entreprises dominantes, et sur la responsabilité collective des États dans sa supervision. Dans cette optique, un organisme de coopération pourrait servir de plateforme de coordination plutôt que de contrainte, à condition que ses modalités soient transparentes, équitables et inclusives. La gouvernance de l’IA devient ainsi un terrain diplomatique à part entière, au même titre que le commerce, l’environnement ou la santé.
Loin d’une logique d’affrontement, la proposition formulée par Xi Jinping peut être comprise comme un appel à dépasser les rapports de force pour construire un ordre technologique plus équilibré. Dans un monde où les transformations numériques touchent tous les secteurs d’activité, le besoin d’un dialogue mondial structuré sur l’IA apparaît de plus en plus pressant. L’Europe, pour sa part, a l’opportunité de contribuer activement à cette réflexion, en s’appuyant sur son expérience réglementaire et sur ses valeurs en matière de droits fondamentaux. À condition de s’en donner les moyens, elle peut faire émerger une voie intermédiaire qui articule innovation, régulation et coopération internationale.