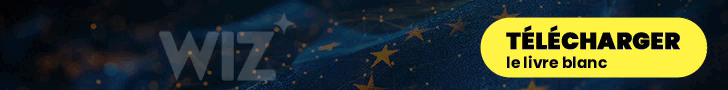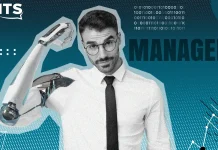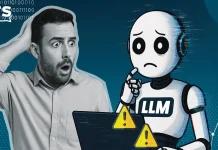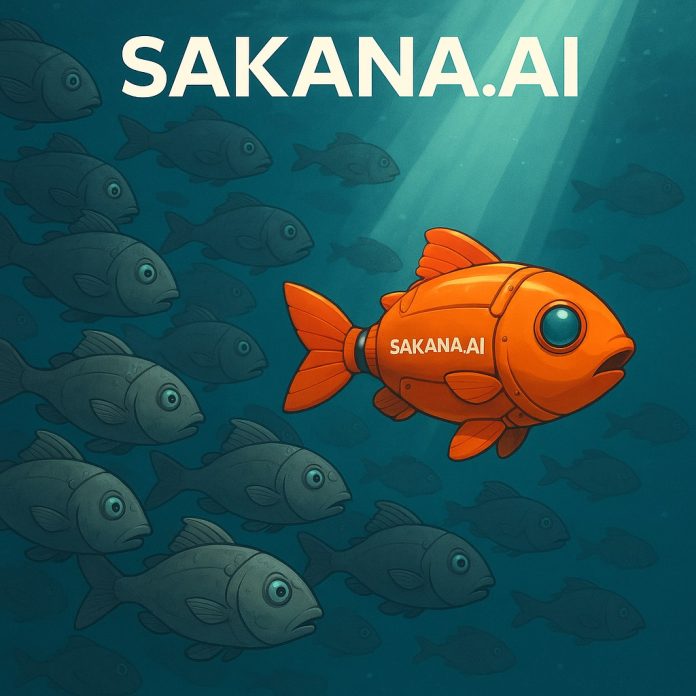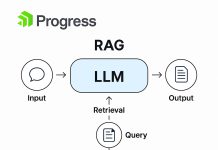Sakana AI, jeune pousse japonaise, bouleverse les codes de la recherche en intelligence artificielle en proposant une IA bio‑inspirée : modèles évolutionnaires, intelligence collective, dynamique neuronale temporelle. En empruntant à la nature ses principes de sélection, de coopération ou de rythme, elle pose des questions sur l’autonomie, l’efficacité et la gouvernance des IA de demain.
En un peu plus d’un an, Sakana AI a réussi à se faire remarquer : non pas en poursuivant le succès des géants de l’IA, mais en les défiant sur leur propre terrain, tout en s’appuyant sur une autre épistémologie. Plutôt que de pure force brute, de dimensions gargantuesques ou d’escalade des paramètres, Sakana explore comment s’inspirer des bancs de poissons, des réseaux neuronaux biologiques, de l’évolution naturelle pour construire des agents intelligents différents, plus adaptatifs, plus efficaces, parfois plus imprévisibles, donc plus créatifs.
Sakana AI a été fondée à Tokyo en juillet 2023 par David Ha, Llion Jones et Ren Ito. Deux d’entre eux sont d’anciens chercheurs de Google, dont Llion Jones, coauteur de l’article fondateur « Attention is all you need ». L’entreprise s’est donné pour mission de créer des modèles de fondation non pas en poussant la puissance brute, mais en empruntant aux principes de la nature : évolution, intelligence collective, dynamique neuronale biologique.
Sur le plan financier, Sakana AI a levé 30 millions de dollars en 2024 lors de son tour d’amorçage (seed) auprès d’investisseurs tels que Lux Capital, Khosla Ventures, ainsi que des acteurs japonais comme NTT, KDDI, Sony. Ensuite, en série A, elle a levé environ 100 millions de dollars, avec Nvidia parmi les partenaires stratégiques, ce qui montre un soutien fort de l’écosystème tant local qu’international.
Le nom même (« sakana » signifie poisson en japonais) traduit cette philosophie : l’idée du banc de poissons, du comportement collectif issu de règles simples, de la cohésion à partir d’entités simples. Sakana AI revendique explicitement vouloir « faire ce qui ne se fait pas encore », ou du moins différemment. C’est ce qui positionne la société comme une voix critique ou stimulante dans le paysage actuel dominé par l’accroissement des capacités (taille des modèles, puissance de calcul) et les approches standardisées.
Une approche bio-inspirée de la recherche
Sakana AI puise dans plusieurs traditions biologiques pour schématiser ses modèles :- Évolution des modèles : fusion (model merging) et mise en compétition des modèles existants, pour en tirer des « descendants » plus performants, comme dans un mécanisme de sélection naturelle.
- Intelligence collective : analogies avec les bancs de poissons ou les systèmes adaptatifs : plusieurs agents simples interagissent, coopèrent, parfois se concurrencent, pour produire des comportements complexes.
- Dynamique neuronale temporelle : dans le Continuous Thought Machine (CTM), Sakana intègre l’importance du temps dans l’activité neuronale, non plus seulement le signal instantané, mais la synchronisation, l’historique des activations, rappelant certains mécanismes biologiques comme la plasticité dépendant du délai ou la synchronisation des oscillations.
- Recherche ouverte, « open‑ended discovery » : l’agent scientifique (AI Scientist) est conçu pour générer des idées, formuler des hypothèses, exécuter des expériences, analyser, rédiger, ceci dans une boucle dont le périmètre n’est pas strictement défini à l’avance. Cela s’apparente à un système évolutif de découverte scientifique, inspiré des forces de l’évolution biologique (variation, sélection, expérimentation).
- Hybridation avec l’idée de vie artificielle (ALife) : Sakana développe des projets où les fondations de l’intelligence sont explorées via des simulations d’écosystèmes, de formes de vie matérielles ou virtuelles, d’autonomie, nouveauté continue.
Ces inspirations naturelles ne sont pas juste décoratives : elles structurent les architectures, les protocoles d’expérimentation, les métriques, les objectifs mêmes. Leur ambition est de sortir d’un paradigme purement statistique ou de « taille + données », pour explorer des modèles plus efficients, plus adaptatifs, moins gourmands en ressources, et potentiellement plus résistants aux changements ou aux conditions inhabituelles.
Tout n’est pas encore « naturellement parfait » : limites, risques, défis
L’approche de Sakana AI, en tant que poil à gratter de la recherche en IA, ouvre une perspective forte : celle d’intelligences artificielles moins dépendantes de l’échelle, plus adaptatives, et plus proches des mécanismes naturels qui ont permis la diversité, la robustesse et l’efficacité dans la biosphère. Sakana AI ne se contente pas d’améliorer les méthodes existantes, elle explore d’autres logiques, bio-inspiration, architectures évolutives, intelligence collective, ce qui impose une rupture de perspective. Par exemple, au lieu d’un modèle unique surdimensionné, on imagine une constellation de petits agents spécialisés. C’est un changement de paradigme, donc une radicalité dans la manière même de concevoir l’IA.
En fin de compte, Sakana AI ne propose pas seulement des avancées techniques : elle force l’écosystème de l’IA à réfléchir à ses postulats — sur la nature de l’intelligence, sur ce que signifie « inspiré par la nature », sur la frontière entre autonomie et responsabilité. Et c’est peut-être là son plus grand impact : rendre plus visibles les questions que beaucoup préfèrent ignorer, quitte à rendre le futur de l’IA plus radical, en remettant en cause les postulats dominants, mais aussi plus durable et plus humainement pertinent.