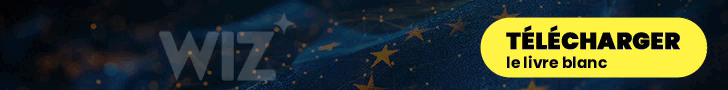Nvidia annonce un investissement de 5 milliards de dollars dans Intel, scellant un partenariat stratégique autour de la fabrication de puces pour centres de données et de composants IA pour ordinateurs personnels. Cette alliance permettra de combiner les GPU de Nvidia avec les capacités de production d’Intel, dans un contexte de forte tension sur les chaînes d’approvisionnement et de recentrage des acteurs américains.
Ce rapprochement inattendu entre Nvidia et Intel change la donne dans le secteur des semiconducteurs. L’accord, rendu public le 18 septembre, prévoit que les deux entreprises développent conjointement des produits pour les centres de données et les PC, en intégrant les architectures CPU x86 d’Intel avec les GPU et technologies d’accélération IA de Nvidia. En parallèle, Nvidia prendra une participation d’environ 4 % dans Intel via un investissement de 5 milliards de dollars, à un prix de 23,28 USD par action.
L’objectif annoncé est double : répondre à la demande exponentielle en puissance de calcul, tout en diversifiant les sources de production au-delà de TSMC. Intel entend démontrer la maturité industrielle de sa division fonderie (IFS), tandis que Nvidia sécurise un accès à des capacités avancées de production et de packaging aux États-Unis. Cette alliance ne concerne pas l’achat de wafers pour l’instant, mais elle pourrait aboutir à des produits co-développés à l’horizon 2027–2028.
Un partenariat pour stabiliser l’écosystème plus que pour affronter AMD
Contrairement aux apparences, cet accord ne s’inscrit pas dans une logique d’affrontement direct avec AMD. Il s’apparente plutôt à une opération de stabilisation systémique, comparable à celle d’Intel investissant dans AMD en 2006, ou de Microsoft soutenant Apple en 1997. Ces investissements n’avaient rien de philanthropique : ils visaient à préserver une structure de marché non monopolistique pour l’un, et à soutenir un débouché pour ses produit pour l’autre, tout en gagnant en influence technologique et structurelle.
Dans le cas présent, Nvidia cherche à s’aligner sur les objectifs américains de souveraineté industrielle et à désamorcer d’éventuelles critiques réglementaires liées à sa position dominante sur les GPU. Intel, de son côté, obtient un soutien de poids pour crédibiliser sa feuille de route technologique (Intel 18A, packaging Foveros et EMIB) et pour attirer d’autres clients stratégiques. L’alliance illustre une forme de coopétition assumée dans un marché en recomposition.
Vers une recomposition des chaînes d’approvisionnement IA
Ce partenariat doit aussi se comprendre à l’aune de la recomposition géopolitique des chaînes de valeur. Le duo Nvidia–Intel pourrait réduire la dépendance aux fonderies asiatiques et aux tensions liées à Taïwan. Pour les entreprises utilisatrices, cela signifie à terme une plus grande proximité de production, des délais réduits, et potentiellement des coûts mieux maîtrisés sur certaines gammes IA. Intel espère ainsi convaincre les acteurs du cloud et les hyperscalers de considérer IFS comme une alternative viable.
Sur le plan industriel, les produits conjoints pourraient concerner des processeurs d’infrastructure IA intégrant des blocs Nvidia, ou des PC équipés de chiplets RTX intégrés à des SoC Intel. L’ambition est de proposer des architectures unifiées et optimisées pour l’inférence locale comme pour l’accélération cloud, dans une logique de standardisation ascendante.
Des implications pour la régulation et la gouvernance sectorielle
En anticipant les critiques potentielles des régulateurs, Nvidia adopte une posture proactive. Il soutient la réindustrialisation américaine en favorisant une diversité d’acteurs, il réduit le risque de mesures antitrust tout en renforçant sa légitimité. Cette stratégie est sa réponse à un contexte où les États-Unis, l’Europe et la Chine multiplient les initiatives pour contrôler les chaînes de valeur critiques en IA et en semiconducteurs. Pendant ce temps, la demande explose.
Ce type de partenariat redéfinit également les logiques de gouvernance dans le secteur : il ne s’agit plus seulement de concurrence frontale, mais de stabilité systémique. L’IA, en tant que marché stratégique et capacitaire, impose une redéfinition des alliances industrielles. Pour les DSI, intégrateurs et constructeurs, cette évolution devra être suivie de près : elle pourrait rebattre les cartes dans les choix d’architectures matérielles et dans les négociations fournisseurs.