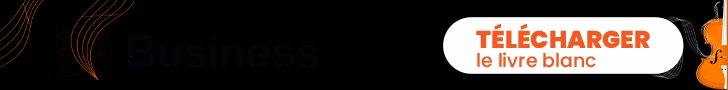Le 7 juillet 2025, le CESIN, qui regroupe plus de 1 200 responsables cybersécurité en France, a lancé un nouvel appel en faveur d’une stratégie européenne d’« indépendance coopérative ». Ce plaidoyer insiste sur l’urgence d’un EUCS+ — version renforcée du schéma européen de certification de sécurité cloud — réservé aux prestataires européens ou non, soumis à des lois extraterritoriales. Cette prise de position fait écho au triptyque défendu depuis plusieurs mois par le club : SecNumCloud pour les données critiques, EUCS+ pour les données sensibles, et un encadrement renforcé via la loi Résilience pour les autres cas d’usage.
Ce positionnement intervient dans un contexte d’urgence : selon les chiffres cités par la ministre Clara Chappaz et rappelés par le CESIN, 70 % du cloud utilisé en Europe est actuellement opéré par des prestataires non européens, et 25 % des cyberattaques ciblent des infrastructures critiques, des collectivités ou des acteurs économiques essentiels. Le club plaide pour une harmonisation ambitieuse, mais réaliste, refusant à la fois le repli protectionniste et le laisser-faire technologique.
L’Arcep plaide pour une « autonomie stratégique »
Quelques jours plus tôt, le 3 juillet, l’Arcep publiait sa contribution à la consultation de la Commission européenne sur l’avenir des politiques cloud et IA. L’autorité y défend une régulation économique ex ante à l’échelle de l’Union, inspirée des réussites françaises dans les télécoms. « La régulation a apporté stabilité et prévisibilité, mutualisation et efficacité, innovation et compétitivité des prix », rappelle Laure de La Raudière, sa présidente, en appelant à une transposition similaire pour les infrastructures numériques.L’Arcep propose une série de leviers : transparence sur les investissements, ouverture des marchés via des API documentées, garanties d’accès aux données et aux infrastructures, diffusion de pratiques d’écoconception. L’objectif est double : éviter l’émergence de nouveaux gatekeepers — notamment dans l’IA générative agentique — et garantir l’émergence d’un écosystème numérique diversifié, capable de soutenir l’autonomie stratégique européenne.
Au-delà de ces deux appels, plusieurs signaux convergents révèlent un tournant stratégique. Le Danemark a acté en juin l’abandon progressif des solutions Microsoft au profit d’alternatives open source dans ses institutions, amorçant une réorientation de son socle numérique. En France, les débats parlementaires autour de la loi Résilience devraient reprendre d’ici septembre, tandis que l’écosystème souverain (NumSpot, OVHcloud, Outscale, Bleu, S3NS) renforce ses synergies autour de SecNumCloud et des exigences d’un EUCS+ renforcé.
La souveraineté est désormais un objectif opérationnel
Cette dynamique reflète une inflexion notable du discours institutionnel : la souveraineté n’est plus un concept, mais un objectif opérationnel qui requiert des arbitrages industriels, réglementaires et économiques clairs. Le CESIN, dans son communiqué, insiste sur une approche graduée des exigences, différenciant les types de données et les obligations associées, afin de concilier souveraineté, innovation et compétitivité.À l’ère de l’IA générative et des écosystèmes intégrés, la souveraineté numérique passe désormais par des arbitrages régulés, une gouvernance technique cohérente et une politique industrielle assumée. L’Arcep pose ainsi les fondations d’un cadre européen structurant, capable de soutenir un numérique compétitif et résilient, tout en garantissant une autonomie stratégique durable. En filigrane, c’est la capacité de l’Europe à fixer ses propres règles du jeu qui est en cause. Si le Data Act et le Digital Markets Act posent un socle juridique, les acteurs de terrain réclament désormais des traductions concrètes : certifications applicables, fiscalité adaptée, normes d’interopérabilité, et politiques d’achat public alignées sur les objectifs de souveraineté.
Dans un paysage dominé par des acteurs intégrés et mondiaux, et dans un processus de régionalisation des stratégies industrielles et économiques, l’Europe devra démontrer sa capacité à coordonner ses initiatives, à mutualiser ses investissements et à imposer une régulation à la hauteur des enjeux. L’été 2025 pourrait ainsi s’avérer décisif pour faire émerger, enfin, une souveraineté numérique maîtrisée, stratégique et européenne.