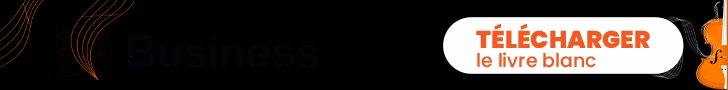Les équipes de sécurité ne peuvent pas protéger ce qu’elles ne voient pas ou ne comprennent pas. Et cela n’a jamais été aussi vrai qu’aujourd’hui. À mesure que les organisations adoptent des infrastructures hybrides et des applications cloud-native, la visibilité diminue tandis que la complexité augmente. Les équipes de sécurité se retrouvent souvent sans vision claire de ce qui s’exécute, des vulnérabilités existantes ou des modalités d’accès aux ressources. Cette opacité rend la détection précoce des menaces et la réaction rapide de plus en plus difficiles.
L’époque où les entreprises pensaient pouvoir prévenir les cyberattaques uniquement par des mesures préventives est révolue. Avec la migration des charges de travail vers le cloud, la complexité augmente et la transparence recule. Les entreprises françaises sont particulièrement touchées par la surcharge d’alertes et le manque de contexte. Le problème ne réside pas dans l’absence de données, mais dans l’incapacité à les interpréter, les corréler et les transformer en informations exploitables.
Un volume d’alertes quotidiennes au-delà du raisonnableLes équipes sont submergées par un volume élevé d’alertes, un contexte limité et une incertitude croissante. En France, les équipes de sécurité reçoivent en moyenne 2 336 alertes par jour, un chiffre astronomique, impossible à traiter efficacement. Résultat : elles passent 13,7 heures par semaine à traiter des faux positifs, principalement à cause de technologies de détection obsolètes qui échouent encore à identifier les menaces les plus importantes, du manque de contexte dans les alertes, et de la prolifération des outils. Les équipes de sécurité font de leur mieux dans des environnements complexes, mais les défis restent considérables.
Submergés par le bruit ambiant
Trop d’outils, pas assez d’analystes, et un manque de contexte rendent presque impossible pour les équipes de sécurité de se concentrer sur l’essentiel. Les alertes manquées ont des conséquences réelles : atteinte à la réputation, interruptions d’activité… Le mouvement latéral, où les attaquants se déplacent discrètement d’un système à l’autre, passe inaperçu, fragilise la confiance et accroît les risques. Les organisations ne parviennent pas à voir clairement ce que les attaquants visent ni la direction qu’ils prennent. Cette situation prolonge la présence des cybercriminels dans le système et leur offre une opportunité précieuse d’élargir leur champ d’action et d’affiner leurs méthodes.
Sans compréhension précise de l’activité sur leur réseau, même les programmes de sécurité les plus avancés risquent de manquer leur cible. Les équipes, lassées d’être noyées sous des alertes isolées, cherchent désormais une observabilité qui connecte les données dans des environnements hybrides, clarifie les signaux, et fait ressortir ce qui compte vraiment.
L’Intelligence Artificielle et le Machine Learning pour limiter les compromissions
Les entreprises ne veulent plus seulement voir plus, mais mieux comprendre. Elles recherchent des réponses plus rapides et automatisées, capables de filtrer le bruit et de contenir les menaces avant qu’elles ne se propagent. L’IA devient donc une priorité pour réduire les faux positifs qui gaspillent temps et ressources, combler les lacunes contextuelles qui ralentissent les enquêtes, et accélérer la réponse pour contenir les menaces avant qu’elles ne s’aggravent.
En 2026, les priorités des organisations françaises sont donc de :
- renforcer les capacités basées sur l’IA et le ML,
- améliorer la détection et la réponse dans le cloud,
- automatiser le triage et l’investigation des menaces,
- renforcer la conformité et la préparation aux audits.
Une feuille de route pour la résilience dans le cloud
Il est temps de moderniser la détection et la réponse. Cela passe par l’équipement des équipes de sécurité avec les outils et la visibilité nécessaires pour anticiper les menaces.
Les organisations doivent adopter une approche globale de leurs capacités de détection et de réponse : identifier les lacunes, investir dans une observabilité pilotée par l’IA, et bâtir une feuille de route qui réduise les risques et renforce leur résilience.
Car, dans le paysage actuel des menaces, comprendre, et non simplement voir, est la première étape pour rester en sécurité.
Par Damien Gbiorczyk, expert en cyber-résilience chez Illumio