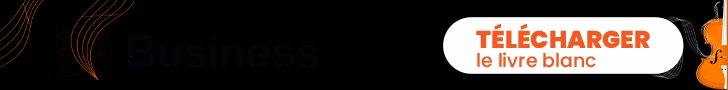Pas moins de 61 % des DSI en Europe de l’Ouest comptent augmenter leur recours aux fournisseurs de cloud locaux en réponse aux tensions géopolitiques. C’est l’un des principaux enseignements de l’enquête Gartner menée à l’été 2025, qui met en lumière un repositionnement stratégique du cloud sur fond de souveraineté numérique, de contraintes réglementaires et de différenciation technologique.
Pour les acteurs régionaux comme pour les utilisateurs finaux, la prise de conscience de la dépendance aux technologies américaines a eu l’effet d’un réveil brutal. Depuis le Cloud Act de 2018 jusqu’aux débats récents sur la militarisation de l’IA, en passant par les restrictions à l’exportation de composants critiques, l’Europe a progressivement pris conscience de sa vulnérabilité technologique.
Lorsque le Président des États-Unis a affirmé vouloir réserver les puces Blackwell aux seules entreprises américaines, l’avertissement a résonné plus fort que n’importe quelle analyse rétrospective. En une phrase, l’hypothèse longtemps théorique d’un verrouillage technologique unilatéral prenait corps : le gouvernement américain peut décider, du jour au lendemain, d’exclure ses alliés de technologies critiques, sans préavis ni filet de sécurité. Cette déclaration, pourtant rapidement atténuée par ses équipes, illustre l’instabilité structurelle à laquelle sont confrontées les organisations européennes.
Les États-Unis peuvent instrumentaliser leurs avancées stratégiques
Elle nourrit un sentiment de vulnérabilité durable : si les États-Unis peuvent instrumentaliser ou militariser leurs avancées stratégiques au gré des priorités nationales, alors la dépendance aux fournisseurs extraterritoriaux devient immédiatement un risque opérationnel. Dans ce contexte, l’étude Gartner ne révèle pas seulement un repositionnement technique, elle confirme que, pour la majorité des DSI européens, la souveraineté n’est plus un discours, mais une condition de survie.
Ce réveil souverainiste a nourri une profonde défiance envers les géants technologiques américains, accusés de soumission implicite à la stratégie extraterritoriale des États-Unis. Pourtant, de nombreux dirigeants outre-Atlantique continuent d’afficher une incompréhension structurelle de cette réalité européenne. Le terme même de « souveraineté numérique » y est souvent tourné en dérision ou confondu avec du protectionnisme économique.
Dans leurs discours, certains fournisseurs américains nient l’existence d’un problème en opposant des garanties contractuelles creuses à des exigences juridiques, opérationnelles et politiques bien réelles. L’étude Gartner révèle, au contraire, que, pour une majorité de DSI européens, la localisation, l’origine du fournisseur et la capacité à échapper aux injonctions étrangères constituent désormais des critères structurants. Le cloud devient un espace de souveraineté autant que de performance.
La souveraineté numérique redevient une priorité d’architecture
Selon Gartner, cette inflexion stratégique n’est pas conjoncturelle. D’ici 2030, 75 % des entreprises situées hors des États-Unis devraient s’être dotées d’une stratégie explicite de souveraineté numérique, intégrant le recours à un cloud souverain ou régionalisé. Plusieurs facteurs alimentent ce mouvement, comme la multiplication des réglementations sur la localisation des données (RGPD, Data Act, NIS2), les incertitudes géopolitiques liées aux tensions sino-américaines ou aux restrictions à l’exportation de composants critiques, ainsi que l’essor des technologies open source comme levier de reprise de contrôle sur les briques d’infrastructure.
Pour 55 % des répondants, l’usage de technologies ouvertes devient même un critère structurant de leur stratégie cloud future. Dans ce contexte, la dimension territoriale des fournisseurs redevient centrale, parce que l’origine, l’ancrage local et les garanties juridiques proposées pèsent désormais autant que la capacité d’innovation ou le catalogue de services.
Des arbitrages complexes pour les DSI entre résilience et efficience
Ce recentrage vers le cloud local n’est pas sans conséquence sur les stratégies d’architecture. Il impose aux directions informatiques de revisiter la cartographie des flux de données, de resegmenter leurs charges de travail selon leur criticité réglementaire, et d’envisager une hybridation plus poussée entre plateformes mondiales et offres locales. Les éléments numériques les plus sensibles, données de santé, infrastructures critiques, systèmes réglementés, pourraient basculer vers des environnements souverains, tandis que d’autres resteront hébergés chez les hyperscalers.
Cette segmentation nécessite une gouvernance renforcée, un suivi rigoureux des obligations de conformité et un dialogue étroit avec les métiers pour éviter la fragmentation opérationnelle. Les critères de sélection des partenaires cloud évoluent aussi, car au-delà des SLA ou de la tarification, les entreprises évaluent désormais la transparence, la capacité à opérer sur des standards ouverts, et le découplage face à des pressions politiques ou juridiques transfrontalières.
Un repositionnement stratégique pour les acteurs européens du cloud
Pour les fournisseurs européens, cette dynamique ouvre une fenêtre d’opportunité. Longtemps cantonnés à des niches sectorielles ou territoriales, ils bénéficient aujourd’hui d’une légitimité accrue face aux géants américains. Le discours de proximité, la conformité native aux cadres européens, et l’absence d’exposition au Cloud Act ou aux FISA Courts constituent autant d’arguments différenciateurs.
, Mais la marche reste haute, car, pour répondre aux attentes des grands comptes, ces acteurs doivent muscler leur infrastructure, étoffer leur portefeuille de services, et démontrer leur capacité à tenir la charge sur le long terme. Certains optent pour des alliances stratégiques ou des interconnexions renforcées avec les hyperscalers. D’autres misent sur des architectures natives du cloud, compatibles avec Kubernetes ou OpenStack, pour offrir une continuité technologique. Dans tous les cas, la maturité industrielle devient une condition d’éligibilité.
Le cloud souverain : entre pragmatisme, compromis et montée en compétences
Si la bascule vers le local est bien amorcée, elle se heurte à plusieurs limites. D’un point de vue économique, les offres souveraines restent souvent plus coûteuses ou moins flexibles que leurs équivalents globaux. Sur le plan technologique, les services avancés, IA générative, calcul haute performance, déploiement multirégions sont encore largement dominés par les hyperscalers. Et du côté des utilisateurs, le déficit de compétences, la complexité des migrations, ou la difficulté à auditer les chaînes de sous-traitance constituent autant de freins. La réussite de cette transition repose donc sur un accompagnement structuré : formation des équipes, clarification des critères de souveraineté, mutualisation des ressources au niveau sectoriel ou national. Le modèle hybride, combinant plateformes souveraines pour les actifs critiques et services globaux pour les charges génériques, apparaît comme une voie d’équilibre réaliste.
Au-delà de la technique, c’est une véritable reconfiguration des rapports de force qui s’opère. Le cloud n’est plus un simple levier de transformation numérique, il devient un territoire stratégique soumis à des arbitrages politiques, économiques et culturels. À mesure que les tensions internationales s’exacerbent, les choix d’infrastructure prennent une coloration géopolitique. Cette évolution appelle à une gouvernance proactive, capable d’anticiper les contraintes, de diversifier les dépendances, et de préserver l’agilité nécessaire à l’innovation. Pour les entreprises, cela signifie repenser les contrats, réévaluer les engagements de localisation, et intégrer la souveraineté dans la conception même des systèmes. Une exigence multiforme, mais désormais incontournable dans l’architecture du numérique européen.