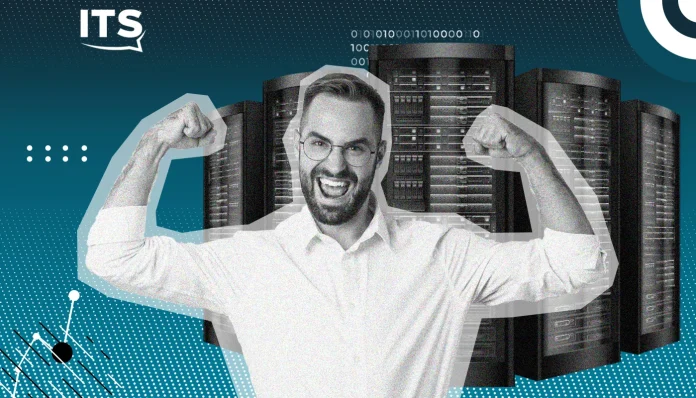Les centres de données ne sont plus de simples infrastructures d’hébergement, ils deviennent des nœuds stratégiques de la souveraineté numérique et de la puissance industrielle. Au carrefour des enjeux de localisation, d’énergie et de coopération internationale, la géopolitique de la « computation » redessine les chaînes de valeur numériques et impose aux entreprises une vigilance accrue sur leur dépendance.
La course aux centres de données et à la puissance de calcul rappelle, par son intensité et sa portée stratégique, la conquête spatiale de la guerre froide. À l’époque, les satellites et les stations orbitales symbolisaient la suprématie technologique. Aujourd’hui, ce sont les infrastructures computationnelles, centres de données hyperscale, supercalculateurs, grappes GPU, qui cristallisent les ambitions de souveraineté. Cette compétition ne se joue plus entre deux blocs, mais entre coalitions d’acteurs, géants du cloud, États industrialisés et fournisseurs d’énergie, dans une lutte continue pour le contrôle des ressources numériques.
Car, en effet, le monde dépend du numérique, et chaque gigaoctet, chaque pétaflop et chaque mégawatt d’énergie peuvent avoir des implications nationales. De même, les choix de localisation et de contrôle des centres de données deviennent des décisions aussi critiques que le choix d’un site de production ou d’un fournisseur de semiconducteurs.
40 Md$ annuels investits aux U.S., contre 500 millions en Europe
La dynamique mondiale de construction de centres de données est largement tirée par les États-Unis. Selon Bank of America Institute, les dépenses de construction y ont atteint un rythme annualisé de 40 milliards de dollars en juin 2025, en progression de 30 % par rapport à l’année précédente. Microsoft, Meta, Amazon et Alphabet concentrent à eux seuls plus de 70 % des investissements globaux dans les infrastructures d’IA. Microsoft a récemment annoncé 10 milliards de dollars d’investissements additionnels dans l’Arizona, tandis que Meta construit un nouveau campus à Temple, Texas, pour 1,5 milliard de dollars, dédié au traitement des modèles d’IA générative.
En comparaison, les annonces dans d’autres régions restent modestes. En Asie, Singtel et KKR projettent de reprendre ST Telemedia Global Data Centres pour 3,9 milliards de dollars. En Europe, les projets hyperscale dépassant 500 millions d’euros restent rares. Cette asymétrie crée une hiérarchie computationnelle mondiale où les entreprises européennes se retrouvent structurellement dépendantes d’acteurs nord-américains, y compris pour des applications critiques.
Accords computationnels et alignements stratégiques
La domination américaine s’accompagne en outre d’un maillage diplomatique autour de la computation. Des accords ont été noués entre Washington et plusieurs pays de l’ASEAN pour permettre aux hyperscalers d’installer des centres de données ou d’opérer via des tiers. En parallèle, la Chine a lancé un plan de maillage interprovincial visant à redistribuer la puissance de calcul excédentaire à l’échelle nationale. L’objectif est double, optimiser l’usage des infrastructures existantes d’un côté et, de l’autre, limiter la prolifération incontrôlée de centres énergivores dans les régions déjà saturées.
En Europe, la volonté d’établir une autonomie stratégique computationnelle se heurte à la réalité du marché, et à la fragmentation des stratégies nationales. Le projet Gaia-X, bien qu’ambitieux, peine à s’imposer face à l’efficacité industrielle des hyperscalers. Des acteurs comme OVHcloud, Scaleway ou Aruba tentent de répondre par l’innovation (souveraineté, énergie bas-carbone, modularité), mais les volumes de calcul nécessaires pour entraîner ou faire tourner des modèles IA de grande taille restent difficilement accessibles sans recourir aux infrastructures nord-américaines.
Computation, énergie et souveraineté : une triangulation instable
La puissance de calcul requiert une puissance électrique équivalente. Selon un rapport du LBNL cité par Reuters, la consommation énergétique des centres de données américains pourrait représenter jusqu’à 12 % de la production nationale d’ici 2028. Des fournisseurs comme DTE Energy, basé à Detroit, ont déjà annoncé une révision à la hausse de leurs plans d’investissement, soit 6,5 milliards de dollars en cinq ans, principalement pour accompagner la montée en charge des sites hyperscale dans le Midwest.
Ce couplage entre électricité et IA crée une dépendance inédite. Les contraintes de disponibilité, de coût et de décarbonation deviennent des critères structurants pour l’implantation. À Loudoun County (Virginie), épicentre du « Data Center Alley », les tensions sur le réseau poussent les autorités locales à limiter les autorisations de construction, alors que les acteurs du secteur demandent l’accélération de la construction d’infrastructures. L’enjeu devient donc stratégique pour les fournisseurs cloud et pour leurs clients B2B, qui doivent intégrer dans leurs arbitrages l’accès à une énergie stable, abondante et soutenable.
La souveraineté ne se réduit plus à la seule géolocalisation
Héberger ses données en Europe ne suffit pas à garantir leur souveraineté. Une étude récente (arXiv, août 2025) a montré que près de 48 % des projets IA en dehors des États-Unis s’appuient, à un moment donné de leur cycle, sur des infrastructures opérées ou contrôlées par des entreprises américaines. Cela concerne la formation des modèles, leur hébergement, ou leur interconnexion avec des API critiques. Cette porosité rend la chaîne de traitement vulnérable aux régulations extraterritoriales, comme le Cloud Act ou l’Executive Order sur la cybersécurité.
Les entreprises doivent donc aller au-delà du « où » et s’intéresser au « qui » : qui exploite les infrastructures ? Qui en détient le contrôle technique ? Qui peut y accéder en cas d’injonction judiciaire ? Les dispositifs de cloud de confiance (comme SecNumCloud ou C5) ne protègent que partiellement, car ils ne couvrent pas tous les niveaux d’intégration des services IA (modèles, GPU, orchestration).
Vers une hiérarchisation mondiale des capacités computationnelles
La montée en puissance des grands centres hyperscale aux États-Unis dessine une nouvelle hiérarchie. À un extrême, les clusters Azure ou AWS regroupant plusieurs centaines de milliers de GPU, comme celui de Boydton (Virginie) ou du comté de Maricopa (Arizona), offrent des capacités de calcul inégalées. À l’autre extrémité, les centres régionaux, edge, assurent des traitements localisés, mais avec des limitations techniques fortes.
Les entreprises doivent naviguer dans cette stratification mondiale en tenant compte de la criticité de leurs applications. Certaines peuvent être traitées localement pour des raisons de conformité ou de latence, d’autres nécessitent un accès à des clusters massifs pour entraîner ou déployer des modèles IA performants. Cette géopolitique de la computation oblige à penser en couches, à contractualiser avec plusieurs partenaires, et à prévoir des mécanismes de repli et d’abstraction (multicloud, orchestrateurs, interopérabilité).
Les centres de données incarnent aujourd’hui un pouvoir computationnel dont la maîtrise conditionne l’accès à l’IA, la sécurité des opérations et la souveraineté des choix technologiques. Pour les entreprises, il ne s’agit plus de choisir un fournisseur, mais de structurer une architecture pilotable à l’échelle géostratégique. La computation devient un actif à gouverner autant qu’un service à consommer.