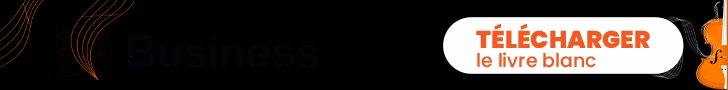Le 2 novembre 2025, lors d’un échange diffusé dans l’émission américaine 60 Minutes, Donald Trump a déclaré que les puces d’intelligence artificielle Blackwell de Nvidia « ne seront pas pour les autres ». Selon Reuters, cette phrase, en apparence spontanée, reflète une stratégie assumée de souveraineté technologique. En Europe, l’affaire Nexperia a déjà exposé la fragilité des chaînes d’approvisionnement, et l’étau géopolitique se referme. Au cœur d’un affrontement technologique global, l’Europe attend son sort.
La déclaration américaine, rapportée par Reuters, n’a donné lieu à aucun acte réglementaire immédiat, mais elle s’inscrit dans un mouvement stratégique engagé de longue date. Depuis 2019, les États-Unis encadrent strictement les exportations de processeurs avancés, notamment ceux utilisés pour l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle. En associant le nom Blackwell à un discours de restriction, le président américain confirme la tendance à la territorialisation des technologies critiques. La haute performance devient un privilège national, pas une ressource partagée. Pour l’Europe, cette évolution réduit les marges d’accès aux composants de nouvelle génération et fragilise les plans d’industrialisation de l’intelligence artificielle.
Début octobre, le gouvernement néerlandais a activé la loi de disponibilité des biens de 1952 afin de prendre le contrôle de l’entreprise Nexperia, filiale d’un groupe chinois. Le motif invoqué repose sur la protection d’infrastructures critiques, jugées stratégiques pour la souveraineté technologique du pays. En réaction, Pékin a suspendu plusieurs livraisons de composants destinés aux constructeurs européens. Plusieurs chaînes de montage ont été temporairement désorganisées, en particulier dans l’industrie automobile. Cet enchaînement illustre l’impact potentiel d’une rupture politique sur des filières industrielles largement mondialisées.
Une asymétrie structurelle devenue stratégique
L’Europe constate une fois de plus qu’elle est démunie face à un affrontement global qui la dépasse sur tous les plans. Les architectures de calcul proviennent des États-Unis, les capacités de production avancée sont concentrées en Asie, les terres rares nécessaires à la fabrication des composants sont contrôlées en grande partie par la Chine. Aucun de ces maillons n’est pleinement maîtrisé à l’échelle européenne. Dans ce contexte, chaque déclaration publique ou décision souveraine génère des effets immédiats, non anticipables, sur les chaînes d’approvisionnement locales.
La fragmentation du pouvoir technologique se traduit par une recomposition des alliances, des priorités industrielles et des dépendances. Les États-Unis sécurisent leur avance par la réglementation, la Chine construit sa résilience par la maîtrise des matériaux critiques, et l’Europe tente de préserver ses marges de manœuvre par des projets collectifs encore trop dispersés. Le Chips Act, les alliances industrielles, les plans nationaux de relocalisation n’ont pas encore produit d’effet de taille ou de cohérence stratégique. Le risque est de voir se consolider une logique de sous-traitance, incompatible avec les ambitions politiques affichées.
Dans ce nouveau paysage, la capacité à exister industriellement repose sur une approche systémique. Cela suppose d’orchestrer les investissements, de fédérer les capacités de recherche, d’anticiper les ruptures diplomatiques et de sécuriser l’accès aux matières premières critiques. Sans cette dynamique, les ambitions d’autonomie resteront formelles. L’Europe n’a pas besoin d’une autosuffisance illusoire, mais d’une souveraineté effective dans la gestion des interdépendances.
L’Europe face à un nouvel ordre technologique
Les propos de Donald Trump ne font qu’exprimer une réalité en cours de structuration. Les technologies clés, notamment dans l’intelligence artificielle, sont en passe de devenir des biens régulés, réservés, soumis à conditions. L’accès à ces ressources ne sera plus neutre, il dépendra de la position géopolitique, de la confiance bilatérale, du statut d’allié ou de concurrent. Dans ce cadre, l’Europe ne peut plus se contenter d’être une zone de consommation technologique. Elle doit devenir une zone de conception, de fabrication et de décision stratégique. Faute de quoi, elle restera exposée aux dynamiques imposées par d’autres.
La souveraineté technologique ne se décrète pas. Elle s’organise, se finance, se défend. Le signal venu de Washington, après celui venu de La Haye et de Pékin, rappelle qu’il n’y a pas de neutralité possible dans l’économie de la puissance. Les chaînes de valeur ne sont plus seulement optimisées, elles sont orientées, protégées, voire instrumentalisées. L’Europe entre dans cette zone de turbulences avec un temps de retard et des moyens dispersés. Elle doit désormais décider si elle souhaite peser dans ce nouvel ordre technologique ou en subir les termes.