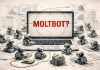Une enquête Heroiks Pulse révèle une transformation profonde des habitudes de recherche d’information chez les Français, portée par la génération Z. Usage quotidien de l’IA générative, recul des moteurs traditionnels, confiance redistribuée, ces mutations esquissent les contours d’une nouvelle culture cognitive numérique, avec des effets déjà mesurables sur les secteurs clés.
Les comportements numériques évoluent rarement par à-coups, mais lorsqu’une génération adopte massivement de nouveaux outils, les effets sont durables. C’est ce que confirme la dernière vague du baromètre Heroiks Pulse menée pour Peak Ace . La génération Z adopte de manière stable et intensive des pratiques de recherche d’information qui bousculent les repères établis. Alors que seuls 34 % des Français utilisent l’intelligence artificielle générative pour rechercher des informations, ce taux atteint 61 % chez les 18–24 ans, avec une fréquence quotidienne pour plus d’un tiers d’entre eux.
En parallèle, l’usage des réseaux sociaux à des fins informationnelles se généralise : 58 % des jeunes les mobilisent chaque jour dans cette optique. Loin d’un simple effet de mode, cette transition générationnelle reconfigure en profondeur l’écosystème cognitif des utilisateurs, et impose de nouvelles contraintes aux producteurs d’information, aux marques et aux éditeurs.
La bascule n’est pas seulement technologique, elle est cognitive. Les réflexes de recherche, la hiérarchisation des sources, les critères de fiabilité ou de pertinence changent de nature. Chez les jeunes générations, l’IA n’est plus une alternative, mais un point d’entrée. Elle est perçue comme plus rapide, plus pertinente et plus précise que les moteurs classiques. Cette perception n’efface pas la défiance, notamment en matière de protection des données ou de résultats trop génériques, mais elle indique un glissement vers une nouvelle grammaire de la recherche. Une grammaire dans laquelle l’interface, l’immédiateté et la personnalisation priment sur l’exhaustivité et la hiérarchisation algorithmique.
L’intelligence artificielle comme nouveau réflexe informationnel
Chez la génération Z, l’IA générative devient progressivement le support privilégié de la recherche active. Elle dépasse les moteurs de recherche en précision perçue (38 % contre 34 %), talonne ces derniers en rapidité (34 % contre 41 %) et s’impose comme le canal le plus efficace pour 34 % des jeunes interrogés. Ces usages dépassent largement le simple recours à ChatGPT, plébiscité par 93 % des utilisateurs Gen Z, pour inclure des services à forte valeur ajoutée : tutoriels, recommandations, inspiration, mais aussi santé, finance et alimentation. La diversification des cas d’usage montre une appropriation de l’IA qui ne se limite pas à l’expérimentation ou au divertissement, mais s’ancre dans des besoins concrets, quotidiens et multisectoriels.
Ce mouvement s’accompagne d’un double paradoxe. D’une part, les doutes sur la fiabilité des résultats, la confidentialité ou la complexité d’usage n’ont pas disparu. D’autre part, ces freins ne ralentissent pas l’adoption, bien au contraire. C’est dans un contexte d’« efficacité perçue », où la performance fonctionnelle prime sur l’autorité de la source, que s’impose la recherche assistée. L’IA devient ainsi un médiateur cognitif à part entière, capable de rivaliser avec les portails spécialisés ou les forums dans les parcours d’accès à l’information, y compris sur des sujets sensibles.
Les réseaux sociaux : d’outils de veille à interfaces de recherche
Les réseaux sociaux conservent une place importante dans les pratiques informationnelles des jeunes, bien qu’ils subissent une forme d’érosion sur certains critères qualitatifs. La Gen Z les utilise principalement pour suivre l’actualité (61 %), découvrir des tendances (57 %) ou accéder à des tutoriels (55 %). Toutefois, leur crédibilité s’affaiblit : seuls 22 % des répondants les jugent fiables pour obtenir des réponses pertinentes, et leur usage quotidien se stabilise après plusieurs vagues de progression. TikTok, YouTube et Instagram dominent, mais chacun selon des logiques distinctes : le premier pour la recherche immersive, le second pour la didactique, le troisième pour la recommandation sociale.
Ce repositionnement des réseaux en tant que canal de recherche secondaire mais utilitaire pousse les entreprises à reconsidérer leur stratégie de contenus. Il ne suffit plus de diffuser, il faut penser en termes d’interaction informationnelle, de structuration des réponses, de scénarisation algorithmique. La recherche sociale s’inscrit désormais dans une logique d’indexation horizontale, où l’expérience utilisateur prévaut sur le référencement classique. Cela implique pour les acteurs des médias, du commerce et des services d’intégrer nativement des formats de réponse contextualisés et conversationnels, souvent adossés à des IA embarquées.
Une carte des usages qui varie selon les secteurs
L’étude met également en lumière une segmentation sectorielle des comportements, qui confirme la sophistication croissante des pratiques Gen Z. Sur les sujets liés à la santé, 56 % des jeunes s’informent via l’IA contre 28 % via les moteurs. En matière bancaire, 54 % privilégient aussi l’IA. Seul le secteur de la mode voit les réseaux sociaux dominer avec 59 % d’usage prioritaire chez les jeunes, mais même là, les outils IA progressent (27 %). Cette granularité révèle une capacité à mobiliser le bon canal selon la nature de l’information recherchée, signe d’une acculturation numérique avancée.
Les moteurs de recherche restent dominants dans la population générale, mais ils perdent du terrain sur les critères stratégiques : précision, rapidité, simplicité. Et dans certains domaines comme les services financiers, les jeunes affichent déjà une rupture cognitive. L’IA y est perçue comme plus performante et plus digne de confiance. La capacité à formuler des requêtes pertinentes, enjeu longtemps réservé aux moteurs, est désormais transférée à l’interface elle-même, suggérant une nouvelle ère d’autonomisation assistée.
Vers un nouvel arbitrage de la valeur informationnelle
Ce que révèle en filigrane cette étude, c’est une redistribution profonde des référentiels cognitifs. Pour les digital natives, la valeur d’une information ne dépend plus de son origine, mais de sa capacité à répondre vite, bien, et sans friction. Ce renversement interpelle tous les acteurs de l’économie numérique : entreprises, administrations, éditeurs, prestataires. Il impose de revoir non seulement les interfaces, mais aussi les métriques de performance informationnelle. Les stratégies centrées sur le SEO classique, la notoriété de marque ou l’expertise éditoriale doivent désormais composer avec des logiques de recommandation algorithmique, de personnalisation adaptative et de fluidité transactionnelle.
À mesure que l’IA s’impose comme intermédiaire, puis comme coproducteur de la connaissance, les organisations sont confrontées à un défi d’alignement : comment maintenir une présence informationnelle fiable et utile dans un environnement où les réflexes cognitifs ont changé de paradigme ? Les réponses émergent peu à peu, souvent portées par les jeunes eux-mêmes, prescripteurs exigeants d’un nouvel ordre numérique.