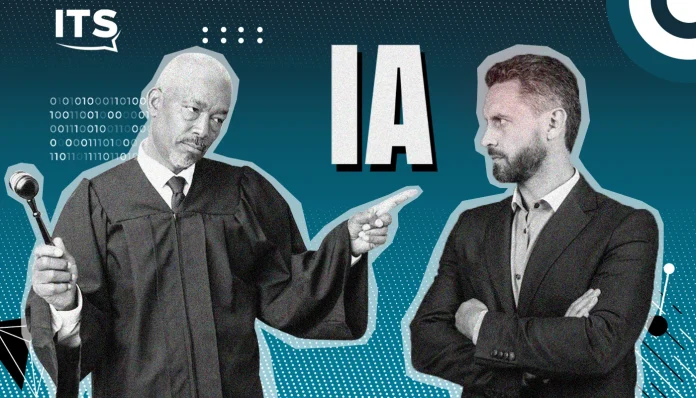La régulation de l’intelligence artificielle ne résulte pas seulement d’un arbitrage entre innovation et sécurité. Elle est aussi le produit d’un jeu stratégique entre gouvernements et entreprises, dans lequel les acteurs privés déploient des tactiques sophistiquées pour peser sur les législations, verrouiller les marchés et imposer leurs standards. Un article de recherche récent en propose une modélisation éclairante.
Loin d’être un exercice technocratique neutre, la régulation de l’intelligence artificielle constitue aujourd’hui un terrain de lutte géopolitique et économique, où se croisent des intérêts souverains, industriels et commerciaux. L’article académique des professeurs Filippo Lancieri, Laura Edelson et Stefan Bechtold propose une lecture dynamique de cette régulation, analysée comme un jeu à plusieurs niveaux : entre gouvernements, entre entreprises, et entre gouvernements et entreprises. Ce modèle met en lumière les mécanismes d’arbitrage réglementaire, de capture stratégique et de fragmentation normative.
Cette analyse s’appuie sur les travaux (AI Regulation: Competition, Arbitrage & Regulatory Capture) de trois auteurs issus d’institutions académiques de référence. Filippo Lancieri est professeur associé à la Georgetown University Law Center et chercheur au Stigler Center de la Chicago Booth School of Business, spécialiste de l’économie politique de la régulation et des dynamiques de pouvoir sur les marchés numériques. Laura Edelson, informaticienne de formation, enseigne à la Northeastern University après avoir été Chief Technologist à la division des droits civiques du département de la Justice américain. Ses recherches portent sur la transparence algorithmique et les manipulations de l’information. Stefan Bechtold, enfin, enseigne le droit de la propriété intellectuelle à l’ETH Zurich, où il étudie les interactions entre régulation, plateformes numériques et innovation algorithmique. Leur approche interdisciplinaire permet de croiser droit, informatique et théorie des organisations pour éclairer les ressorts stratégiques de la régulation de l’IA.
Trois étapes structurent ce « jeu réglementaire » : l’initiative publique (réguler ou non), la réaction privée (conformité, contournement ou retrait), puis la contre-réaction publique (extraterritorialité, harmonisation ou isolement). Cette modélisation prend tout son sens à travers les cas concrets de Google, Apple, Meta ou encore les arbitrages fiscaux en Europe, qui démontrent comment la régulation devient un outil de pouvoir, souvent dévoyé de son objectif initial de protection de l’intérêt général.
Apple et l’habillage stratégique de la conformité réglementaire
Le cas d’Apple illustre parfaitement la manière dont une entreprise peut transformer une contrainte réglementaire en levier d’influence. Contraint par une directive européenne imposant l’adoption du port USB-C sur les appareils électroniques, et après avoir résisté, Apple a choisi d’étendre ce standard à l’ensemble de ses marchés. Cette décision, présentée comme un engagement pro-consommateur, relève en réalité d’un calcul économique rationnel : mieux vaut absorber la norme la plus exigeante que fragmenter son offre et perdre en économies d’échelle.
Ce type de stratégie permet à une entreprise de préserver son écosystème propriétaire (en l’occurrence, le contrôle sur les accessoires certifiés), tout en se posant en acteur coopératif, évitant ainsi des accusations de résistance à la régulation. Le cas d'Apple démontre que les entreprises peuvent « préempter » une régulation en l’adoptant selon leurs termes, transformant la contrainte juridique en atout concurrentiel.
Google Books et l’arbitrage de juridiction comme tactique d’expansion
Autre illustration marquante, le projet Google Books, qui a permis à l’entreprise de numériser des millions d’ouvrages en s’appuyant sur la doctrine du « fair use » américaine, tout en rendant le service accessible depuis l’Union européenne. Ce choix délibéré de localisation de l’entraînement (scanning des livres aux États-Unis) a permis à Google d’éviter les contraintes du droit d’auteur européen, fondé sur le principe de territorialité.
Ce cas montre comment une entreprise peut exploiter les failles de coordination réglementaire entre juridictions pour asseoir une position dominante dans un nouveau domaine, sans avoir à se soumettre aux règles locales. Il préfigure les débats actuels sur la portée extraterritoriale de l’AI Act européen, notamment en matière de conformité au droit d’auteur lors de l’entraînement des modèles.
Meta et la menace du retrait comme outil d’influence
Face à la montée des exigences réglementaires européennes (AI Act, RGPD, Digital Services Act), Meta déploie une autre stratégie, la politique de la chaise vide avec la menace de non-déploiement. L’entreprise a suspendu le lancement de ses derniers modèles d’IA en Europe, arguant d’un cadre réglementaire trop flou ou contraignant. Ce type de réaction vise à peser sur les arbitrages politiques, en suggérant que l’Europe pourrait être privée d’innovations majeures faute de flexibilité normative. C'est exactement la tactique utilisée par Apple pour ses AirPods3. Apple réserve sa nouvelle fonction de traduction simultanée « Live Translation » à ses clients hors Union européenne : les utilisateurs européens d’AirPods Pro 3 ne pourront pas y accéder au lancement, bien que les écouteurs y soient commercialisés. Une manière pour Apple de subordonner l’innovation à ses propres conditions de souveraineté.
Cette posture s’inscrit dans une logique de conflit d’interprétation et de rapport de force, où l’incertitude juridique devient le prétexte à une arme tactique : la coercition par le vide commercial. Il ne s’agit pas tant de refuser la régulation que d’en négocier les modalités par la pression économique. C’est une variante sophistiquée de la capture réglementaire, qui ne passe plus par le lobbying direct mais par des signaux envoyés aux marchés et aux décideurs.
La fragmentation comme stratégie consolidante
L’article met également en évidence un paradoxe stratégique : si les entreprises redoutent en théorie la fragmentation des normes, certaines peuvent y trouver un avantage, notamment pour préserver des positions monopolistiques via des standards propriétaires. Loin de chercher une harmonisation mondiale, certaines entreprises exploitent la divergence des régimes juridiques pour optimiser leurs marges, tester des modèles dans des zones moins régulées, ou influencer à la marge les législations les plus contraignantes.
C’est ainsi que l’on voit émerger des comportements opportunistes dans le choix des juridictions (Irlande, Singapour, Émirats, etc.), une rareté croissante de données accessibles pour l’entraînement des modèles (fermeture des communs numériques), et une pression croissante sur les législateurs pour réviser les cadres protecteurs (AI Act, RGPD). Le risque est alors celui d’une course vers le plus bas réglementaire, le moins-disant en matière de protection des usages et des utilisateurs, où les standards privés deviennent la norme de facto faute d’alternative coordonnée.