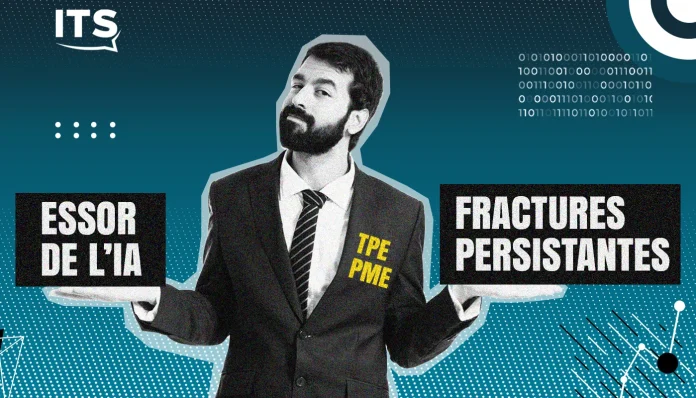La sixième édition du Baromètre France Num révèle une stabilisation des usages numériques dans les petites entreprises, mais aussi des disparités marquées selon la taille, le secteur ou le profil des dirigeants. Si l’intelligence artificielle connaît une adoption fulgurante, la cybersécurité inquiète toujours plus, tandis que les démarches de sobriété numérique régressent.
En 2025, 78 % des dirigeants de TPE et PME déclarent percevoir un bénéfice réel du numérique pour leur entreprise. Un chiffre stable depuis trois ans, qui confirme l’ancrage des outils digitaux dans les pratiques courantes. Néanmoins, seuls 40 % y voient un levier d’augmentation du chiffre d’affaires, et à peine 34 % estiment qu’il accroît leur rentabilité. Cette dissociation entre usage perçu et valeur économique interroge la capacité des entreprises à tirer un retour sur investissement réel de leur transformation numérique.
Le décalage est d’autant plus frappant que 81 % des répondants utilisent désormais des outils collaboratifs (messagerie instantanée, plateformes de partage…), et que 88 % disposent d’au moins une solution de gestion. En matière de visibilité, 84 % sont présentes en ligne, mais seuls 27 % disposent d’un canal de vente numérique. Le numérique est donc bien là, mais son pilotage stratégique reste flou, comme en témoigne la difficulté à évaluer son impact concurrentiel (38 % seulement estiment qu’il leur permet de se démarquer).
L’intelligence artificielle accélère… sans modèle d’exploitation généralisé
L’élément marquant de cette édition 2025 est la forte progression de l’IA. Une entreprise sur quatre (26 %) déclare utiliser au moins un outil à base d’intelligence artificielle, contre 13 % un an plus tôt. Les usages sont majoritairement centrés sur la génération de texte, d’image ou de voix (22 %), et sur les assistants conversationnels ou agents de recherche (14 %). À l’inverse, les usages industriels (détection, classification, automatisation) restent marginaux, en deçà de 6 % chacun.
Ce dynamisme ne masque pas les écarts persistants : les entreprises du secteur numérique (NTIC) sont 56 % à utiliser l’IA, contre 9 % dans l’agriculture. De même, 42 % des PME de 50 à 249 salariés sont équipées, contre 23 % des structures de 1 à 4 salariés. Les dirigeants de moins de 30 ans sont deux fois plus enclins à utiliser l’IA que ceux de plus de 70 ans. Ces disparités révèlent une fracture de maturité, qui pourrait se creuser à mesure que l’IA s’impose comme nouvel étalon de productivité.
La cybersécurité comme priorité structurelle, mais réactive
Face à la montée des menaces, 84 % des entreprises déclarent disposer d’une solution de cybersécurité, un taux en progression régulière. Toutefois, l’approche reste encore centrée sur les outils de base : antivirus (96 %) et sauvegarde externe (82 %) dominent largement, tandis que l’authentification multifacteur (44 %) ou la sensibilisation des équipes (32 %) peinent à s’imposer. Le recours à un référent sécurité n’est effectif que dans 26 % des cas.
Malgré ces efforts, 36 % des répondants ont déjà subi au moins un incident, le plus fréquent étant l’hameçonnage (21 %), suivi des infections par maliciel (16 %). L’inquiétude croît : 52 % des dirigeants déclarent aujourd’hui craindre pour la sécurité de leurs données, soit un gain de 16 points depuis 2020. Une tendance qui suggère un déficit de culture proactive en cybersécurité, dans un contexte où les dépendances numériques s’intensifient.
Un recul préoccupant de la sobriété numérique
Alors que la transition écologique des usages numériques est devenue un enjeu transversal, les indicateurs montrent un essoufflement. La proportion d’entreprises ayant mis en place une action de réduction de la consommation énergétique chute de 6 points (58 %), et celle du recyclage des équipements reste stable (53 %). L’écoconception de solutions n’est citée que par une minorité.
Ces données traduisent une forme de saturation ou de dépriorisation, malgré la les réglementations (CSRD, DPEF…) et des exigences des clients. La dynamique de sobriété semble fragilisée, y compris dans les secteurs pourtant exposés (industrie, NTIC). Ce retrait intervient alors même que le numérique se déploie toujours davantage dans les processus métiers et la gestion des données.
Des écarts de maturité renforcés… et des indicateurs à reconsidérer
La typologie des usages numériques reste fortement corrélée à la formation, à l’âge du dirigeant et à la taille de l’entreprise. Ainsi, 55 % des entreprises déclarent disposer de compétences numériques en interne (+9 points), mais ce taux dépasse 70 % dans les PME de plus de 50 salariés, contre 34 % chez les indépendants sans salarié. Le niveau de formation du dirigeant joue un rôle fondamental : 36 % des diplômés Bac+3 et plus utilisent l’IA, contre 8 % chez les dirigeants sans le bac.
Les investissements suivent la même logique : 42 % des entreprises ont engagé plus de 1 000 € dans leur transformation numérique, tandis que 25 % n’y ont rien consacré. En somme, la polarisation s’accentue, freinant l’émergence d’un tissu homogène de TPE PME numériquement autonomes. Le manque de temps reste le principal obstacle à la formation (55 %), devant le coût ou l’accès à des prestataires adaptés.
Mais un autre signal mérite relecture : seuls 36 % des dirigeants déclarent avoir un projet numérique en cours, soit un recul de 6 points en un an. En apparence, cette baisse pourrait être interprétée comme une forme de démobilisation. En réalité, elle reflète un changement de paradigme. L’arrivée de l’IA, et plus encore l’irruption des agents dans les architectures applicatives, a mis fin au cycle des projets logiciels classiques. Les applications existantes ne sont plus mises à jour selon un modèle fonctionnel ou modulaire ; elles sont refondues ou augmentées par des capacités d’inférence, d’automatisation ou de dialogue. Autrement dit, la seule voie d’évolution consiste désormais à intégrer l’IA dans le cœur même des outils métiers.
Cette rupture freine mécaniquement la projection dans des projets traditionnels, faute de doctrine claire sur les retours sur investissement, les architectures cibles ou les cadres d’usage. Le débat ouvert sur la valeur réelle de l’IA dans les TPE PME crée un effet de sidération. Les indicateurs classiques du volontarisme numérique deviennent dès lors trompeurs : ils ne saisissent ni les dynamiques expérimentales à l’œuvre, ni les arbitrages en attente, ni l’effort de recomposition à bas bruit que suppose l’intégration de l’IA.