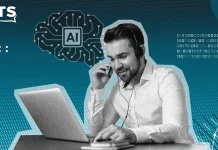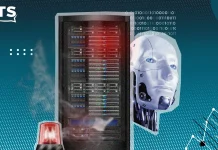Selon le baromètre Ifop–Acteurs Publics, 39 % des décideurs publics affirment utiliser le cloud souverain pour plus de la moitié de leurs charges de travail. Un chiffre qui traduit une adoption pragmatique, motivée par la sécurité et la conformité, mais aussi par la maturation progressive de l’écosystème des fournisseurs souverains.
La migration vers le cloud dans le secteur public n’est plus une hypothèse, mais un mouvement irréversible. Ce basculement ne se fait pas par adhésion idéologique, mais par nécessité fonctionnelle : sécuriser les données, garantir la continuité des services et répondre aux nouvelles obligations réglementaires. Dans ce contexte, la trajectoire d’adoption du cloud souverain apparaît comme le prolongement logique d’une stratégie numérique d’ensemble, alors même que l’offre souveraine française et européenne gagne en épaisseur avec des acteurs comme OVHcloud, NumSpot ou Outscale.
Le baromètre confirme une tendance nette : le recours croissant au cloud hybride et souverain. Pas moins de 34 % des décideurs publics privilégient une stratégie hybride, combinant clouds privés et publics, tandis que 17 % optent exclusivement pour le cloud public. Dans ce dernier cas, la préférence est largement marquée en faveur du cloud souverain, plébiscité par 81 % des répondants. L’approche n’est pas dogmatique : les administrations arbitrent en fonction des contraintes techniques, réglementaires et budgétaires. Le cloud souverain apparaît comme un outil parmi d’autres, mais il s’impose progressivement pour les charges critiques, là où la sensibilité des données interdit toute concession.
Cette adoption traduit un pragmatisme assumé : les administrations cherchent à concilier ouverture aux technologies disponibles et maîtrise des infrastructures. Les modèles d’architecture évoluent ainsi vers une hybridation pilotée, où le souverain n’est pas une option marginale, mais un élément central de la stratégie. Le mouvement suit une trajectoire déjà amorcée par de grands projets publics et hospitaliers, qui renforcent la légitimité d’un modèle européen de cloud de confiance.
Des priorités de transformation guidées par la modernisation et l’IA
Les priorités affichées par les décideurs témoignent d’une continuité avec les chantiers structurants de l’État plateforme. La modernisation des systèmes d’information arrive en tête (47 %), à égalité avec l’accélération de l’usage de l’intelligence artificielle (47 %). Le développement de services numériques pour les citoyens et les patients occupe la troisième place (39 %), confirmant que la finalité de la transformation numérique reste l’amélioration de la relation usager. Ces priorités orientent mécaniquement les choix d’infrastructures et expliquent en grande partie le recours au cloud souverain.
L’intégration de l’IA constitue un facteur décisif. Les administrations ne peuvent pas se limiter à une modernisation technique ; elles doivent ouvrir leurs infrastructures aux nouveaux usages cognitifs. Cela suppose des environnements sécurisés, conformes au RGPD, mais aussi capables d’héberger des modèles d’IA souverains. Le cloud souverain devient ici une condition d’industrialisation, sans laquelle l’innovation publique resterait cantonnée à des expérimentations isolées.
Des charges de travail transférées aux clouds souverains
Le baromètre illustre une hiérarchisation claire des workloads confiés au cloud souverain. Les services numériques à destination des citoyens et des patients arrivent en tête (46 %), suivis des plans de continuité et de reprise d’activité (46 %) et des projets d’IA générative (46 %). L’hybridation IT, souvent évoquée comme un levier, ne concerne que 22 % des répondants. Les administrations choisissent donc de transférer en priorité les applications là où la sécurité, la disponibilité et la conformité réglementaire constituent des prérequis absolus.
Cette dynamique marque une trajectoire prévisible : d’abord cantonné aux environnements les plus sensibles, le cloud souverain tend à se diffuser vers des usages plus variés, à mesure que l’écosystème gagne en maturité. La logique est celle d’un cercle vertueux : plus les charges critiques migrent, plus la confiance dans l’offre souveraine s’ancre, et plus l’adoption s’étend vers des services connexes. La bascule se fait par strates, mais elle dessine déjà un socle structurant pour l’informatique publique.
Des critères de choix marqués par la souveraineté juridique
La hiérarchie des critères exprimés dans l’enquête souligne la priorité absolue accordée à la sécurité et à la souveraineté juridique. Le renforcement de la sécurité des données arrive en tête (71 %), devant la non-exposition aux lois extraterritoriales (43 %) et la qualification SecNumCloud (40 %). L’accès aux technologies et la réduction des coûts, critères traditionnellement dominants, ne figurent qu’en second plan (35 % chacun). Cette inversion traduit une évolution culturelle profonde : les décideurs publics privilégient la maîtrise du cadre légal et de la conformité plutôt que la seule performance technologique.
Ces arbitrages ne relèvent pas d’une crispation défensive, mais d’une logique d’anticipation. La multiplication des obligations réglementaires européennes, de l’AI Act au Data Act, oblige les organisations à se prémunir de toute dépendance risquée. Le cloud souverain, qualifié SecNumCloud et ancré en Europe, fournit une réponse cohérente à cette exigence. Les fournisseurs souverains s’alignent sur cette attente, en multipliant les certifications, les offres de conformité et les garanties contractuelles. L’écosystème évolue ainsi au rythme de la demande publique.
La convergence entre cloud souverain et IA souveraine s’impose
L’enquête révèle une sensibilité particulière à la nature de l’actionnariat : 88 % des répondants se disent favorables à un fournisseur de cloud à actionnariat public majoritaire, une tendance marquée dans les hôpitaux et les administrations d’État. Cette attente illustre le besoin d’un pacte de confiance renforcé, où la gouvernance de l’infrastructure reflète l’intérêt général. En parallèle, 80 % des répondants jugent cruciaux l’hébergement souverain des données et l’usage de modèles d’IA locaux dans leurs projets. La convergence entre cloud souverain et IA souveraine s’impose comme un axe stratégique de l’innovation publique.
Ces résultats traduisent aussi une évolution de l’offre. Après une première phase dominée par quelques pionniers (Outscale, OVHcloud), l’écosystème s’est étoffé avec NumSpot, né du rapprochement entre la Banque des Territoires, Docaposte, Dassault Systèmes et Bouygues Télécom. Ces initiatives consolident une filière européenne crédible, en réponse aux critiques sur la dépendance aux hyperscalers américains. L’adoption pragmatique du cloud souverain dans le secteur public alimente donc un double mouvement : une gouvernance plus souveraine côté clients, et une montée en gamme de l’offre côté fournisseurs.
À terme, cette adoption pragmatique devrait dessiner un paysage plus structuré : des clouds souverains compétitifs et certifiés, des administrations moins dépendantes des solutions extraterritoriales, et une innovation publique capable de concilier l’efficacité et la confiance. Pour les directions informatiques du secteur public, la trajectoire est claire : il s’agit moins de choisir entre souveraineté et performance que de composer un équilibre durable entre les deux.