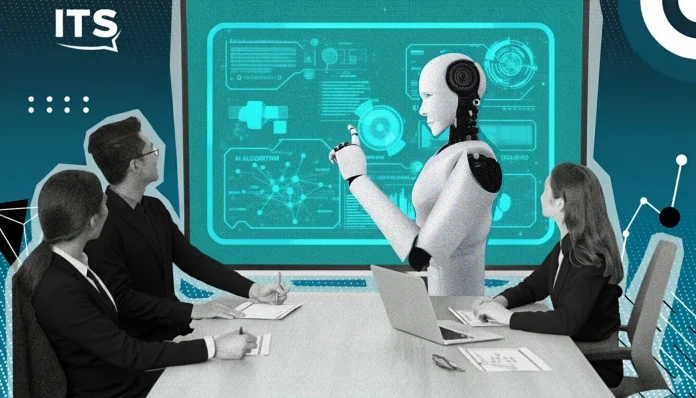Une étude d’IWG met en lumière le rôle moteur de la génération Z dans l’adoption de l’intelligence artificielle au sein des organisations. Mais au-delà des constats générationnels, c’est un changement structurel de la formation professionnelle qui s’esquisse : l’IA déstabilise les modèles pédagogiques établis et impose une acculturation fluide, distribuée, portée par les salariés eux-mêmes.
À première vue, l’étude menée par IWG en juin 2025 semble valoriser la figure bien connue du « digital native formateur » : 59 % des jeunes employés aideraient leurs collègues plus anciens à adopter les outils d’IA. Mais cette relation inversée n’est pas un simple transfert de compétences techniques. Elle révèle un effacement progressif de la formation institutionnelle au profit d’une circulation en situation, spontanée et incrémentale du savoir. La génération Z, en facilitant cette appropriation au quotidien, joue moins un rôle de pédagogue que de catalyseur d’acculturation contextuelle. Pour rappel, IWG, ou International Workplace Group plc, est une entreprise helvétique spécialisée dans les espaces de travail flexibles.
On retrouve cette logique dans l’étude Gallup 2025 sur l’usage managérial de l’IA où 64 % des managers interrogés déclaraient apprendre les usages d’outils IA « via leurs collaborateurs directs ou leurs pairs », contre 18 % seulement via des modules RH formels. C’est donc l’environnement de travail, et non l’environnement de formation, qui devient le lieu principal de l’apprentissage.
L’IA échappe aux méthodes de formation traditionnelles
L’incapacité des modèles pédagogiques classiques à intégrer l’IA n’est pas conjoncturelle, mais structurelle. L’interaction avec des agents génératifs, des copilotes ou des assistants cognitifs ne se laisse pas modéliser par un référentiel fixe. Comme le rappelle une récente tribune publiée dans la Harvard Business Review, « il n’existe pas de compétence universelle en IA, seulement des postures d’appropriation adaptatives ». L’apprentissage devient alors hautement individualisé, fortement lié au contexte métier, au style de travail, et à la maturité numérique de chacun.
Face à cette plasticité, les modules de e-learning ou les parcours certifiants traditionnels apparaissent inopérants. Ce constat rejoint le rapport McKinsey 2025 sur le leadership à l’ère cognitive : seulement 28 % des responsables L&D (Learning and Development) estiment que leurs programmes actuels sont adaptés aux usages de l’IA de leurs collaborateurs. Le véritable apprentissage se fait ailleurs : dans les échanges informels, les tentatives ratées, souvent dans les usages détournés aussi, et dans la capacité à tirer des enseignements de l’expérience directe avec la machine.
La formation devient un processus distribué, contextuel, auto-régénératif
L’étude IWG confirme une tendance plus vaste : celle de la formation comme propriété émergente du collectif. Lorsque 66 % des 25-34 ans déclarent former leurs collègues, il ne s’agit pas d’un rôle formel, mais d’un phénomène horizontal, presque invisible, qui repose sur la circulation quotidienne des savoirs. Workday, dans son baromètre 2025 sur les attentes des salariés face à l’IA, observe une montée claire des préférences pour les formats « pair-à-pair », « mentoring inversé » et « tutoriels pratiques », au détriment des formations descendantes centralisées.
Cette transformation se manifeste aussi dans les usages : notes de réunion automatisées, reformulations d’e-mails, documentation générative. L’IA devient à la fois outil de travail et média de formation. Le savoir ne précède plus l’usage, il en découle, et se diffuse en temps réel via les interactions avec les agents intelligents et les autres membres du collectif.
Une opportunité pour les RH : faciliter, plutôt que formaliser
Ce modèle distribué oblige les fonctions RH à changer de posture. Il ne s’agit plus de planifier l’apprentissage, mais de créer les conditions pour qu’il advienne. Dans l’étude Workday, 62 % des collaborateurs déclarent que les meilleures initiatives IA sont venues de leur propre équipe, sans impulsion centrale. L’enjeu devient alors d’identifier, de valoriser et de capitaliser sur ces dynamiques émergentes.
Les départements formation peuvent jouer un rôle clé, non plus comme producteurs de contenu, mais comme facilitateurs de partage : en documentant les cas d’usage, en orchestrant les retours d’expérience, en développant des communautés de pratique. Le management intermédiaire, quant à lui, se transforme en « médiateur de savoirs » — une redéfinition parfaitement analysée dans le rapport Gallup, qui souligne le repositionnement des managers comme animateurs de l’apprentissage continu, et non comme relais de consignes descendantes.
Pour les organisations, l’urgence d’une culture de la compétence vivante
Ce basculement impose aux organisations d’adopter une nouvelle culture de la compétence, plus vivante, plus fluide, plus distribuée. Le rapport McKinsey évoque une transition nécessaire vers des « compétences adaptatives » (adaptive skills), qui évoluent en permanence à l’intersection des outils, des situations et des besoins terrain. Les entreprises les plus agiles sont déjà en train de créer des environnements propices à l’auto-apprentissage et à l’expérimentation guidée par l’usage, et non par l’objectif académique.
L’enjeu n’est donc pas simplement d’enseigner l’IA, mais d’apprendre à apprendre avec l’IA. Et surtout, d’apprendre à apprendre autrement. C’est là que se joue la différenciation entre les organisations figées dans une logique de conformité, et celles capables de cultiver des collectifs apprenants, capables de naviguer dans l’incertitude technologique. L’étude IWG, en montrant que la compétence IA est avant tout relationnelle, évolutive et située, sonne une alerte précieuse : le formateur classique disparaît, mais la formation est partout. Encore faut-il savoir la reconnaître, la soutenir — et la faire fructifier.