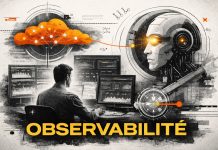Après avoir mené le marché des semiconducteurs et déterminé son évolution pendant un bon demi-siècle de leadership, Intel a fini par succomber au « péché » des entreprises dominantes : croire que sa suprématie technologique et son empreinte industrielle suffiraient à garantir sa pérennité. En s’enfermant dans une logique de volume, de cycles maîtrisés et de domination de l’architecture x86, le fondeur a progressivement perdu sa capacité à anticiper les ruptures structurelles : l’émergence du mobile, la montée en puissance d’ARM, l’essor du cloud, puis l’industrialisation rapide de l’intelligence artificielle. La crise actuelle ne résulte pas d’un accident, mais d’une accumulation de décalages stratégiques. Et la cure engagée — suppression de postes, réorganisation, recentrage — relève autant un effort de redressement que d’une incertitude persistante sur le modèle à suivre.
Intel annonce ainsi le départ de Michelle Johnston Holthaus, directrice des produits, après plus de trente ans au sein du groupe. Elle reste temporairement en tant que conseillère stratégique, tandis que l’organigramme est simplifié avec d’importantes divisions rapportant désormais directement au PDG Lip‑Bu Tan.
Une réduction drastique des effectifs
Ce remaniement est la partie visible d’une vague plus large de changements : le directeur de la stratégie, Safroadu Yeboah‑Amankwah, a quitté ses fonctions à la fin juin, redistribuant ses responsabilités au sein de l’équipe dirigeante, notamment vers le CTO et le responsable IA. Le groupe prévoit de ramener ses effectifs à 75 000 d’ici fin 2025, contre 99 500 un an plus tôt, soit une contraction d’environ 15 %. Cette réduction s’effectue par vagues ciblées de licenciements, non-remplacements et plans d’attrition, avec une attention particulière portée aux fonctions de management intermédiaire, considérées comme trop lourdes et peu agiles.Malgré ces mesures d’ampleur, les perspectives financières d’Intel restent mitigées. Intel prévoit un chiffre d’affaires pour le troisième trimestre supérieur aux attentes (entre 12,6 et 13,6 milliards de dollars), mais anticipe une perte plus importante que prévu, estimée à 24 cents par action, contre 18 cents attendus. Pour redresser la barre, le nouveau PDG privilégie une stratégie basée sur la demande réelle (build-to-order), abandonnant la précédente approche de construction proactive d’usines. Plusieurs projets d’infrastructures aux États-Unis et en Europe (Ohio, Pologne, Allemagne) sont suspendus, et des opérations de packaging centralisées sont migrées (Costa Rica vers Vietnam/Malaisie). Dans ce paysage, la survie de la fonderie avancée est conditionnée à l’engagement de clients extérieurs, notamment pour le procédé 14A, tandis que le 18A pourrait être réservé à un usage interne. Rappelons que ces technologies avancées de gravure nanométrique sont les fer de lance de la (moribonde ?) stratégie IDM 2.0.
Une stratégie critiquée par un ancien PDG
Les tensions autour de la stratégie industrielle d’Intel ne se limitent pas à des signaux internes, elles suscitent également des prises de position critiques, y compris chez d’anciens dirigeants historiques. Craig Barrett, qui a dirigé Intel au début des années 2000, alerte sur la fragilité du modèle actuel, qu’il juge insuffisamment financé pour relever les défis de relocalisation et d’industrialisation avancée. Selon lui, seule une alliance stratégique regroupant les huit plus grands clients technologiques d’Intel — parmi lesquels Nvidia, Apple ou encore Google — pourrait permettre d’atteindre la masse critique. Il appelle ainsi à un effort collectif d’investissement à hauteur de 5 milliards de dollars par acteur, couplé à des mesures protectionnistes ciblées, notamment des droits de douane sur les puces importées, pour préserver la compétitivité des productions locales.Ces propositions de Craig Barrett relèvent moins d’un projet structuré que d’une « attaque de panique », mêlant pensée magique et nostalgie industrielle. En suggérant que les principaux clients d’Intel injectent chacun 5 milliards de dollars pour soutenir une production nationale, l’ancien dirigeant formule une suggestion (espérant être entendu par les autorités compétentes ?) plus politique qu’économiquement réaliste. Ni Apple, ni Nvidia, ni Google n’ont intérêt à financer un fondeur en perte de compétitivité, alors qu’ils s’appuient déjà sur des partenaires, comme TSMC ou Samsung, à la feuille de route éprouvée.
De même, l’idée d’instaurer des droits de douane sur les puces importées reflète une lecture protectionniste du marché, déconnectée des chaînes de valeur mondialisées et des interdépendances technologiques. Ces déclarations trahissent surtout un désespoir stratégique : celui d’un ancien leader confronté à l’érosion d’un modèle intégré, aujourd’hui mis en tension par l’externalisation, la spécialisation et la montée en puissance d’acteurs plus agiles. Elles rappellent combien Intel peine encore à articuler un récit industriel fédérateur, capable de convaincre à la fois les marchés, les partenaires et ses propres équipes.