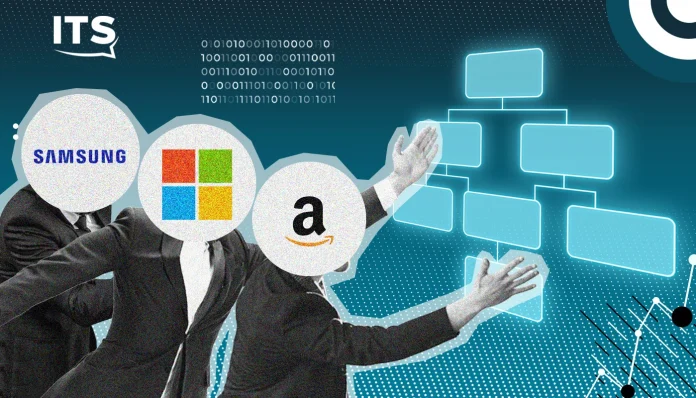Les annonces récentes — Microsoft avec Copilot, Amazon avec Alexa+, Samsung avec Ballie — confirment que l’ère de l’assistant IA « persistant » est déjà là. Au-delà des LLM, c’est une chaînes complètes, matériel, interface, infrastructure, qui se met en place. Dans ce modèle, l’IA n’est plus invoquée, elle est déjà intégrée, opérant en filigrane dans tous les contextes, sans frontière entre personnel et professionnel.
Le jour où l’IA disparaîtra comme fonction invocable bien visible, cela voudra dire qu’elle est partout. Enfin ubiquitaire. C’est précisément ce vers quoi convergent les stratégies actuelles des grands fournisseurs technologiques. Microsoft, Amazon, Samsung, et plusieurs autres ne se contentent plus de proposer des modèles de langage, ils bâtissent des écosystèmes complets où l’IA devient une présence persistante dans tous les usages numériques.
Des consoles de jeu aux enceintes connectées, des postes de travail aux robots domestiques, chaque point de contact est l’occasion d’insérer un agent logiciel apte à répondre, anticiper, agir. Cette dynamique transforme l’informatique : ce ne sont plus les utilisateurs qui vont vers les services, ce sont les services intelligents qui viennent à eux.
Microsoft a donné le ton avec trois annonces récentes. L’intégration de Gaming Copilot dans les jeux Xbox et PC inaugure une présence en temps réel de l’assistant IA dans les scénarios de loisir, avec interactions dynamiques, suggestions stratégiques et adaptation au gameplay. En parallèle, l’ajout d’un bouton « Partager avec Copilot » dans Windows 11 permet d’interagir avec l’IA depuis n’importe quel contenu, texte ou image.
Des agent IA dans tous les points d’entrée
Enfin, l’infrastructure suit : Microsoft construit à Mount Pleasant (Wisconsin) un centre de données « le plus puissant du monde pour l’IA », avec des grappes massives de GPU, du refroidissement liquide et des interconnexions à très faible latence. L’ensemble forme une chaîne logicielle et matérielle cohérente, prête à supporter une IA omniprésente.
Amazon, Samsung, Google, Meta ou encore les géants chinois ne suivent pas exactement les mêmes chemins que Microsoft, mais partagent un objectif commun : installer leur agent IA au plus près des usages, à travers des points d’entrée variés. Chacun choisit des contextes où la valeur ajoutée perçue de l’agent peut s’imposer naturellement.
Amazon concentre ses efforts sur l’environnement domestique. Avec Alexa+, l’entreprise propose une version enrichie de son assistant, plus proactive et multimodale, intégrée à des enceintes Echo, des téléviseurs Fire TV ou des dispositifs domotiques. Samsung, de son côté, privilégie l’écosystème d’objets connectés de la maison — électroménager, télévision, domotique — et introduit Ballie, un robot domestique mobile conçu comme un relais IA contextuel.
Google, avec Gemini, se positionne à la fois sur le smartphone, le navigateur Chrome et les objets connectés Nest, avec une logique de transversalité forte entre les usages personnels, la maison et les services en ligne. En Chine, des acteurs comme Baidu ou Alibaba développent des agents IA embarqués dans des interfaces vocales ou visuelles, intégrés à des véhicules, à des plateformes mobiles ou à des services cloud professionnels, le tout soutenu par des puces locales.
Un agent immergé dans le champ perceptif de l’utilisateur
Cette diversité de points d’ancrage montre que l’enjeu n’est pas seulement de proposer un assistant performant, mais de le rendre familier et indispensable à partir d’un contexte d’usage spécifique. Chaque fournisseur cherche la meilleure porte d’entrée pour déclencher une relation durable entre l’utilisateur et son agent.
De son côté, Meta investit une trajectoire tout aussi révélatrice, mais plus radicale : celle des lunettes de réalité augmentée comme interface numérique. En partenariat avec Ray-Ban, l’entreprise développe une nouvelle génération de lunettes connectées intégrant nativement l’agent Meta AI, basé sur son modèle Llama 3. L’interface, fondée sur la captation des gestes, du regard et des mouvements de tête, rompt avec les codes classiques du clavier ou de l’écran tactile. L’assistant y devient un interlocuteur spatial, capable de contextualiser ce que l’utilisateur voit, pointe ou interroge.
Cette approche prépare un futur où l’agent IA ne sera plus seulement accessible par invocation explicite, mais immergé dans le champ perceptif de l’utilisateur, en permanence. Le pari est de faire du corps humain lui-même une interface conversationnelle, et des lunettes un point d’entrée naturel vers une assistance omniprésente, toujours disponible, toujours en contexte.
L’interface n’est plus un bureau, mais un interlocuteur
Le modèle qui se dessine est celui de fournisseurs capables de proposer non seulement un agent logiciel, mais aussi un support matériel adapté, et l’infrastructure pour les faire fonctionner (agent, terminal et infrastructure). Cela permet une expérience utilisateur avec un contrôle de bout en bout. Ce modèle garantit aussi une meilleure maîtrise des coûts, de la performance, de la sécurité et de la conformité. Il transforme le logiciel en environnement incarné, où l’interaction vocale, visuelle ou contextuelle devient la norme.
Cette dynamique pénètre déjà le monde professionnel avec une trajectoire menant tout droit vers un modèle d’OS conversationnel et multimodal. Les utilisateurs, accoutumés à des agents IA dans leur quotidien, s’attendent à retrouver les mêmes facilités dans les logiciels métiers. Les DSI doivent anticiper : mettre en place une gouvernance des agents, définir des politiques de confidentialité, sécuriser les interactions, et adapter les architectures pour accueillir des agents proactifs capables d’agir sur les données et les processus. Les éditeurs, eux, devront repenser l’expérience utilisateur autour de l’agent comme point d’accès principal.
La trajectoire engagée par ces acteurs pointe vers un OS de nouvelle génération, où l’interface n’est plus un bureau, un menu ou une application, mais un interlocuteur. Ce paradigme bouleverse la façon dont les utilisateurs accèdent à la valeur numérique : ils ne « consultent » plus un système, ils lui parlent, le sollicitent, dialoguent avec lui. Les terminaux, qu’il s’agisse d’un casque, d’un assistant vocal, d’une console de jeu ou d’un PC de travail, deviennent les supports d’une interface omnicanale pilotée par l’IA.