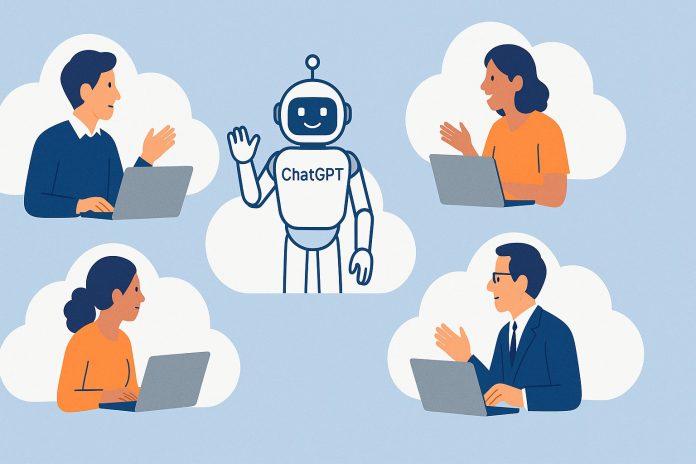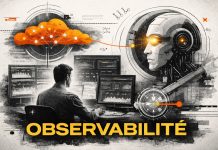OpenAI introduit un pilote de conversations de groupe dans ChatGPT, permettant à plusieurs participants d’échanger avec l’IA dans une même session. Ce mode collaboratif permet de fluidifier le travail collectif tout en préservant la confidentialité des données personnelles. Le déploiement démarre dans un nombre limité de régions avant une extension progressive.
Les outils collaboratifs évoluent rapidement, les éditeurs cherchant à intégrer l’IA au plus près des échanges humains. OpenAI s’inscrit dans cette trajectoire avec une nouvelle fonctionnalité pensée pour les interactions multiparticipants. Ainsi, le mode « groupe » permet de créer une conversation collective ou de convertir un échange existant en session partagée. Jusqu’à vingt utilisateurs peuvent intervenir, inviter d’autres membres et accéder au fil via un lien commun. Chaque participant crée un profil minimal pour être identifié dans le groupe, avec un nom, un pseudonyme ou une photo.
Dans cette configuration, GPT-5.1 Auto agit comme un « membre » du groupe : l’IA intervient lorsqu’elle est sollicitée ou lorsqu’elle estime utile d’apporter une réponse. Les réactions via émojis, la reconnaissance des interlocuteurs et la gestion du contexte multiparticipant sont intégrées dans cette première version.
Confidentialité renforcée et absence de mémoire partagée
OpenAI insiste sur la séparation stricte entre les conversations privées et les conversations de groupe. Les sessions collectives ne sont pas utilisées pour enrichir la mémoire personnelle de ChatGPT. Aucune mémoire persistante n’est générée à partir des échanges multiparticipants, ce qui marque une différence nette avec les usages individuels.
Le système repose sur des invitations explicites : les membres peuvent rejoindre ou quitter librement une session. Un contrôle parental spécifique est activé pour les mineurs afin de réduire l’exposition aux contenus sensibles dans les conversations partagées. L’initiative s’adresse en priorité aux équipes qui cherchent à combiner les interactions humaines avec l’assistance de l’IA, comme la préparation de documents, les échanges rapides, l’analyse conjointe ou les séances de travail guidées. Cette logique de collaboration hybride intéresse particulièrement les entreprises, les administrations et les fournisseurs de services qui adoptent progressivement l’IA dans leurs pratiques quotidiennes.
Les organisations s’y intéressent pour plusieurs raisons structurelles. Elles cherchent d’abord à réduire le coût invisible de la coordination, qui absorbe une part croissante du temps de travail dans les équipes distribuées. La capacité d’un agent conversationnel à intervenir au fil des échanges, à reformuler un point bloquant ou à générer une synthèse instantanée devient un levier de fluidité difficile à ignorer. Les entreprises, les administrations et les fournisseurs de services y voient également un moyen de rapprocher l’IA de leurs usages réels, sans imposer un nouvel outil ni perturber les habitudes de travail déjà ancrées.
Enfin, l’intégration de l’IA dans un espace partagé limite les frictions entre métiers et équipes techniques. L’information circule plus vite, les décisions se formalisent mieux et les tâches répétitives s’automatisent au fil des discussions. Cette combinaison entre interaction humaine et assistance automatisée répond donc à un besoin concret de simplification, d’efficacité et de continuité opérationnelles.
La fonctionnalité est lancée en phase pilote au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Corée du Sud et à Taïwan. Les versions Free, Go, Plus et Pro sont concernées, avec pour objectif d’observer les usages avant un déploiement mondial et une intégration potentielle dans les environnements professionnels.
Un compromis entre confidentialité et continuité opérationnelle
La gestion technique de conversations multi-utilisateurs impose une orchestration complexe pour maintenir la cohérence du contexte, traiter les messages simultanés et ajuster la prise de parole automatique de l’IA. Cette expérimentation sert de banc d’essai pour les futures architectures conversationnelles multiagents. Le périmètre demeure toutefois limité, car cette approche soulève un paradoxe : l’absence de mémoire partagée sécurise les échanges et protège les équipes contre toute captation involontaire d’informations sensibles, mais elle prive les groupes d’une continuité pourtant essentielle dans les projets au long cours. Aucun fil décisionnel n’est conservé, aucune règle de travail n’est retenue, aucune préférence n’est réappliquée d’une session à l’autre. Dans des environnements où les dossiers s’étendent sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, cette discontinuité empêche l’IA de s’ancrer durablement dans les pratiques collaboratives.
Les entreprises, les administrations et les fournisseurs de services se trouvent donc face à un arbitrage délicat entre confidentialité stricte et thésaurisation collective. La garantie d’étanchéité offerte par ce mode sans mémoire est appréciable, mais le coût invisible d’une IA qui recommence à zéro à chaque session est aussi mesurable. La prochaine étape consistera à concevoir des mécanismes de continuité contextualisée sans renoncer aux exigences de protection des données, un enjeu qui façonnera l’évolution de ces outils collaboratifs dans les mois à venir.