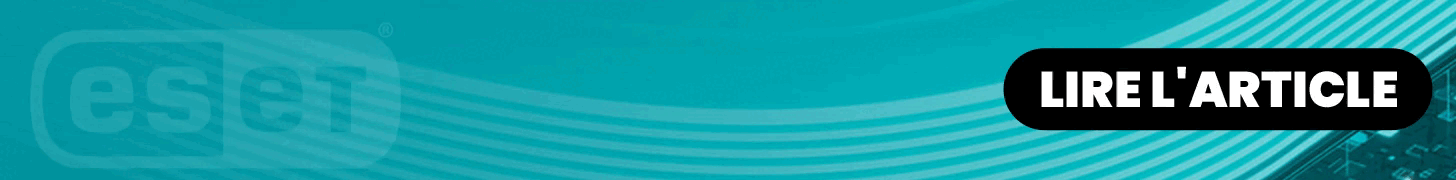Les exportations de Taïwan ont bondi de près de 50 % en octobre, leur plus forte progression depuis quinze ans, portées par la demande mondiale en puces pour intelligence artificielle. Le rebond spectaculaire de l’île confirme son rôle central dans la chaîne de valeur des semiconducteurs et la dépendance croissante de l’économie mondiale à l’IA.
Alors que les tensions commerciales et les reconfigurations industrielles redessinent la carte de la haute technologie, Taïwan s’affirme plus que jamais comme un pivot du système productif mondial. Derrière ce dynamisme se joue bien plus qu’un simple rebond conjoncturel : une mutation profonde de la production électronique, stimulée par l’intelligence artificielle générative et l’informatique de haute performance.
Selon le ministère taïwanais des Finances, les exportations du mois d’octobre ont progressé de 49,7 % sur un an, atteignant 61,8 milliards USD. Cette performance, la plus élevée depuis près de seize ans, marque la 24ᵉ hausse mensuelle consécutive et témoigne d’une traction sans précédent sur le segment des composants électroniques. Les livraisons de semiconducteurs, en hausse de 29,2 %, et celles de composants électroniques, en progression de 27,7 %, traduisent la vigueur de la demande mondiale pour les processeurs spécialisés dans l’IA et les accélérateurs de calcul.
Les États-Unis absorbent la part la plus importante de cette croissance, avec une hausse de 144 % des importations en provenance de Taïwan, contre seulement 3,2 % pour la Chine. Ce déséquilibre illustre l’ancrage du modèle taïwanais dans l’écosystème américain, au moment où la rivalité technologique entre Washington et Pékin continue d’alimenter la polarisation du marché mondial des puces.
Un effet de levier industriel sans précédent
Le moteur de cette expansion réside dans l’effet combiné de la généralisation des modèles d’IA générative et de la course mondiale aux centres de données. Les fabricants taïwanais tels que TSMC, ASE ou MediaTek voient leurs carnets de commandes gonfler sous l’effet des besoins massifs en calcul. Les serveurs GPU, les modules de mémoire HBM et les circuits d’interconnexion pour data centers deviennent les catalyseurs d’une nouvelle phase d’industrialisation numérique.
Les projections d’Allianz Research évaluent à plus de 1 000 milliards USD le marché mondial des semiconducteurs à l’horizon 2030, dopé par la diffusion de l’IA dans tous les secteurs. Ce basculement place Taïwan dans une position stratégique mais fragile : la performance économique dépend désormais étroitement d’un segment de haute spécialisation, sensible aux cycles technologiques et aux tensions géopolitiques.
Un déséquilibre structurel entre dépendance et résilience
La concentration extrême du modèle taïwanais sur l’industrie des puces crée une dépendance forte à l’évolution de la demande occidentale. Le différentiel de croissance entre les exportations vers les États-Unis et celles vers la Chine accentue cette asymétrie, renforçant la vulnérabilité de l’île à toute inflexion politique ou commerciale. Cette dépendance pose aussi la question de la sécurité d’approvisionnement mondiale, dans un contexte de pression accrue sur les chaînes logistiques et sur les matières critiques.
Les entreprises, les administrations et les fournisseurs de services européens doivent tirer les leçons de cette dynamique : la souveraineté industrielle passe par la diversification des sources de production, le renforcement des capacités locales et une approche systémique de la résilience des chaînes de valeur.
Les signaux d’alerte d’une dépendance technologique
Cette expansion rapide présente plusieurs zones de vulnérabilité. Une correction du marché de l’IA ou un ralentissement des investissements dans les centres de données pourrait inverser la tendance. Les goulets d’étranglement liés à la lithographie extrême ultraviolet, à la disponibilité des matériaux avancés et à la pénurie d’ingénieurs spécialisés menacent également la continuité de cette croissance.
Les restrictions à l’exportation imposées par les États-Unis sur les technologies de pointe destinées à la Chine constituent un autre risque structurel. Si elles s’intensifient, elles pourraient fragiliser une partie de l’écosystème taïwanais, pris entre deux sphères d’influence opposées. Le ministère des Finances de Taïwan anticipe malgré tout une progression des exportations de près de 30 % sur l’ensemble de 2025, tout en soulignant les incertitudes persistantes de l’économie mondiale.
Une mutation qui redessine la carte mondiale de la valeur
Au-delà des chiffres, cette flambée des exportations illustre la vitesse de recomposition de l’économie mondiale autour de l’IA. Taïwan devient la plaque tournante d’une nouvelle géographie de la valeur, où la performance industrielle repose sur la maîtrise du calcul intensif et sur la densité de l’écosystème technologique. Pour les acteurs européens, cette évolution réaffirme l’urgence d’une stratégie coordonnée sur les semiconducteurs et sur la production d’énergie numérique souveraine.
À court terme, le boom des puces d’IA représente une manne économique indéniable pour Taïwan. Mais à moyen terme, la pérennité de cette position dépendra de la capacité de l’île à sécuriser ses approvisionnements, à élargir sa base industrielle et à maintenir la confiance des grands donneurs d’ordre. Le cycle de l’IA pourrait alors devenir, non plus une vague spéculative, mais le socle d’une puissance technologique durable.