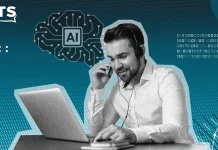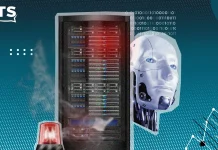En réponse au verrouillage croissant des plateformes numériques, les entreprises ne réagissent pas toutes de la même manière. Une étude récente du Boston Consulting Group (BCG) dresse une typologie en six profils organisationnels et identifie huit leviers concrets pour piloter les dépendances. Une grille de lecture précieuse à l’heure où l’autonomie numérique devient un enjeu stratégique.
La généralisation des plateformes numériques a profondément modifié les équilibres dans les systèmes d’information. Infrastructure cloud, outils collaboratifs, CRM, moteurs IA ou suites bureautiques : ces solutions forment aujourd’hui l’ossature des services numériques, mais elles embarquent aussi des mécanismes puissants de verrouillage technologique. Ce "lock-in", longtemps perçu comme une contrainte acceptable, devient désormais un facteur de risque critique. L’étude « Managing the Dynamics of Digital Platform Lock-In », publiée par BCG, apporte une structuration utile : six archétypes d’entreprises, selon leur posture vis-à-vis des plateformes, et huit leviers pour en reprendre le contrôle. Une grille utile pour les DSI, les architectes et les responsables de la gouvernance IT.
L’un des apports majeurs de l’étude repose sur une typologie à six profils d’organisation. Le « Follower » adopte les plateformes sans stratégie claire, souvent par mimétisme ou opportunisme fonctionnel. L’« Exploiter » maximise les outils disponibles, tout en essayant de contenir les effets de dépendance. Le « Prisoner », quant à lui, subit un verrouillage fort, souvent issu d’un historique technique ou d’un empilement contractuel. À l’opposé, le « Guardian » investit dans des garde-fous techniques ou juridiques pour préserver une capacité de retrait. L’« Experimenter » multiplie les tests, en isolant les outils pour éviter l’enfermement, tandis que l’« Orchestrator » pilote proactivement un portefeuille de plateformes avec une vision long terme et une gouvernance robuste.
Huit leviers pour piloter la dépendance technologique
Cette segmentation ne se veut pas normative, mais fonctionnelle. Elle permet aux directions informatiques de positionner leur organisation, d’objectiver leur degré de dépendance et de repérer les marges d’action disponibles. Surtout, elle révèle que la dépendance n’est pas qu’un facteur technique. Elle résulte aussi de choix culturels, de contraintes métiers, de négociations contractuelles, ou d’arbitrages budgétaires. Deux entreprises de taille comparable peuvent se retrouver dans des profils très différents selon leur historique de déploiement, leur maturité cloud ou leur rapport à la souveraineté numérique. Cette cartographie dynamique ouvre la voie à une gestion différenciée du risque lock-in.
BCG identifie huit leviers actionnables pour réduire ou contenir les effets de verrouillage. Certains sont technico-fonctionnels : adoption d’interfaces normalisées, abstraction des données, modularisation des architectures, intégration de clauses de réversibilité dès la contractualisation. D’autres relèvent davantage de la gouvernance : mise en place de feuilles de route multi-fournisseurs, documentation des choix d’intégration, formalisation de critères d’évaluation des plateformes en amont des projets. À cela s’ajoutent des leviers humains : formation à la lecture critique des contrats, sensibilisation à la portabilité applicative, développement de l’expertise interne sur les standards ouverts.
Ces leviers ne se substituent pas les uns aux autres. Ils composent un socle d’action modulable en fonction des ressources disponibles, du profil de l’entreprise et du secteur d’activité. L’un des enseignements de l’étude est qu’il n’existe pas de solution universelle. Dans certains cas, le verrouillage peut être accepté s’il apporte un gain net de performance ou de rapidité d’exécution. Mais ce choix doit être éclairé, documenté et réversible à moyen terme. L’objectif n’est pas de fuir toute plateforme, mais d’éviter de se retrouver pieds et poings liés sans filet technique ou contractuel. Le pilotage des dépendances devient un pilier à part entière de la stratégie numérique.
Des sensibilités sectorielles marquées vis-à-vis du lock-in
L’intensité de la dépendance aux plateformes varie fortement selon les secteurs. Dans les industries régulées – banque, assurance, énergie, défense – la vigilance est plus élevée. Ces organisations sont souvent dotées de structures de contrôle interne, de processus d’audit et de pratiques contractuelles plus rigoureuses. À l’inverse, dans les secteurs à fort taux d’innovation ou de rotation technologique – retail, agences de communication, services numériques – la rapidité de déploiement prime souvent sur la maîtrise des dépendances. Le choix des outils se fait alors davantage sous l’angle fonctionnel ou commercial, au risque d’installer des contraintes durables sur les flux de données, les processus ou les droits d’usage.
À l’échelle géographique, l’étude relève que les entreprises européennes apparaissent plus critiques vis-à-vis des grandes plateformes. La prise de conscience sur les enjeux de souveraineté, la pression réglementaire (RGPD, Data Act, NIS2) et l’émergence de labels (SecNumCloud, cloud de confiance) ont contribué à renforcer les exigences de réversibilité et de portabilité. Aux États-Unis, la logique d’optimisation court terme reste dominante, tandis qu’en Asie, plusieurs acteurs publics et privés cherchent à bâtir des écosystèmes alternatifs ou autonomes. La gouvernance du lock-in devient ainsi un révélateur géopolitique autant qu’un sujet d’architecture technique.
Vers une gouvernance active et mutualisée des dépendances
La majorité des entreprises interrogées par BCG reconnaissent ne pas avoir encore mis en place un cadre structuré pour piloter leurs dépendances aux plateformes. Ce constat interroge : alors même que les plateformes deviennent centrales pour les fonctions critiques – RH, finances, relation client, production, cybersécurité – peu de DSI disposent d’indicateurs consolidés pour évaluer leur marge de manœuvre. L’absence de vision transversale crée un angle mort dans la gouvernance des systèmes d’information. L’étude appelle à la création d’un pilotage transverse, incluant la direction des achats, la conformité, les responsables métiers et les équipes d’architecture.
Ce pilotage doit également intégrer une logique de mutualisation. Les entreprises, les administrations et les fournisseurs de services partagent souvent les mêmes contraintes contractuelles, techniques ou réglementaires. Des référentiels communs, des grilles de lecture partagées ou des observatoires sectoriels peuvent contribuer à réduire l’asymétrie entre clients et fournisseurs de plateformes. Plusieurs initiatives vont dans ce sens, qu’il s’agisse de l’émergence de "cloud councils", de démarches de contractualisation groupée, ou d’expérimentations dans des alliances sectorielles. L’intelligence collective devient une condition d’efficacité dans la gestion du lock-in.
Reprendre la main sans renoncer à l’innovation
Au-delà de l’analyse typologique et des leviers d’action, l’étude de BCG propose une méthode : croiser le profil de son organisation avec les leviers activables, en tenant compte du contexte marché. Cette approche ouvre la voie à une évaluation continue des plateformes numériques, dans une logique d’alignement stratégique. L’objectif n’est pas de ralentir l’innovation, mais de l’inscrire dans une trajectoire pilotée. Le verrouillage n’est pas un piège inévitable, mais une situation évolutive qui peut être anticipée, documentée et – dans une certaine mesure – neutralisée.
Les prochaines étapes sont connues. D’abord, poser un diagnostic documenté sur les dépendances existantes. Ensuite, engager une démarche structurée de réduction des risques, en arbitrant entre efficacité, coût, sécurité et souveraineté. Enfin, bâtir une culture organisationnelle où la dépendance n’est plus un sujet tabou mais un paramètre stratégique. Dans un monde dominé par quelques grands fournisseurs globaux, cette lucidité constitue un préalable à toute autonomie numérique durable.