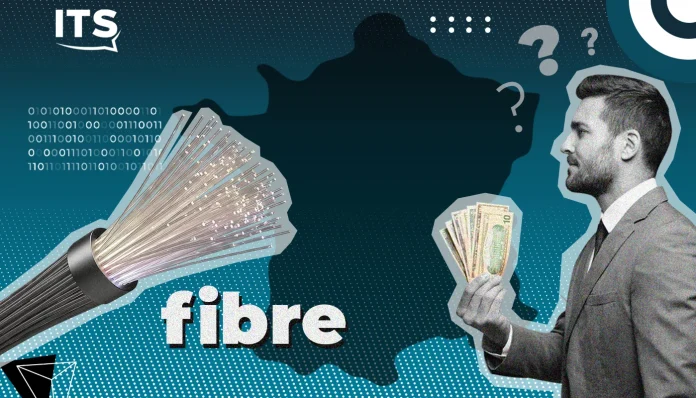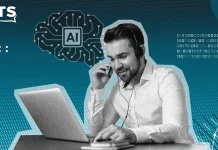Issu d’un compromis inédit entre régulation, politique publique et stratégie industrielle, le modèle français de régulation symétrique des réseaux FttH repose sur l’accès passif ouvert à tous les opérateurs, le coinvestissement encadré et la mutualisation obligatoire des infrastructures. L’étude commandée par l’Arcep à Plum Consulting en dresse un bilan circonstancié, saluant ses effets d’homogénéisation territoriale, tout en interrogeant sa soutenabilité dans un marché désormais stabilisé, mais plus hétérogène dans ses usages.
Ce que l’on désigne comme le « modèle français » de régulation des réseaux FttH fait référence à un dispositif mis en place dès 2009, fondé sur une obligation symétrique d’accès aux lignes passives pour tous les opérateurs d’infrastructure, quel que soit leur taille ou leur poids économique. La régulation symétrique se distingue de la régulation asymétrique en ce qu’elle impose les mêmes règles d’ouverture du réseau à tous les opérateurs, sans tenir compte de leur position dominante ou non. En pratique, cela signifie que tout acteur déployant un réseau FttH mutualisable, doit permettre à d’autres opérateurs d’y accéder, soit en le cofinançant en amont (coinvestissement ab initio), soit en louant des lignes à des conditions encadrées.
Contrairement aux régimes classiques, ce modèle privilégie une neutralité réglementaire, garantissant une concurrence équitable dans l’ensemble des zones, y compris les moins denses. À cela s’ajoutent deux piliers structurants : d’une part, le coinvestissement initial encouragé dès la phase de déploiement, garantissant la viabilité économique des projets ; d’autre part, une politique publique (Plan France THD) orientée vers la couverture intégrale du territoire, avec des mécanismes différenciés selon les zones. Ce triptyque — accès passif, coinvestissement, mutualisation — a permis de déployer plus de 40 millions de lignes raccordables en quinze ans, tout en évitant la duplication des réseaux et en maintenant une homogénéité tarifaire inédite à l’échelle européenne.
Un cadre précurseur au service de la couverture et de la concurrence
Cette approche a permis de sécuriser des financements à long terme et d’assurer la présence de plusieurs opérateurs commerciaux sur l’ensemble des territoires. Ce mécanisme s’est imposé comme une alternative crédible à la régulation asymétrique centrée sur l’opérateur dominant, qui prévaut dans la majorité des États membres de l’Union. L’étude souligne le caractère atypique, mais performant de cette architecture sectorielle, conçue pour éviter la duplication inefficace des réseaux et renforcer la concurrence sur les services, plutôt que sur les infrastructures.
La segmentation géographique entre zones très denses, zones d’initiative privée (AMII et AMEL) et réseaux d’initiative publique (RIP) a permis d’adapter les obligations et les modèles économiques aux réalités locales. En zone très dense, plusieurs opérateurs peuvent déployer leur propre réseau. Ailleurs, un seul opérateur construit l’infrastructure, les autres pouvant accéder aux lignes via coinvestissement ou location. Cette flexibilité réglementaire, renforcée par la possibilité de créer des entités de financement dédiées, a contribué à la dynamique de couverture.
Une performance remarquable sur les plans technique et tarifaire
Conséquence de cette politique : à la fin de 2024, plus de 95 % des locaux étaient raccordables en FttH, et plus de 80 % disposaient d’une offre provenant d’au moins trois opérateurs commerciaux. Cette situation place la France parmi les pays les plus avancés d’Europe en matière de connectivité fixe. L’étude met en évidence un alignement quasi parfait avec les objectifs européens définis dans le code des communications électroniques : promotion de la connectivité, de la concurrence et des investissements. Contrairement à d’autres marchés, la France a réussi à maintenir un haut niveau de couverture tout en garantissant des prix de détail stables et compétitifs, y compris dans les zones rurales.
Les offres commerciales proposées sur les RIP (Réseaux d’initiative publique déployés par les collectivités territoriales) affichent les mêmes caractéristiques techniques et tarifaires que dans les métropoles, contribuant à une véritable inclusion numérique. Cette homogénéité est rendue possible par les lignes directrices tarifaires de l’Arcep, qui imposent des fourchettes cohérentes et non discriminatoires dans l’accès aux réseaux passifs. De nombreux opérateurs exploitent également des offres de gros activées (bitstream) pour toucher plus rapidement certains segments de clientèle, en particulier dans les zones à faible densité.
Des tensions économiques et opérationnelles en zone moins dense
Si le modèle français apparaît comme un succès réglementaire, il repose sur un équilibre de plus en plus difficile à maintenir dans certaines zones. L’étude pointe la rentabilité incertaine des réseaux dans les zones AMEL (un dispositif créé en 2017 pour accélérer le déploiement de la fibre optique dans les zones peu denses) et RIP, où les coûts de raccordement restent élevés, alors que les perspectives de revenus sont plus faibles. Les opérateurs d’infrastructure, soumis à une obligation de complétude, doivent desservir l’ensemble des locaux, même les plus isolés ou coûteux, dans un délai raisonnable. Ce principe, conçu pour éviter les effets de préemption ou d’écrémage, alourdit les charges d’exploitation et limite la capacité à dégager des marges.
Par ailleurs, les conditions d’accès au génie civil, encore largement détenu par le groupe Orange, sont encadrées par une régulation asymétrique orientée vers les coûts. L’évolution progressive de la répartition des charges entre réseaux cuivre et fibre renchérit le coût d’accès aux fourreaux et poteaux. Dans un contexte de transition vers la fibre, cette hausse planifiée fragilise certains modèles d’affaires, en particulier pour les nouveaux entrants ou les acteurs intermédiaires. L’étude souligne également que la location de lignes, plus coûteuse sur le long terme que le coinvestissement, reste pourtant majoritaire chez certains opérateurs pour des raisons de flexibilité ou de gestion d’actifs.
Un modèle à part en Europe, mais de plus en plus exposé
La France fait figure d’exception en Europe, avec un modèle de régulation symétrique peu répandu ailleurs. La plupart des autres États membres s’appuient sur une régulation asymétrique ciblant l’opérateur historique, avec des obligations d’accès sur des réseaux souvent activés. Dans ce paysage, le cadre français, fondé sur la mutualisation passive, favorise l’innovation et la différenciation par les équipements et services. Il a également permis à plusieurs opérateurs alternatifs (Altitude, Axione, Lumière…) de devenir des acteurs majeurs, en remportant des appels d’offres sur les RIP ou en structurant des véhicules d’investissement ad hoc.
,Mais cette singularité pourrait devenir une vulnérabilité. L’étude met en garde contre le risque d’inertie face aux évolutions technologiques et aux besoins émergents, notamment dans les services aux entreprises. L’absence de mécanismes d’adaptation rapide ou de régulation fine des niveaux de qualité de service peut limiter la réactivité du marché. Les débats en cours sur la prochaine génération de services FttH (flexibilité, SDN, réseaux segmentés) montrent que le modèle français devra évoluer pour rester compétitif. La question de la pertinence d’un maintien strict des obligations symétriques est donc posée.
Entre révision ciblée et préservation des acquis
L’étude Plum Consulting propose plusieurs scénarios d’évolution du cadre, allant du maintien strict à l’abandon progressif des obligations symétriques. Chacune de ces hypothèses soulève des questions de gouvernance, d’équité entre zones, et de continuité du service. Le scénario intermédiaire, consistant à conserver les principes de la régulation symétrique tout en les modulant selon les usages, les segments de marché ou les technologies, semble le plus probable. Il permettrait de préserver les acquis en matière d’inclusion et de concurrence, tout en favorisant une montée en gamme des services dans les zones les plus dynamiques.
Cette transition supposerait une concertation renforcée avec les collectivités, les opérateurs et les investisseurs, notamment sur les mécanismes de rémunération à long terme, les incitations à l’investissement actif, et les conditions d’accès à des services différenciés. Le cadre actuel a montré son efficacité pour le déploiement, mais doit désormais intégrer des logiques d’usage, de performance et de pilotage. Les groupes de travail techniques (Interop’Fibre, GT fluidification, Comité d’experts) constituent des leviers utiles pour cette adaptation.
Ce bilan met en lumière un succès français rarement reconnu à sa juste valeur dans le débat européen sur la connectivité. Pourtant, le maintien de ce modèle dépend désormais de sa capacité à évoluer. L’urgence n’est pas à la refonte, mais à l’ajustement. Les prochaines décisions de l’Arcep devront préserver les fondations d’un cadre qui a fonctionné, tout en l’ouvrant à des perspectives nouvelles, plus centrées sur les services, les entreprises et la résilience territoriale. L’équation reste délicate : continuer à réguler pour mieux libérer les dynamiques de marché.