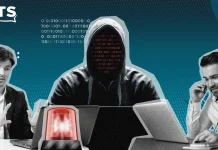La Threat Intelligence connaît une diffusion rapide dans les entreprises françaises. Une large majorité déclare en maîtriser les principes, mais un tiers reconnaît encore une compréhension incomplète qui limite l’usage réel. Le manque de compétences disponibles pèse sur la capacité à déployer des dispositifs matures malgré un intérêt certain pour ces technologies.
Les organisations cherchent à reprendre la main sur la lecture des menaces qui se multiplient sur leurs réseaux et dans leurs environnements cloud. Cette bascule historique en cybersécurité repose sur une idée simple préparer au lieu de subir exige d’observer les comportements adverses et de transformer cette connaissance en décisions opérationnelles. L’étude menée par Toluna pour Kaspersky éclaire cette dynamique en révélant un marché français très informé mais encore traversé par des écarts marqués de maturité.
La Threat Intelligence est désormais installée dans le vocabulaire courant de la sécurité numérique. Selon l’étude quatre répondants sur cinq affirment connaître la discipline et cette diffusion traduit l’empreinte grandissante des approches de veille et d’analyse comportementale. Pourtant un tiers des entreprises n’en possède qu’une vision partielle ce qui crée un décalage entre l’intérêt affiché et l’usage effectif. Cet écart s’explique par une compréhension encore limitée de ce que recouvre réellement la Threat Intelligence qu’il s’agisse de la collecte d’indicateurs d’attaque de l’interprétation des tactiques adverses ou de l’intégration dans les outils de détection.
Une diffusion accélérée qui marque un tournant technologique
Cette méconnaissance partielle produit un effet mécanique les entreprises réellement acculturées à la Threat Intelligence s’engagent davantage dans des projets structurants et atteignent des niveaux d’efficacité supérieurs notamment en matière d’analyse de pare feu et de surveillance avancée. L’étude montre que les répondants disposant d’une compréhension approfondie sont nettement plus enclins à investir ou prolonger leurs usages ce qui confirme que la pédagogie demeure le principal facteur de progrès. Les fournisseurs disposent ici d’un rôle explicite en matière de formation de documentation technique et de démonstration de valeur opérationnelle afin de combler cet espace cognitif encore large.
Plus d’une entreprise sur deux déclare utiliser la Threat Intelligence dans ses opérations quotidiennes et plus d’un tiers prévoit de l’adopter dans les douze prochains mois. Ces intentions révèlent une dynamique structurelle la discipline n’appartient plus au domaine expérimental elle intègre désormais les outils courants de détection et d’analyse. La corrélation avec la pression des attaques est claire en 2025 plus de la moitié des entreprises françaises ont été victimes d’un incident dont une part significative de manière répétée ce qui renforce la quête d’indicateurs précoces et de corrélations rapides.
L’ensemble dessine un marché en phase de structuration avancée. Moins de cinq pour cent des entreprises envisagent d’abandonner l’usage de la TI ce qui confirme un niveau élevé de satisfaction et un rôle de plus en plus central dans les dispositifs de défense. Selon les interlocuteurs cités dans l’étude la question n’est plus de savoir si la TI doit être adoptée mais plutôt comment la déployer de manière cohérente dans des environnements hybrides où les mécanismes d’attaque évoluent à grande vitesse.
Des ressources humaines limitées qui freinent la consolidation
L’étude pointe un frein devenu majeur dans toutes les démarches de cybersécurité le déficit de compétences spécialisées. Plus d’une entreprise sur deux estime ne pas disposer de ressources internes capables d’exploiter pleinement les flux de Threat Intelligence ou d’entretenir un dispositif de surveillance en continu. Cette tension sur les compétences encourage une externalisation croissante des services de sécurité avec un risque direct pour la réactivité et pour la qualité des analyses en particulier dans les petites et moyennes structures.
Les contraintes budgétaires combinées à cette pénurie créent un second verrou. Quatre entreprises sur dix estiment ne pas pouvoir financer des investissements réguliers en TI ce qui entraîne une approche souvent réactive et concentrée sur l’après attaque. Dans ces conditions la fragmentation technologique reste difficile à contenir. Les architectures modernes mêlant cloud objets connectés et accès distants accroissent l’exposition aux risques et génèrent une multiplication des protocoles à surveiller ce qui renforce la nécessité d’une vision centralisée et contextualisée des menaces.
Une pression opérationnelle renforcée par l’intensité des attaques
La progression des attaques observée en 2025 agit comme un catalyseur. Les attaques répétées touchent un quart des entreprises ce qui met en lumière une difficulté persistante à détecter les signaux faibles ou à corréler les indicateurs. Selon les intervenants de Kaspersky la maturité en détection devient un enjeu clé pour réduire la fréquence des incidents et éviter les chaînes d’exploitation silencieuses qui traversent les environnements collaboratifs et les réseaux hybrides.
Cette réalité explique la volonté d’investir exprimée par la grande majorité des organisations bien que conditionnée par les moyens internes disponibles. Les décideurs interrogés identifient clairement la Threat Intelligence comme un outil de priorisation permettant de distinguer les menaces accidentelles des opérations ciblées de suivre les évolutions tactiques des groupes criminels et de renforcer l’efficacité des mécanismes de filtrage. Cette progression reste toutefois tributaire d’une montée en compétence continue et d’un dialogue plus structuré entre éditeurs intégrateurs et responsables de la sécurité.
Une discipline appelée à devenir un socle transversal
L’ensemble des enseignements révèle un marché en transition vers une cybersécurité plus informée et plus contextualisée. La Threat Intelligence tend à devenir un standard méthodologique pour les équipes en charge des opérations de sécurité mais sa valeur dépend encore largement de la capacité des organisations à l’intégrer dans leurs workflows à corréler les données entre elles et à en faire un outil d’aide à la décision. Cette évolution ouvre la voie à de nouvelles pratiques notamment l’automatisation raisonnée de la détection l’intégration dans les environnements cloud et la construction de référentiels enrichis de comportements adverses. Les bénéfices attendus sont multiples réduction des temps de réaction meilleure priorisation des alertes et consolidation de la résilience organisationnelle.
Méthodologie
Enquête menée en ligne par Toluna pour Kaspersky du neuf au quatorze octobre deux mille vingt cinq auprès de trois cent douze décideurs informatiques travaillant dans des entreprises de plus de cinquante salariés en France. L’étude observe les niveaux de connaissance les usages déclarés les freins opérationnels et les intentions d’investissement associés à la Threat Intelligence.