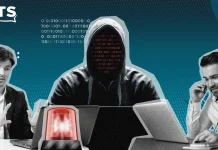L’Île-de-France confirme son statut de première région française pour l’emploi dans les startup, avec près de 82 000 salariés en 2022, soit 17 % de l’emploi des jeunes entreprises de moins de huit ans. Ce dynamisme s’est accompagné d’une montée en qualification des profils, d’une concentration géographique marquée, et d’une structuration sectorielle centrée sur les métiers du numérique et de l’innovation.
Le rôle des startup dans la transformation de l’économie francilienne ne se limite pas à la création d’emplois. Il s’exprime aussi par la qualité des profils recrutés, la diffusion de l’innovation et la capacité à structurer des filières. La dynamique observée ces cinq dernières années révèle une croissance robuste, une montée en gamme des qualifications et une attractivité renforcée pour les cadres et les jeunes diplômés. Cette évolution marque un basculement du paradigme traditionnel, centré sur la petite entreprise commerçante, vers un modèle d’entreprise innovante, connectée et ancrée dans des réseaux d’accompagnement et de financement sophistiqués.
Entre 2017 et 2022, l’Île-de-France a connu une progression significative du nombre de startup (+27 %) et de l’emploi salarié associé (+60 %), passant de 51 000 à près de 82 000 emplois. Ce dynamisme s’est révélé résilient, malgré le ralentissement temporaire causé par la crise sanitaire en 2020. La reprise post-pandémie a accéléré le mouvement, confortant la région dans son rôle de locomotive nationale. Près de 8 800 startup étaient implantées en Île-de-France en 2022, représentant une part notable des salariés des entreprises de moins de huit ans. Paris concentre plus de la moitié de ces emplois, tandis que les Hauts-de-Seine renforcent leur attractivité auprès des jeunes pousses. Cette concentration géographique s’explique par la densité de l’écosystème d’innovation, la proximité des grands établissements d’enseignement supérieur et la présence de fonds d’investissement spécialisés.
Des profils plus qualifiés et plus jeunes, des rémunérations en hausse
La croissance du secteur s’est accompagnée d’une augmentation de la taille moyenne des entreprises, qui emploient désormais 9,3 salariés en équivalent temps plein contre 7,3 cinq ans plus tôt. Les gazelles, ces entreprises à forte croissance, ont doublé leurs effectifs sur la période, tandis que la proportion de cadres et de professions intellectuelles supérieures a progressé de façon spectaculaire, passant de 39 % à 51 % des effectifs. À l’inverse, la part des employés et des ouvriers a reculé, illustrant le positionnement des startup comme vecteurs de montée en qualification et d’attraction de talents à forte valeur ajoutée.
L’étude met en évidence la spécificité du tissu startup francilien par rapport au reste des jeunes entreprises régionales. Si elles ne représentent que 2,4 % du nombre total d’entreprises de moins de huit ans, elles concentrent 17 % de l’emploi salarié. Ce différentiel tient à une structure d’emplois fortement polarisée autour des cadres et des ingénieurs, qui composent plus de la moitié des effectifs. Le salaire net annuel médian dans les startup atteint 32 700 euros, soit 60 % de plus que dans les autres jeunes entreprises. Ce différentiel est avant tout lié à la composition des effectifs, les cadres étant surreprésentés. À catégorie socioprofessionnelle identique, les écarts de rémunération sont moins marqués, hormis pour les dirigeants et fondateurs, souvent mieux rémunérés dans les startup que dans les structures traditionnelles. La moyenne d’âge des salariés est inférieure à celle du reste du tissu productif, avec une féminisation légèrement plus marquée (36 % contre 33 %).
Les activités scientifiques et techniques en tête
Deux secteurs dominent l’emploi dans les startup, l’information et la communication (38 %) et les activités spécialisées, scientifiques et techniques (19 %). Cette spécialisation traduit l’ancrage des startup franciliennes dans le numérique, la technologie et l’innovation de service, au détriment des secteurs traditionnels comme le commerce ou l’hébergement-restauration, qui restent majoritaires chez les jeunes entreprises classiques. L’ouverture vers les profils de stagiaires et d’apprentis se confirme, avec un recours accru à ces dispositifs dans les entreprises innovantes, ce qui participe à la constitution d’un vivier de compétences qualifiées pour la filière régionale.
Des dynamiques différenciées selon les profils de startup
L’étude distingue trois profils de startup : les entreprises innovantes (73 % du total), les gazelles à forte croissance et celles ayant réalisé d’importantes levées de fonds. Les startup innovantes emploient 67 % de cadres et professions intellectuelles supérieures, avec une part d’ingénieurs atteignant 44 %. Les gazelles affichent une taille moyenne plus élevée (43,5 salariés), un recours plus fréquent aux contrats à durée indéterminée (85 %) et une structure d’emploi davantage tournée vers la production. Les startup ayant levé des fonds, quant à elles, représentent un quart du tissu mais concentrent 17 % des emplois, avec des caractéristiques plus hétérogènes liées à la prévalence de holdings et de sociétés de gestion de fonds. Malgré leur diversité, l’ensemble de ces profils participe à la montée en gamme du tissu productif francilien, en tirant vers le haut les exigences de qualification et d’innovation.
La dynamique d’emploi bénéficie d’un effet d’entraînement. Les cohortes d’entreprises créées en 2017, observées sur cinq ans, montrent une multiplication par trois du nombre moyen de salariés, qui passe de 3 à 9,3 sur la période. Cette accélération concerne d’abord les cadres et professions intellectuelles supérieures, dont la part progresse fortement au détriment des emplois d’exécution. Le renouvellement rapide du tissu entrepreneurial contribue ainsi à la montée en compétence globale et à la modernisation du marché du travail régional.
Des défis en matière de financement et de visibilité
Les entretiens menés par la CCI Paris Île-de-France avec des dirigeants de startup confirment l’importance des dispositifs d’accompagnement et des concours d’innovation dans l’accès aux financements. Les entrepreneurs interrogés mettent en avant l’effet de levier procuré par une première subvention ou une sélection à un concours, qui facilite l’entrée dans de nouveaux cercles et l’accès à des opportunités supplémentaires. Cependant, la lisibilité des dispositifs reste perfectible, de nombreux créateurs déplorant la complexité et la multiplicité des aides existantes.
Les différences de maturité financière entre les projets software et hardware sont également soulignées, les seconds nécessitant des fonds plus importants en phase de démarrage, et affichant une rentabilité attendue plus lointaine. L’environnement juridique et l’accès aux expertises externes constituent des facteurs différenciants pour sécuriser le développement des startup, qui, dans leur grande majorité, privilégient un ancrage régional fort, même en phase de croissance accélérée.
La dimension collective et territoriale ressort nettement , car la plupart des entrepreneurs considèrent la connexion à l’écosystème régional comme un atout stratégique. L’ancrage francilien facilite l’accès aux réseaux, aux compétences et aux opportunités de marché, favorisant la rétention des talents et la création de valeur sur ce territoire.
Structuration du tissu productif et réalignement des compétences
Le bilan dressé par l’étude CROCIS témoigne de la capacité des startup à transformer durablement le tissu économique francilien. Leur contribution à la création d’emplois qualifiés, à la diffusion de l’innovation et à la modernisation des filières stratégiques s’avère déterminante. Les indicateurs de croissance, de qualification et de rémunération signalent une élévation du niveau de compétence et une attractivité renforcée de la région pour les talents, les investisseurs et les porteurs de projet. L’Île-de-France, forte de son écosystème, de ses réseaux d’accompagnement et de sa capacité d’absorption des innovations, s’impose comme un laboratoire de la transformation productive, au service d’une économie régionale plus dynamique, plus compétitive et plus résiliente. Les enjeux à venir porteront sur la consolidation de cet élan, la montée en puissance des dispositifs de soutien, et la capacité à attirer et à retenir les compétences clés sur le territoire.
Les bénéfices mesurables pour les entreprises, les administrations et les fournisseurs de services résident dans la constitution d’un vivier de talents qualifiés, l’élévation des standards de gestion et d’innovation, et l’ancrage de compétences critiques pour la compétitivité régionale. À moyen terme, la consolidation du tissu startup contribuera à structurer durablement l’économie francilienne autour de l’innovation, du numérique et de la valeur ajoutée.