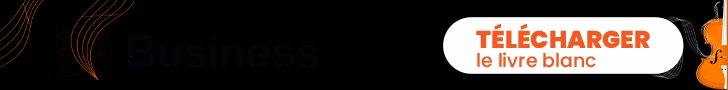Le rapport Kyndryl Readiness Report 2025 met en lumière une zone de turbulence rarement documentée : les investissements en intelligence artificielle progressent de 33 % en un an, mais seule une minorité d’organisations estime disposer d’infrastructures capables d’absorber les chocs géopolitiques, réglementaires et opérationnels. La pression pour démontrer un retour sur investissement renforce ce sentiment d’urgence et accélère les décisions d’architecture, souvent prises dans des conditions de visibilité imparfaite.
La fragmentation géopolitique, l’adoption rapide des modèles d’IA et la complexification des systèmes hérités redéfinissent la manière dont les entreprises, les administrations et les fournisseurs de services conçoivent leur trajectoire technologique. Le rapport de Kyndryl, fondé sur les réponses de 3 700 dirigeants de 21 pays et sur les données opérationnelles de la plateforme Kyndryl Bridge, montre que les écarts de préparation ne relèvent plus seulement de la maturité technique, ils traduisent une difficulté structurelle à aligner stratégie, compétences, infrastructures et gouvernance dans un monde où les risques se matérialisent plus vite que les plans de transformation.
Les dirigeants interrogés décrivent un paradoxe déjà observé en 2024 : 90 % considèrent leurs infrastructures « de classe mondiale », mais seuls 31 % les jugent réellement prêtes à encaisser les risques émergents. Cette dissonance se retrouve dans l’état des environnements techniques analysés par Kyndryl Bridge : 25 % des serveurs, des réseaux et des systèmes de stockage sont proches de l’arrêt de support, tandis que les certificats SSL expirés et les retards de correctifs constituent des freins directs à l’intégration de nouvelles briques logicielles.
Cloud, souveraineté et reconfiguration des chaînes de données
Le rapport relève que les organisations subissent un large éventail d’incidents. Environ 30 % ont connu des interruptions liées à des erreurs humaines, 28 % à des pannes logicielles ou matérielles, et 25 % à des défaillances de centres de données. La cybercriminalité reste un facteur majeur, mais elle ne constitue plus l’unique source d’instabilité. Cette pluralité des causes fragilise les projets d’industrialisation de l'IA : parmi les organisations qui ne parviennent pas à dégager un retour positif sur leurs investissements, 35 % pointent l’intégration comme première barrière.
L’un des enseignements structurants du rapport tient à l’impact des tensions géopolitiques sur les stratégies cloud. 65 % des répondants déclarent avoir modifié leur approche en raison d’incertitudes réglementaires, de contraintes de souveraineté ou de dépendances critiques vis-à-vis de fournisseurs non alignés. L’augmentation des risques influe sur des décisions autrefois techniques : la localisation des données, la réversibilité, l’usage du chiffrement avancé ou la répartition des charges entre plusieurs pays deviennent des paramètres stratégiques. Le rapport souligne que 86 % des organisations évaluent désormais l’alignement réglementaire et l’origine géographique des fournisseurs comme facteurs décisifs dans leurs choix cloud.
La situation varie largement d’un pays à l’autre. Les États-Unis et la Chine apparaissent comme les moins préoccupés par ces enjeux, alors que la France, l’Allemagne, la Suède ou les Pays-Bas manifestent une vigilance accrue. Cette dissymétrie traduit une différence de perception du risque géopolitique, mais aussi une dépendance plus forte à des infrastructures globalisées. En parallèle, les directions générales reconnaissent que leurs stratégies cloud résultent souvent d’une accumulation historique plutôt que d’un design maîtrisé : 70 % des PDG admettent être « arrivés là par accident ». Ce constat explique en partie pourquoi 95 % reconsidéreraient leur migration cloud s’ils pouvaient la refaire, en mettant davantage l’accent sur la sécurité, la compatibilité et la coordination entre équipes.
Une main-d’œuvre qui peine à suivre le rythme de l’innovation
La traction opérationnelle de l’IA dépend directement des compétences disponibles. Or le rapport met en évidence une fracture persistante : seuls 29 % des dirigeants estiment leur personnel prêt à exploiter l’IA de manière autonome. Les usages hebdomadaires restent inégaux : 61 % des employés techniques utilisent l’IA chaque semaine, contre 43 % des employés non techniques. Cette asymétrie freine la diffusion des pratiques productives et renforce la pression sur les équipes spécialisés, déjà sollicitées pour l’intégration, la gouvernance et la sécurité.
Les dirigeants identifient trois risques majeurs : l’insuffisance de compétences technologiques (41 %), l’absence de compétences cognitives ou transversales (39 %), et les tensions liées à la réallocation des postes remplacés ou transformés par l’IA (38 %). La confiance dans l’IA devient un levier essentiel : 44 % des organisations associent les employés à la mise en œuvre, 40 % renforcent la transparence des finalités et 44 % adoptent des lignes directrices éthiques. Mais les cultures organisationnelles peinent à suivre : 48 % des PDG estiment que leur culture interne freine l’innovation et 45 % jugent que les décisions se prennent trop lentement.
Le passage à l’échelle reste le point d’étranglement stratégique
Malgré l’accélération des investissements — en hausse moyenne de 33 % — l’IA reste largement cantonnée à des phases expérimentales. Trois organisations sur cinq déclarent que leurs projets stagnent au stade de preuve de concept, et 72 % admettent disposer de plus de pilotes qu’elles ne peuvent réellement industrialiser. L’obstacle principal n’est ni financier ni technologique, il résulte de la complexité croissante des environnements et de la difficulté à aligner les équipes métiers et les responsables techniques. Le rapport met en évidence que les entreprises les plus avancées, les « pacesetters », se distinguent par leur capacité à absorber cette complexité. Elles modernisent plus vite, automatisent davantage, s’appuient sur une observabilité fine de leur patrimoine technique, et obtiennent plus fréquemment un retour positif sur les investissements IA.
Pour les organisations moins préparées, les freins sont d’une autre nature. Entre surcharge réglementaire, pénurie de compétences en intégration, absence de vision unifiée entre PDG, DSI et DAF, 65 % des PDG reconnaissent un défaut d’alignement entre direction générale et direction financière sur la valeur à long terme des technologies. Cette tension fragilise les stratégies de transformation, car 74 % des dirigeants estiment que la pression liée au retour sur investissement à court terme nuit aux initiatives d’innovation pérenne.
Vers une gouvernance unifiée des infrastructures, des données et des compétences
Le rapport conclut sur un constat structurant. Les organisations qui parviennent à franchir le point de bascule combinent trois attributs essentiels : une infrastructure modernisée et observable, une main-d’œuvre adaptable et formée, et un leadership capable de définir un cap lisible reliant innovation, réduction des risques et valeur opérationnelle. Ces « pacesetters », qui représentent environ 13 % de l’échantillon, affichent une meilleure résilience, une utilisation plus étendue de l’IA parmi les employés techniques, et une capacité supérieure à faire converger les investissements cloud, data et IA dans une logique de performance durable.
Pour les entreprises, les administrations et les fournisseurs de services, cette dynamique ouvre une trajectoire claire : réduire la dette technique visible dans les environnements hétérogènes, consolider l’observabilité afin de détecter les incompatibilités avant qu’elles ne bloquent l’innovation, structurer des parcours de formation centrés sur les usages réels, et renforcer la gouvernance commune entre dirigeants métiers, financiers et techniques. Les bénéfices sont mesurables : amélioration de l’efficacité, réduction des incidents, capacité à absorber de nouveaux modèles d’IA sans reconfigurations lourdes, et meilleure adaptation aux contraintes réglementaires changeantes.