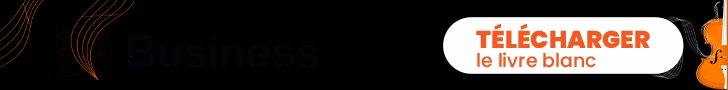Selon McKinsey, L’organisation agentique, qui associe humains et agents IA dans des chaînes de valeur intégrées, est la prochaine étape de l’ère numérique. Mais les premiers retours de terrain montrent un écart frappant entre la promesse et la réalité. Là où l’intégration technique classique (ERP, cloud, SaaS) relevait d’un déploiement planifié, l’intégration de l’IA exige une transformation organisationnelle profonde : gouvernance, culture et métiers.
Un article de McKinsey « The Agentic Organization: Contours of the Next Paradigm for the AI Era » explore la manière dont les entreprises peuvent transformer leur fonctionnement en intégrant des agents IA aux côtés des humains. Les auteurs décrivent un changement de paradigme organisationnel comparable aux révolutions industrielle et numérique, reposant sur cinq piliers : modèle d’affaires, modèle opérationnel, gouvernance, main-d’œuvre et culture, technologie et données. À travers des cas pratiques issus de la banque, de l’assurance, des télécoms et du secteur public, les auteurs illustrent les opportunités et les difficultés de cette mutation, soulignant que l’enjeu n’est plus seulement technique mais organisationnel.
Dans le secteur bancaire, l’agentification a trouvé un terrain fertile : la gestion de l’identité client et de la conformité. Un grand établissement a mis en place une « agent factory » composée de dizaines d’agents IA spécialisés dans les tâches de KYC (Know Your Customer). Résultat, une réduction de moitié du temps et de l’effort requis, tout en améliorant la qualité et la cohérence de la production. Mais l’innovation tient moins à la technologie qu’à la réorganisation : deux à cinq employés suffisent désormais à superviser cinquante à cent agents.
Cette inversion du rapport numérique illustre la puissance du modèle, mais aussi sa dépendance à une supervision humaine. Les banques doivent inventer des modèles de pilotage qui ne tirent pas vers le bas la vitesse des agents, tout en gardant la maîtrise du risque réglementaire. Ce cas révèle une tension structurelle : l’IA démultiplie la productivité, mais elle impose de réinventer la gouvernance pour ne pas brider ses capacités.
Les assureurs réinventent les sinistres et la souscription
Le secteur de l’assurance, habitué à des processus rigides et fortement régulés, illustre bien la bascule. Plusieurs compagnies ont commencé à confier à des agents IA la gestion des sinistres et la souscription des contrats, tout en repositionnant les équipes humaines « au-dessus de la boucle ». Ces superviseurs arbitrent les cas litigieux, redéfinissent les règles métier et garantissent la conformité. La valeur dégagée est significative : rapidité accrue, coûts compressés, satisfaction client renforcée. /p>
Mais la difficulté d’intégration tient au fait que l’assureur doit accepter de reconstruire des workflows entiers, et non simplement d’automatiser des tâches existantes. Cette logique bouleverse les frontières fonctionnelles : un sinistre n’est plus traité par une suite de services cloisonnés mais par un flux agentique intégré, et sous surveillance humaine. Pour les directions métiers, la mutation est culturelle autant que technique : passer du contrôle ex post à une orchestration en temps réel.
Les télécoms, laboratoire grandeur nature
Chez les opérateurs télécoms, l’adoption des agents IA s’est d’abord concentrée sur la relation client. Les assistants virtuels, capables de gérer des millions de demandes simples, ont libéré les centres de contacts. Mais le mouvement ne s’arrête pas là : facturation, marketing, maintenance de réseau sont progressivement repensés autour de flux agentiques. Cette extension systématique démontre la capillarisation du modèle : un agent créé pour un usage limité peut être dupliqué et enrichi pour couvrir toute une chaîne de valeur. /p>
Toutefois, cette généralisation crée un risque d’éparpillement. Sans gouvernance adaptée, l’organisation peut se retrouver avec des centaines d’agents spécialisés, difficiles à orchestrer et sources de chaos. Les pionniers mettent en place des « chartes d’agentification » et des protocoles d’intégration standardisés, inspirés des pratiques DevSecOps, afin de garder la cohérence et assurer la sécurité. Là encore, le défi n’est pas l’IA elle-même, mais la discipline organisationnelle qui doit l’accompagner.
Industrie et secteur public : l’IA corrige les systèmes hérités
Dans l’automobile et dans certaines administrations, les agents IA servent d’abord à moderniser l’existant. Des escouades d’agents s’attaquent aux systèmes hérités, en cartographiant les processus, en traduisant les règles implicites et en générant du code pour rénover les socles applicatifs. Les humains interviennent comme « maîtres d’œuvre », orientant et validant les résultats. Ce rôle de rétro-ingénierie illustre un paradoxe : l’IA ne se contente pas d’innover, elle commence par réparer l’héritage numérique accumulé depuis des décennies.
L’enjeu d’intégration est double : d’un côté, l’opportunité de réduire drastiquement la dette technique, de l’autre, le risque de dépendance à des agents qui interprètent des systèmes complexes sans en maîtriser toutes les nuances. Ce cas révèle un frein récurrent : l’agentification n’est pas une couche ajoutée mais une refonte, ce qui suppose du courage managérial et une tolérance au risque que toutes les organisations n’ont pas.
Le risque de finir avec « plus de pilotes que Lufthansa »
Ces cas convergent vers un constat : la difficulté d’intégrer l’IA ne réside pas dans la maturité technique des modèles, mais dans la capacité des organisations à réinventer leur gouvernance, leur culture et leur mode de décision. McKinsey résume le danger par une formule éloquente : « plus de pilotes que Lufthansa », c'est-à-dire multiplier les expérimentations sans transformer le cœur des opérations. C’est là que se joue la vraie bataille pour passer de l’IA comme vitrine à l’IA comme moteur de productivité. Pour les dirigeants, la clé est de lancer rapidement des « phares » visibles, end-to-end, qui montrent la valeur et entraînent l’organisation.
La perspective est limpide : les entreprises capables de dépasser la logique de silos et d’adopter des réseaux agentiques fluides bénéficieront d’un avantage compétitif durable. Pour les autres, l’IA restera un outil périphérique, voire clandestin avec le « Shadow AI », sans impact réel sur la performance.