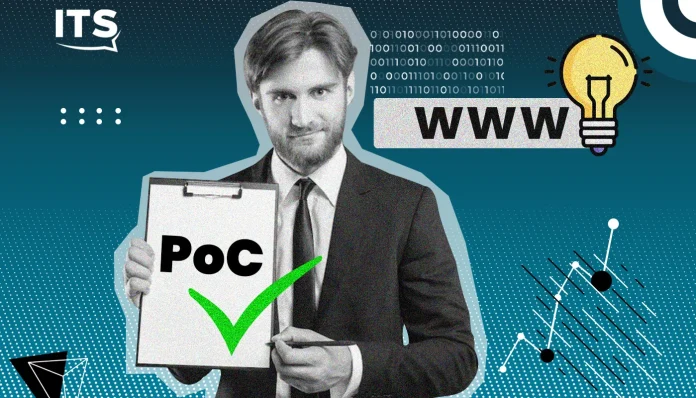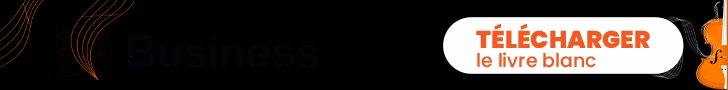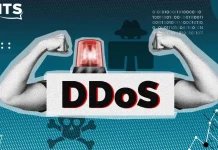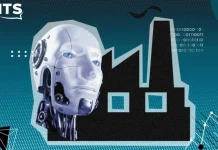Alors que nombre d’entreprises peinent à industrialiser l’intelligence artificielle, les membres du Global Lighthouse Network démontrent que productivité, agilité et durabilité peuvent être atteintes à l’échelle. Leurs stratégies s’articulent autour d’une gouvernance décentralisée, d’équipes hybrides et d’actifs numériques composables. Une feuille de route crédible pour les suiveurs rapides.
Le « Global Lighthouse Network », lancé en 2018 par le Forum économique mondial, constitue aujourd’hui l’un des meilleurs observatoires de la transformation numérique à l’échelle industrielle. Regroupant près de 200 sites de production dans 33 pays, cette communauté mondiale met en lumière les organisations capables d’orchestrer des projets technologiques d’envergure avec un impact tangible sur la performance, la résilience et la durabilité. Chaque site sélectionné, désigné comme Lighthouse, fait l’objet d’une évaluation rigoureuse par un panel d’experts indépendants, selon une méthodologie fondée sur des cas d’usage, des indicateurs et une capacité avérée à répliquer ces transformations sur l’ensemble de la chaîne de valeur.
À rebours d’une vision strictement technocentrée de l’innovation, l’édition 2025 du rapport met en évidence les leviers stratégiques — humains, organisationnels et technologiques — qui permettent de dépasser l’expérimentation pour produire un changement systémique. Et ce, dans des secteurs aussi variés que l’automobile, l’agroalimentaire, la chimie, l’électronique ou les équipements médicaux. Une source d’inspiration pour les entreprises françaises confrontées au défi du passage à l’échelle, à l’ère de l’IA générative et de la décarbonation des chaînes de valeur.
Loin de l’effet de mode, l’intelligence artificielle est utilisée par les Lighthouses selon une logique de rentabilité. En moyenne, leurs sites constatent une amélioration de plus de 50 % des coûts de conversion, des temps de cycle ou des taux de défauts. Les transformations menées génèrent un retour sur investissement multiplié par deux à trois en trois ans, et par quatre à cinq en cinq ans. La clé réside dans l’industrialisation de cas d’usage ancrés dans les réalités du terrain, principalement en IA analytique (77 % des cas recensés), avec des incursions mesurées en IA générative (9 %). Cette stratégie pragmatique contraste fortement avec les difficultés rencontrées par nombre d’acteurs à faire la démonstration d’un impact métier tangible de l’IA.
Ce changement d’échelle permet aux sites concernés de sortir du « purgatoire des pilotes », ce stade où les projets innovants ne débouchent ni sur une adoption large ni sur un avantage compétitif durable. Loin d’un effet de silo, la transformation touche aussi bien la production que la logistique, la maintenance, la qualité ou la gestion des ressources. Chaque site labellisé déclare s’être appuyé sur une moyenne de trois autres Lighthouses pour modéliser ses propres initiatives, souvent hors de son secteur d’origine. Une démonstration concrète de l’intérêt d’une approche intersectorielle de l’innovation industrielle.
Une gouvernance fondée sur l’adoption locale et l’architecture composable
Les membres du GLN partagent un même principe : la transformation ne peut être portée uniquement par le siège ou les directions fonctionnelles. Elle doit être incarnée par les opérateurs eux-mêmes, grâce à des outils adaptés à leur quotidien, une conception centrée sur l’usage et une capacité d’action réelle sur les solutions numériques. Cette logique a conduit les sites à réorganiser leurs flux d’information et leurs processus opérationnels autour d’une donnée fiable, contextualisée, et directement exploitable par les équipes terrain.
Pour y parvenir, les entreprises investissent quatre à cinq fois plus dans la réduction de la dette de processus (ces pratiques non optimisées), l’accompagnement du changement et l’adoption locale que dans la technologie elle-même. Des plateformes internes à bas code ou sans code (low-code/no-code) permettent à des techniciens ou des responsables d’atelier de créer ou de modifier des outils métiers. Chez Roche, par exemple, un hub d’innovation regroupe plus de 80 développeurs citoyens qui conçoivent des applications sur mesure, validées selon un modèle modulaire compatible avec les exigences réglementaires du secteur pharmaceutique.
Des équipes hybrides pour la montée en maturité numérique
Le succès des Lighthouses repose également sur des équipes transverses qui associent profils techniques et fonctions métiers. En moyenne, chaque site transformé ajoute 25 postes dédiés par tranche de 1 000 salariés, répartis entre data scientistes, ingénieurs automatisation, analystes métiers, responsables de transformation, coachs et traducteurs business. Cette hybridation permet de dépasser la simple juxtaposition de technologies en introduisant une logique de chaîne de valeur de l’information, gouvernée, contextualisée et orientée impact.
Les centres d’excellence, initialement mobilisés pour piloter les déploiements, cèdent progressivement la main aux sites eux-mêmes, dans une logique de subsidiarité. Siemens applique ainsi cette approche avec son programme Lean Digital Factory : les outils développés en interne sont d’abord testés dans des usines pilotes, puis transférés aux équipes locales pour être adaptés et diffusés. L’ambition n’est pas de généraliser à tout prix, mais de réutiliser des actifs numériques standards (API, microservices, modèles de données…) en les adaptant aux spécificités locales.
Agilité, résilience et circularité : l’IA comme levier d’optimisation
Au-delà de l’atelier, l’étude met en lumière les efforts des Lighthouses pour rendre leurs chaînes de valeur plus agiles et résilientes. Des hubs de résilience, structurés selon un modèle hub-and-spoke, orchestrent la planification intégrée, la simulation des perturbations, la prévision de la demande et l’optimisation logistique. Ces dispositifs, appuyés sur des modèles d’IA hybrides (prédictifs et génératifs), ont permis de réduire de 50 % les délais d’introduction de nouveaux produits, d’absorber les chocs économiques avec huit fois moins d’impact sur le chiffre d’affaires et de baisser de 30 à 50 % les émissions de scopes 1 et 2.
La durabilité, loin d’être un ajout tardif, devient une dimension structurante de la conception des produits et des processus. Midea, le groupe industriel chinois spécialisé dans les appareils électroménagers, intègre par exemple une plateforme de gestion du cycle de vie produit (PLM) permettant la configuration automatique de variantes, la simulation de performance et la validation de la fabricabilité, tout en optimisant l’utilisation des matériaux. Foxconn, pour sa part, met en œuvre le recyclage en boucle fermée d’aluminium dans ses usines chinoises. Ces approches illustrent une convergence entre performance industrielle, compétitivité économique et responsabilité environnementale.
Un référentiel opérationnel pour les DSI et responsables industriels
Loin d’être une exception, l’approche des Lighthouses dessine un modèle reproductible, désormais balisé. À travers un corpus de plus de 2 000 indicateurs et cas d’usage, les membres du GLN proposent un référentiel de transformation qui peut guider les DSI, les directeurs industriels ou les responsables supply chain dans leurs propres trajectoires. Ce modèle repose sur quatre piliers : la réduction de la dette de processus, l’investissement dans les capacités humaines, la formalisation des solutions sous forme d’actifs réutilisables, et l’adoption localisée par les utilisateurs finaux.
Dans un contexte où la pression réglementaire, la rareté des ressources et l’incertitude géopolitique imposent une meilleure maîtrise des cycles industriels, cette démarche fournit une alternative crédible au pilotage technocentré. Elle redonne une place centrale aux métiers, aux compétences et à la gouvernance, tout en intégrant les apports technologiques avec discernement. À l’heure du passage à l’échelle, les Lighthouses rappellent que ce ne sont pas les outils qui transforment l’industrie, mais la manière dont les organisations les intègrent dans un dessein commun et une logique d’impact réel.