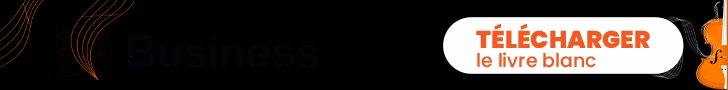Le secteur immobilier concentre près de 40 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, dont une large part liée à la consommation d’énergie du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. La pression climatique et économique place l’intelligence artificielle comme levier stratégique pour améliorer l’efficacité énergétique, réduire les coûts d’exploitation et accroître la résilience des bâtiments. Le rapport 2025 de KPMG Global Decarbonization Hub en fournit une démonstration.
D’ici à 2050, la planète Terre sera urbanisée à 68 %, le parc immobilier devenant l’un des principaux terrains d’action pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Or, les bâtiments tertiaires, notamment commerciaux, présentent des marges de progression considérables : jusqu’à 40 % de leur consommation énergétique est absorbée par les systèmes de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), souvent pilotés de manière rigide ou sous-optimale. À cela s’ajoute une complexité croissante dans la gestion des données et des équipements techniques, difficile à appréhender pour les équipes de maintenance seules.
L’automatisation pilotée par l’IA permet de passer d’une gestion programmée à une orchestration dynamique, capable de réagir en temps réel aux variations d’occupation, aux conditions climatiques, aux prix de l’énergie et à l’état des équipements. Elle introduit une granularité nouvelle dans le pilotage énergétique, en combinant l’analyse des données issues des systèmes de gestion technique (GTB/BMS) à des modèles prédictifs ajustés en continu. Ce changement de paradigme rapproche le bâtiment intelligent d’un système apprenant, réactif et frugal.
Vers une IA centrée sur l’humain et le confort
Au cœur de cette évolution, KPMG défend le concept d’« IA centrée sur l’humain » dans le bâtiment. Il ne s’agit pas seulement d’automatiser la régulation thermique, mais d’adapter les conditions intérieures aux usages réels, tout en réduisant la charge cognitive des occupants et des exploitants. L’objectif est double : assurer une qualité de l’air et un confort thermique constants pendant les heures d’occupation, et optimiser les consommations hors des plages critiques.
Ce modèle d’IA repose sur plusieurs principes : la transparence des décisions (explicabilité des algorithmes), la capacité d’adaptation aux préférences des usagers, l’intégration des contraintes de maintenance et la compatibilité avec les infrastructures existantes. Il se concrétise par des solutions logicielles en mode service, connectées aux GTB (Gestion Technique du Bâtiment), le système centralisé qui supervise, contrôle et optimise les installations techniques d’un bâtiment. Celui-ci est à même d’effectuer des ajustements toutes les quinze minutes si nécessaire. Loin de remplacer l’humain, ces solutions renforcent sa capacité d’action, en temps réel et à l’échelle du bâtiment.
Optimisation continue : l’exemple du projet estonien Jenny
Le cas d’usage développé par KPMG en Estonie avec R8 Technologies illustre la portée opérationnelle de ces approches. L’agent numérique Jenny, déployé sur plus de 4 millions de mètres carrés dans 23 pays, agit comme un opérateur virtuel autonome pour les systèmes CVC. Sans ajout de matériel, il connecte les données des bâtiments (jusqu’à 14 millions de points de mesure) via des protocoles standard (BACnet/IP, OPC UA) et ajuste les réglages toutes les 15 minutes selon les besoins réels.
Deux cas d’usage présentés dans le rapport confirment l’efficacité de cette approche : dans un immeuble de bureaux de 10 000 m², Jenny a permis de réduire la consommation de chauffage de plus de 60 % sans compromettre le confort. Dans un centre commercial de 60 000 m², l’ouverture des vannes de chauffage a été divisée par trois, avec un maintien optimal de la température et de la qualité de l’air. Ces gains sont obtenus par apprentissage progressif des inerties thermiques, des profils d’occupation, des contraintes techniques et des données externes (météo, marché de l’énergie).
Vers une gouvernance stratégique de la performance énergétique
L’optimisation énergétique par l’IA ne peut toutefois produire ses effets à grande échelle sans une démarche structurée d’accompagnement. KPMG propose pour cela le cadre SEM (Strategic Energy Management), un dispositif de pilotage en cinq étapes combinant audit, planification, mise en œuvre, montée en compétence et suivi. Cette approche favorise l’appropriation des outils par les équipes terrain et facilite la gouvernance des résultats dans la durée.
SEM repose également sur une hiérarchie d’investissements : d’abord l’optimisation des actifs existants (jusqu’à 7 % d’économies annuelles), puis le renouvellement des équipements, et enfin l’intégration des énergies renouvelables. Dans ce schéma, l’IA intervient dès le premier niveau, en permettant de maximiser les résultats sans attendre de lourds investissements. La capitalisation sur les données historiques, la capacité de simulation (jumeau numérique) et la diffusion des bonnes pratiques deviennent les piliers d’une transition énergétique maîtrisée.
Un nouveau rôle pour les bâtiments dans l’écosystème énergétique
À mesure que les bâtiments deviennent cognitifs, c’est-à-dire capables de perception, d’adaptation et de décision, ils s’émancipent de leur rôle passif pour devenir des acteurs de la transition. En tant que « prosumers », ils contribuent à la flexibilité du réseau, participent à la stabilité du système électrique et valorisent leurs performances environnementales dans les critères ESG.
Cette transformation reconfigure aussi les attentes des acteurs du marché. Les gestionnaires recherchent des réductions de coûts et une meilleure planification. Les investisseurs valorisent les actifs sobres et bien notés. Les locataires exigent confort et transparence. Les régulateurs imposent des obligations de résultat. Dans ce contexte, l’IA ne relève plus du gadget technologique, mais d’un outil systémique, capable d’aligner la performance énergétique avec qualité d’usage et la création de valeur.
À mesure que les réglementations se durcissent et que les exigences de durabilité deviennent normatives, la capacité à déployer des solutions intelligentes, explicables et centrées sur l’humain devient un avantage concurrentiel décisif. Les bâtiments ne seront plus simplement construits pour durer, mais pour apprendre, anticiper et s’ajuster — avec l’IA comme nouveau cerveau énergétique des villes.